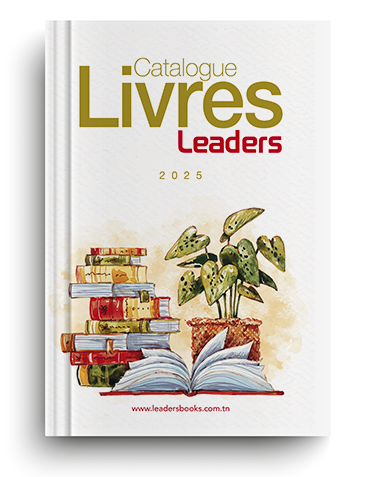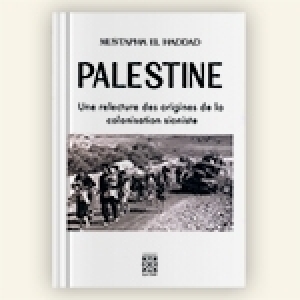Mohamed Ala Eddine Abid: Pourquoi la Tunisie a besoin d’un dinar compétitif !

 De tous les indices macroéconomiques, le taux de change est probablement l’instrument le plus visible pour le grand public. Ainsi,dans l’inconscient populaire, il semble résumer à lui seul le pouvoir d’achat d’une nation : Sa baisse sonne souvent la crise alors que sa force rassure sur la santé du pays. Toutefois, une non-connaissance des dynamiques réelles entre le taux de change d’une part, et la croissance, la balance commerciale, et autres agrégats macro-économiques d’autre part peut induire une confusion toute basique : si une monnaie nationale forte est souvent un symptôme de vigueur économique (corrélation, souvent causalité de la santé économique vers le taux de change) alors il faut « défendre » la monnaie nationale, même si c’est au prix d’une devise chèrement accumulée via des moyens propres (exportations, transferts, …) ou par la dette extérieure, pour garder une bonne santé économique du pays (causalité dans le sens erroné).
De tous les indices macroéconomiques, le taux de change est probablement l’instrument le plus visible pour le grand public. Ainsi,dans l’inconscient populaire, il semble résumer à lui seul le pouvoir d’achat d’une nation : Sa baisse sonne souvent la crise alors que sa force rassure sur la santé du pays. Toutefois, une non-connaissance des dynamiques réelles entre le taux de change d’une part, et la croissance, la balance commerciale, et autres agrégats macro-économiques d’autre part peut induire une confusion toute basique : si une monnaie nationale forte est souvent un symptôme de vigueur économique (corrélation, souvent causalité de la santé économique vers le taux de change) alors il faut « défendre » la monnaie nationale, même si c’est au prix d’une devise chèrement accumulée via des moyens propres (exportations, transferts, …) ou par la dette extérieure, pour garder une bonne santé économique du pays (causalité dans le sens erroné).
Cet article se propose de montrer que cette idée, au-delà du fait d’être une erreur logique, est certainement (très) dangereuse pour l’économie du pays en rappelant certains principes basiques et en discutant certaines idées reçues.
1. Une monnaie ne doit jamais être surévaluée
Vrai !Tout d’abord, rappelons le fait qu’on admet l’existence d’un taux de change d’équilibre, qui permet sur le moyen terme, l’ajustement de la position extérieure nette vers sa position stable et qui dépend des fondamentaux économiques de chaque pays[1]. Le taux de change côté, qu’il soit fixe, flottant dirigé ou même totalement libre, peut s’écarter de cette valeur d’équilibre. Un taux de change au-dessus de son niveau d’équilibre est dit surévalué alors qu’un taux de change en dessous de son niveau d’équilibre est dit sous-évalué. On ne dit pas qu’une monnaie est forte ou faible, en absolu, mais on la compare à son taux d’équilibre pour estimer le sens et le degré du mésalignement.
Il existe aujourd’hui un quasi consensus sur le fait qu’éviter un taux de change surévalué est un impératif économique de premier ordre. (Dollar (1992), Sachs et Warner (1995), Razinet Collins 1997, Johnson, Ostry et Subramanian 2007). Ce résultat empirique robuste s’explique généralement par les conséquences désastreuses qu’un taux de change surévalué peut induire, telle une instabilité financière, un assèchement des réserves de devise, une économie de la rente et une propagation de la corruption ainsi qu’une balance courante en déficit non soutenable.
2. L’insistance sur une monnaie « compétitive » est une idée néo-libérale tenue par le FMI et critiqué par plusieurs économistes de renom
Faux !Si comme mentionné ci-dessus, éviter une surévaluation est un résultat consensuel de la littérature, un débat oppose deux camps
- Un camp soutient que le taux de change doit se situer à son taux d’équilibre, sans intervention étatique pour « manipuler » le cours pour la baisse ou la hausse, et ainsi assurer la meilleure allocation possible des ressources et éviter de créer des distorsions en envoyant de faux signaux aux agents économiques. C’est typiquement la position de tout économiste croyant en la supériorité des marchés sur l’état et adepte du laissez-faire. Le FMI dans toutes ses recommandations, appelle à ce que le dinar tunisien retrouve son taux d’équilibre (pas de nécessité de correction brutale, le taux de surévaluation serait d’environ 10% en 2016, avant la dernière dépréciation), et que la banque centrale se contente de stabiliser le cours contre les volatilités extrêmes sans essayer de le garder au-dessus d’une certaine valeur.
- Un autre camp, de plus en plus influent, soutient qu’il faut opter pour un taux de change sous-évalué par rapport à son taux d’équilibre pour améliorer les équilibres externes et générer une croissance plus vigoureuse. Les adeptes notoires de cette stratégie incluent, entre autres, Paul Krugman, Dani Rodrik, et Joseph Stiglitz. Les deux derniers ont été les auteurs des critiques les plus acerbes vis-à-vis du FMI et de ses conditions imposées aux pays en voie de développement (dérégulation, ouverture du compte de capital, privatisations, austérité…). Toutefois, ils se rejoignent totalement sur la nécessité d’éviter une surévaluation du taux de change. Pire encore, ces économistes brillants et rebelles demandent plus : Une sous-évaluation du taux de change pour compenser les défaillances du marché et de l’état et permettre un chemin de croissance plus rapide !
3. Une monnaie compétitive profite uniquement aux pays développés
Faux !Dani Rodrik, dans son article séminal de 2008, montre, que peu importe la façon avec laquelle il construit son taux de change réel (valeur non observable comme le taux de change nominal, donc forcément construite selon un modèle), il existe une relation linéaire entre le mésalignement du taux de change et le taux de croissance. Ainsi, tout comme une surévaluation nuit à la croissance, une sous-évaluation le facilite. Et quand il divise l’échantillon des pays en deux selon l’état de développement, il trouve que le résultat n’est robuste que pour les pays en voie de développement !Plus explicite encore, plus le pays est sous-développé, plus la relation entre croissance et sous-évaluation du taux de change est robuste ! Ce résultat empirique s’explique selon Rodrik par une mauvaise allocation des ressources entre le secteur des biens commercialisables (Tradablesector) et le secteur des biens non commercialisables (non-tradablesector) pour deux raisons :
- Le secteur des biens commercialisables souffre disproportionnellement (comparé au secteur non commercialisable) de la faiblesse des institutions des pays en voie de développement.Le secteur commercialisable est plus exposé à la corruption et la lenteur de l’administration, la faiblesse de la législation (droit des contrats / droit de la concurrence), la non performance du système judiciaire, …
- Le même secteur souffre des défaillances de marché, comme les externalités d’information et de coordination qui empêchent la diversification et l’apprentissage technologique.
D’autres pistes ont été avancées pour expliquer le lien empirique entre sous-évaluation du taux de change et croissance. Levy-Yeyati&Sturzenegger/Glüzmann, 2003, penchent sur un canal de transmission via l’augmentation de l’épargne et l’accumulation de capital.
4. Les exportations et importations en Tunisie ne sont pas assez élastiques
Polémique ! Pour savoir si la balance commerciale d’un pays bénéficie d’une dépréciation du taux de change, on calcule l’équation des élasticités critiques connue sous le nom de Marshall-Lerner, et c’est uniquement si cette équation est vérifiée (sous forme de condition d’inégalité) qu’on déduit qu’une dépréciation sera bénéfique pour la balance commerciale. Une très bonne revue de littérature peut se trouver dans le papier de Bahmani, Harvey et Hegerty de 2013
Certaines études, en montrant que l’équation de Marshall-Lerner (M-L) n’est pas vérifié, concluent à une forme de « tradepessimism » : dévaluer le taux de change ne peut pas améliorer la balance commerciale. Toutefois, prenons la peine de souligner certains points importants :
- L’équation M-L est très sensible aux hypothèses sous-jacentes. L’équation sous forme réduite (somme des deux élasticités quantité/prix de la demande import et export > 1) ignore les coefficients de pass-through (sensibilité des prix des produits import et export aux taux de change). Leur prise en compte facilite la vérification de la dite équation. Bussière et al, 2016, en prenant en compte ces coefficients, vérifient l’équation pour un ensemble de 51 pays, dont la Tunisie (Le papier de Bussière développe l’équation sous sa forme généralisée).
- L’équation M-L, sous sa forme la plus connue n’est adaptée que pour une balance commerciale équilibrée. Si la balance commerciale est en déficit, alors on fait introduire le ratio export sur import et la condition devient beaucoup plus facile à vérifier. Avec un ratio de 70% environ (37% pour le secteur résident tenu de rapporter des devises pour le premier semestre 2017 !), il serait très difficile de ne pas vérifier l’équation M-L.
- Quand la balance commerciale n’est pas équilibrée, il existe deux dérivations possibles de l’équation, selon que l’on exprime la balance en monnaie locale ou en devise. Chaque équation a son propre seuil critique, et s’il existe un déficit commercial, alors il est plus facile de vérifier l’équation M-L en devise qu’en dinar ! Rappelons que c’est l’équation M-L exprimé en devise qui est la plus importante s’il s’agit de résoudre le problème de solvabilité externe et de pénurie de devises.
Je serais plus que ravi de discuter les résultats de tout papier qui puisse démontrer la non vérification de l’équation M-L, exprimée en devise, prenant en compte le déficit actuel, et toutes les hypothèses pertinentes pour la Tunisie !
5. Les élasticités exportations et importations sont des données exogènes
Faux (sauf exceptions) ! On a beau discuté la validité de l’équation M-L, il faut savoir que pour un pays en développement, les élasticités empiriques ne sont jamais la fin de l’histoire. Avec un taux de change compétitif, il faut aussi des politiques industrielles, fiscales, et financières pour améliorer ces élasticités (on les estime à partir d’un historique, certes, mais on peut surtout agir dessus !)
Guzman, Ocampo et Stiglitz, dans un article paru en 2017, préconisent l’intervention de l’état dans le cadre d’une politique industrielle cohérente, en plus d’une stratégie de change compétitif, pour faciliter l’accès au crédit (banques de développement), l’aide au transfert technologique, l’investissement en infrastructure (Rien qui passe par le port de Rades ne peut être élastique en fait !), l’éducation, l’R&D, et l’investissement en capital humain pour réorienter une partie des chômeurs vers les secteurs en croissance et ainsi améliorer l’élasticité des exportations au taux de change compétitif.
Un autre exemple est le commerce entre les sociétés on-shore et off-shore en Tunisie. La réglementation le rend tellement compliqué que des sociétés off-shore ont été obligées de passer par des sociétés de courtage domiciliées en Europe pour pouvoir vendre leurs produits à des entreprises on-shore (exporter puis réimporter pour contourner une réglementation lourde et caduque) (Source document banque mondiale : La révolution inachevée Encadré 4.3). Supposons maintenant qu’un change compétitif incite une société exportatrice dans l’un des régimes à augmenter sa production, et qu’elle ait besoin de biens intermédiaires d’une société dans l’autre régime. La réglementation va empêcher cette relation fournisseur client de naitre et d’être fluide, et la société exportatrice ne pourra pas réagir promptement en augmentant la quantité de sa production. L’élasticité, dans ce cas, est abîmée par un choix aberrant qu’il faut, et surtout suffit, de changer. Ces corrections rapides des élasticités ne sont pas captées par l’équation M-L
6. Une subvention directe aux exportateurs serait meilleure qu’un taux de change compétitif
Non dans un monde réel ! Tout d’abord, une subvention peut être interdite selon les accords de libres échanges et les règles du WTO, et expose le pays qui les pratique à des représailles qui vont lui nuire.
Deuxièmement, une subvention de l’état suppose une connaissance fine des secteurs à haute valeur technologique et dans lesquels le pays peut acquérir rapidement un certain avantage comparatif. C’est ce qui a été appliqué sous le libellé « industrie naissante » : Soutenir une industrie pour qu’elle surmonte les couts initiaux fixes d’apprentissage et d’économie d’échelle. Une subvention étatique est souvent sujette à une mauvaise connaissance des bons secteurs et peut rapidement devenir un terrain de corruption fertile. (Pourquoi subventionner tel secteur ou tel firme, et jusqu’à quel niveau, et quand décider d’arrêter).
Un taux de change compétitif, permet de léguer l’activité de recherche des secteurs d’avenir aux mécanismes de libre marché (le taux de change subventionne tous les secteurs exportateurs). Toutefois, il existe des secteurs exportateurs à faible valeur ajouté, et sans externalités d’apprentissage positives (learningspillovers) comme les commodités. Il s’agit alors, de les taxer lourdement (la subvention est reprise par l’état sous forme de taxe). Ceci permet d’une part d’éviter qu’ils concentrent l’essentiel de l’investissement et la croissance, et d’autre part génère une manne d’argent que l’état peut utiliser pour rectifier les effets négatifs de l’inflation importée sur le consommateur. Cette politique crée un système de taux de changes effectifs multiples de facto qui peut rendre les secteurs exportateurs hors commodités compétitifs. (Voir Guzman, Ocampo et Stiglitz 2017 pour plus de détails)
7. Une dépréciation du taux de changeet une libéralisation du compte de capital vont toujours de pair
Faux ! Il faut distinguer ces deux mesures qu’on a tendance à mettre dans le même package (néo-libéral). Si un taux de change non surévalué est un résultat solide de la littérature scientifique, la deuxième mesure qu’est la libéralisation des flux de capitaux est très controversée, et a concentré la plupart des critiques des économistes vis-à-vis du FMI avant la crise financière (Oui, le FMI a bien changé depuis, selon l’avis de ses détracteurs initiés). Une libéralisation du capital implique un risque de volatilité et des attaques spéculatives qui peuvent paralyser des systèmes financiers peu développés et fragiles dans les pays en voie de développement. Ils provoquent aussi des cycles Boom and Bust : des entrées massives de capitaux dans la période faste (search for yield), ce qui provoque une surévaluation du taux de change, et lors d’une crise, la fuite massive de ces capitaux provoquent une crise de paiement sévère (flight to safety).
Un contrôle des flux de capitaux permet de maintenir un taux de change compétitif et stable (contrôler la volatilité et améliorer la qualité des flux de capitaux entrant et allonger leurs maturités). Ce contrôle doit se coupler à une intervention dynamique des banques centrales dans le marché de change pour réguler le marché (accumuler la devise lors des périodes de forte croissance et injecter de la devise, bien qu’en plus petite quantité, pour éviter une dépréciation trop importante par rapport au taux cible si les flux de capitaux étrangers viennent à s’assécher brutalement).
8. Une dépréciation/dévaluation génère de l’inflation importée et heurte le consommateur
Oui sur le court terme ! Une dépréciation/dévaluation taxe le consommateur via une hausse des biens commercialisables et subventionne le capital qui investit dans les industries exportatrices. Ça diminue donc les salaires en termes de pouvoir d’achat dans l’espoir d’une croissance vigoureuse et donc de salaires plus importants dans le futur.
Pire encore, un des effets pervers d’une dépréciation/dévaluation est que l’inflation ressentie par les foyers modestes est plus importante que les foyers riches (puisque les premiers consomment en pourcentage plus de biens commercialisables comme les commodités). Une dépréciation/dévaluation ne peut réussir qu’avec une politique sociale qui redistribue une partie de la richesse, et protège les foyers les plus démunis ! (exemple des subventions alimentaires en Tunisie qui cassent la liaison entre le taux de change et le prix final et qu’il faut peut-être réformer mais pas supprimer)
A titre d’exemple, Pepinsky dans un livre paru en 2009 rapporte que beaucoup de dictateurs, ainsi que de dirigeants populistes, gardent un taux de change surévalué pour augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs sur le court terme, même si les perspectives de croissance sur le moyen et le long terme en deviennent sérieusement menacées. Toutefois, la crise de paiement qui découle d’un taux de change surévalué finit souvent par imposer une dévaluation, et un grand nombre de leaders perdent le pouvoir suite à la perturbation qui en découle. Steinberg et Malhotra rapportent que lors des dévaluations entreprises par des dictatures militaires, 17% ont perdu le pouvoir, et lors de celles entreprises par des régimes démocratiques, 38% ont perdu le pouvoir à leurs tours.
Ceci montre que c’est bien le coût politique sur le court termequi empêche la plupart des régimes d’entreprendre une dévaluation (ou de laisser une dépréciation se concrétiser) malgré les bénéfices économiques quasi-certains (au moins lors d’une correction d’un cours surévalué) sur le moyen et le long terme.
Conclusion
Résumons-nous :
- Un taux de change n’est ni fort ni faible en absolu, mais se compare à un niveau d’équilibre dépendant des fondamentaux économiques du pays, et la différence entre le taux de change réel et le taux de change d’équilibre est appelée mésalignement.
- Il est communément admis que le taux de change réel ne doit pas être au-dessus de son taux d’équilibre, et que ça nuit énormément aux perspectives de croissance.
- Un débat existe entre ceux qui appellent à ramener un taux de change à son d’équilibre et ceux qui appellent à le maintenir sous son niveau d’équilibre pour corriger certaines défaillances de l’état et du marché.
- Il est argumenté par plusieurs économistes que les pays les moins développés sont ceux qui tirent le plus grand bénéfice d’une sous-évaluation de leur taux de changeen termes de perspectives de croissance (contrairement à une idée reçue)
- La condition de Marshall-Lerner en équilibre, incluant les coefficients pass-through, a été vérifiée par un certain nombre d’articles pour la Tunisie, mais l’équation pertinente est celle prenant en compte le déficit initial et exprimée en devise. Elle est a fortiori plus facile à vérifier.
- La condition de Marshall-Lerner n’est jamais la fin de l’histoire. Les élasticités ne sont pas exogènes, et l’état peut et doit intervenir dessus.
- Dans un monde idéalisé, la dévaluation du taux de change est un optimum de second rang par rapport à une subvention directe et ciblée des secteurs exportateurs à forte externalité positive. Dans les faits, avec une information asymétrique et incomplète et une corruption rampante, elle devient la solution la plus faisable et la plus efficace.
- Un contrôle des capitaux (et des interventions ciblées de la banque centrale) vient compléter la stratégie de change compétitif, et assure une stabilité du taux nécessaire pour la bonne croissance des secteurs exportateurs.
- Une dévaluation/dépréciation taxe le consommateur, et nuit plus aux ménages pauvres qu’aux ménages riches. C’est certes le prix à pays pour générer de la croissance et réformer les finances publiques, mais il faut des politiques sociales très actives pour atténuer les retombées négatives et protéger les plus vulnérables.
- La peur d’une crise sociale a longtemps incité les gouvernements à suivre des politiques économiques non optimales pour des raisons purement politiques et court-termistes. Il faut avoir le courage politique de prendre les mesures qui limitent la consommation actuelle dans l’espoir d’une croissance vigoureuse et une consommation future plus importante (surtout si le prix de ne pas le faire signifie un endettement massif, non productif, et non soutenable que les générations futures devront rembourser).
Bibliographie
Bénassy-Quéré, Béreau, Mignon (2009) « Taux de change d’équilibre : Une question d’horizon »
Dollar, David (1992) « Outward-oriented developing economies really do grow more rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985 »
Sachs, Jeffrey, and Andrew Warner (1995) "Economic reform and the process of global integration”
Razin, Ofair, and Susan M. Collins (1997) "Real Exchange Rate Misalignments and Growth,"
Simon H, Ostry, and Subramanian (2007), "The Prospects for Sustained Growth in Africa: Benchmarking the Constraints"
Levy-Yeyati, Sturzenegger and Gluzmann(2013) “Fear of appreciation”
Rodrik, Dani (2007) “The real exchange rate and economic growth”
Bahmani and al (2013) “Empirical tests of the Marshall‐Lerner condition: a literature review”
Bussière, Gaulier and Steingress (2016) “Global Trade flows: revisiting the trade elasticities”
Guzman, Ocampo, Stiglitz (2017) Real Exchange Rate Policies for Economic Development
Steinberg, Malhotra(2012) The Effect of Authoritarian Regime Type on Exchange Rate
Krugman (2016) “The Return of Elasticity Pessimism”
Krugman (2010) “Capital Export, Elasticity Pessimism, and the Renminbi”
Mohamed Ala Eddine Abid
[1] Selon l’horizon de calcul : moyen terme, long terme ou très long terme, on peut définir plusieurs taux de change d’équilibre, voir Bénassy 2009 pour une comparaison des différentes méthodes d’estimation.
- Ecrire un commentaire
- Commenter