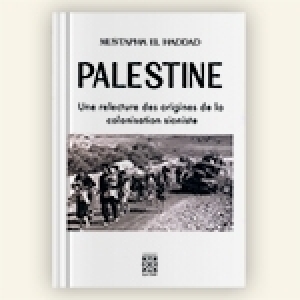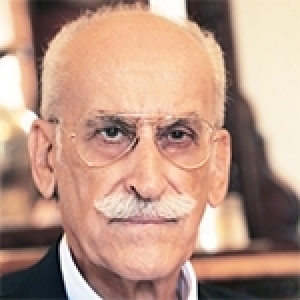Une école pionnière, I’École de la Rue du Pacha

A l’aube du XXe siècle, dans une société ébranlée par la colonisation et écrasée par les impératifs dissolvants de la politique coloniale, la question de l’éducation et la finalité de l’enseignement à prodiguer aux jeunes filles musulmanes suscitent des débats passionnés. Sensible aux idées véhiculées à travers le monde arabe par les idéologues du mouvement de la Nahdha, Jameleddine el Afghani et Mohamed Abdou, qui tentent la difficile synthèse entre l’islam et la modernité occidentale, sensible également aux idées propagées par les réformateurs tels que Rifaat el Tahtaoui et surtout Kacem Amine qui voient dans la condition faite aux femmes une des causes du retard pris par la société musulmane, la presse tunisienne a constitué le meilleur témoin de l’irruption d’une pensée féministe qui forgea sa propre symbolique autour de la question de l’instruction.
 Ennahdha, Murshid el Umma, Al Badr, Lissân Echaab, El Hadhira, Essaweb, la revue Khereddine ont constitué le support culturel qui permit l’éclosion des réflexions autour de la question et le lieu de propagation des nouvelles relatives au mouvement d’émancipation des femmes dans le monde. La revue Al Alam el Adabi consacra même toute une rubrique intitulée «Femme dans le monde» pour répercuter les acquis émancipatoires de la femme en Europe et en Turquie.
Ennahdha, Murshid el Umma, Al Badr, Lissân Echaab, El Hadhira, Essaweb, la revue Khereddine ont constitué le support culturel qui permit l’éclosion des réflexions autour de la question et le lieu de propagation des nouvelles relatives au mouvement d’émancipation des femmes dans le monde. La revue Al Alam el Adabi consacra même toute une rubrique intitulée «Femme dans le monde» pour répercuter les acquis émancipatoires de la femme en Europe et en Turquie.
La nécessité d’une relecture libérale du Coran en matière de condition féminine fut alors un des thèmes majeurs de la littérature réformiste. En 1897, le cheikh Mohamed Essnoussi publia un ouvrage intitulé L’Epanouissement de la fleur ou Etude sur la femme en islam. Tout en justifiant la majeure partie des prescriptions coraniques, il se prononçait timidement pour l’instruction des filles. Quelques années plus tard, alors que le mouvement Jeune Tunisien prenait naissance, paraît un ouvrage signé de trois auteurs: César Benattar, Abdelaziz Thaalbi et Hédi Sebaî, sous le titre L’esprit libéral du Coran. Les auteurs dénonçaient les conséquences néfastes de la mauvaise interprétation de la loi islamique et rappelaient que l’islam impose l’instruction de la femme au même titre que l’homme. Force est de constater que quelle que soit la timidité des réformes proposées par la plupart des penseurs de l’époque, tous les courants de pensée s’accordaient pour faire de l’éducation de la femme une exigence fondamentale pour l’émancipation de la société. Mohamed Jaibi, directeur de la revue Khereddine, qui désapprouvait les idées de Kacem Amine, appelait en 1906 à armer la femme de l’outil principal de sa défense : l’enseignement: «Ceux qui tentent d’éveiller la mémoire sans brandir l’étendard de l’enseignement pour la femme font des tentatives absurdes et demandent l’impossible».
L’instruction, clé de l’émancipation!
Mais de quel type d’éducation s’agit-il? Quelle est la finalité de l’enseignement à prodiguer aux jeunes filles?
C’est alors que les discours divergent et la polémique s’accentue. Culture arabe ou occidentale? Langue arabe ou française? Débat dramatique parce qu’il touche les fibres ultrasensibles d’une société ébranlée par la colonisation.

Confrontée à un milieu colonialiste, l’instruction de la femme est alors érigée en potentiel de préservation de la nation.
«Nous avons aujourd’hui un besoin urgent de filles musulmanes instruites qui prendraient en charge notre avenir, qui seraient capables d’avoir une intellection des caractéristiques de la période qu’elles vivent et qui seraient dotées d’une éducation nationale solide et efficace qui favoriserait la renaissance de la nation et éveillerait l’esprit national».
La plupart des défenseurs de l’instruction de la femme ont entrevu la possibilité de sa formation dans le but de féconder son apport éducatif et organisateur de la cellule familiale.
La femme se vit assigner un rôle avant-gardiste, elle est le garant de l’ordre social, le symbole de l’identité nationale, le dernier rempart contre la colonisation, voire l’assimilation. La femme est enfin un enjeu que se disputent les occupants et les colonisés; la place qu’est la sienne faisait pour les premiers la preuve du retard des peuples soumis à leur tutelle (Cf. la réponse d’Ahmed ibn Abi Dhiaf aux 23 questions posées par Léon Roches, Consul de France en Tunisie 1853-1863); pour les seconds, elle était le plus sûr rempart contre l’acculturation.

Les femmes enfin, il faut bien en convenir, sont absentes, au début de ce siècle, du débat, les lieux du discours et de la politique restant le monopole des hommes, voire de la minorité des hommes lettrés.
C’est dans ce contexte que sont tentés les premiers essais d’instruction de la jeune fille musulmane. L’école de la rue du Pacha a joué un rôle capital dans ce départ. C’est sur l’initiative de l’épouse du Résident général Louise René Millet que la première école publique pour les jeunes filles musulmanes ouvrit ses portes le ler mai 1900.
Installée dans un palais sis au n° 9 de la rue el Monastiri, l’école Louise René Millet fut dirigée par la veuve d’un haut fonctionnaire français de la Résidence, Mme Eigenschenk, sous forme, au départ, d’une institution autonome patronnée et subventionnée par la Résidence. Pour les premières générations de l’école, la classe c’était la première ouverture sur les horizons du monde, la découverte de la vie. En effet, pendant des siècles, la jeune fille musulmane est restée cloîtrée chez elle. Il n’était pas admis qu’elle s’instruise. En Tunisie, quelques rares familles de l’aristocratie payaient les frais d’un vieux moueddeb qui venait donner ses leçons de Coran à domicile. L’instruction n’allait pas au-delà. L’éducation féminine se limitait à l’apprentissage du ménage et à des travaux d’aiguille à la maison ou dans un atelier du quartier «le Dar el Maalmaa» sous la direction d’une vieille ménagère.

Dans une lettre adressée au président de «l’Alliance Française», Mme Eigenschenk, présentant l’école, écrit : «Les débuts de cette œuvre ont été difficiles: il fallait ménager la susceptibilité des Arabes en présence de toute question féminine musulmane. C’est avec beaucoup de ménagements, d’amitié et de douceur sans aucune pression que nous arrivâmes à vaincre le parti pris inspiré par l’ignorance même du Coran dans les masses indigènes.
Le 1er mai 1900, nous ouvrions notre première école avec cinq fillettes arabes reprises à un groupe de salutistes anglaises. Au bout de trois ans, nous n’avons que 30.
Le monde arabe, si fermé, ne disait rien, observait, se tenait au courant de ce qui se faisait dans notre mystérieuse école où nul Européen ne pénétrait en dehors de nos institutrices»
En effet, la Résidence générale a dû faire pression sur les familles de fonctionnaires tunisiens pour les convaincre d’y envoyer leurs filles. Les élèves étaient sélectionnées dans les milieux de la moyenne bourgeoisie, on veillait à leur bonne éducation et au respect des convenances musulmanes, elles venaient à l’école en voile et accompagnées. La puissance coloniale ne pouvait pousser les choses au point de s’aliéner les pouvoirs locaux, en général les plus conservateurs, et sur la collaboration desquels elle consolida sa propre autorité.
«L’école ne prêche pas l’émancipation, ne touche en rien aux mœurs indigènes. On ne lutte ni contre la réclusion ni contre le voile des femmes. L’instruction et le temps pourront seuls modifier cet état de choses qui, contrairement à bien des croyances, n’est pas imposée par le Coran».
Le programme appliqué à l’école consistait à enseigner les principes du Coran par un moueddeb et les premiers éléments d’instruction arabe (lire, écrire et calculer) parallèlement à une instruction française (littérature, histoire, sciences et hygiène) complétée par des travaux d’aiguille (broderie, couture, dentelle) dispensée par des institutrices françaises.
Le niveau d’instruction n’était pas très élevé, les plus hardies arrivaient tout juste à passer leur certificat d’études primaires.

Les programmes d’enseignement de l’école de la rue du Pacha ont suscité des débats passionnés. L’opinion tunisienne restait sceptique; si parmi les jeunes tunisiens certains recommandaient une amélioration des programmes et que l’enseignement soit poussé à un degré équivalent au certificat d’études primaires (Cf. les articles de Abdeljelil Zaouche dans le Tunisien -1907), d’autres réclamaient un enseignement national imprégné de l’esprit de l’islam à l’instar de l’Egypte et de la Turquie qui ont eu recours à des institutrices de Syrie (Cf. Sadok Zmerli au Congrès de l’Afrique du Nord, Paris octobre 1908). En tout cas, l’œuvre se développant, la Direction des Habous la prit à sa charge. Un nouvel immeuble fut édifié à la rue du Pacha (1911-1912). L’école fut rattachée officiellement au Gouvernement tunisien.
Décrivant le nouvel immeuble, Mme Eigenschenk écrit:
«Tout est prévu pour le confort et l’hygiène de nos jeunes : grandes classes claires et aérées mais dont le système de fenêtres ne peut laisser voir des dehors, vastes salles de coutures et d’ouvrages d’art, superbes cours et préaux où elles prennent leurs ébats et se promènent durant les récréations. Pour leur éviter une sortie, leurs domestiques apportent leur déjeuner du midi à l’école où dans de gais réfectoires on dispose les couverts».
La directrice était convaincue, et elle n’avait pas tort, que sans changer leur costume, sans bouleverser leur apparence, les écolières de la rue du Pacha ne ressembleraient cependant plus à ce qu’étaient leurs mères. La description est tout autre quand elle émane de la Tunisie Française, porte-parole de la Droite française:
«De ce bâtiment bas et vaste, aux portes pleines, lourdes et plantées de gros clous, aux grandes fenêtres ogivales, défendues par les éternels grillages aux mille petits losanges, de toutes ces boiseries emprisonnantes peintes en vert, d’un vert cru, contrastant franchement avec la blancheur des murs ensoleillés, se dégage une impression de tristesse difficile à écarter. Cependant que notre regard cherche à percer les mystères dont ces murs épais et froids de prison seront les confidents muets, notre esprit attendri se porte vers toutes ces nouvelles djenane que l’on entassera là, dans ses grandes salles...
«Ne pouvoir aimer qu’un rêve» tel est le sort cruel qui attend toutes les futures désenchantées qui pénétreront dans cet édifice dont la froideur est adéquate au néant... et d’où, quoi qu’elles fassent, elles ne sortiront peut-être jamais.
A quoi bon alors avoir construit cette école et dépensé 150,000 F environ qui auraient été plus utiles ailleurs...» (La Tunisie Française, 5 janvier 1912).
Les libéraux français de leur côté ne cachaient pas leur déception. «L’on éprouve le regret de ne pas voir ce petit monde si bruyant, si coquet se mêler au monde de nos petites françaises des écoles primaires ou secondaires. Représentez-vous la cour des récréations de l’école Jules-Ferry avec ce mélange... quel pas en avant pour l’assimilation des races et la paix de notre protectorat !» (Le Courier de Tunisie, 14 octobre 1907). Assurément, l’école de la rue du Pacha n’était pas seulement une œuvre pédagogique mais bien plus: elle fut une œuvre politique. Dans l’esprit de ses initiateurs, elle devait, tout en ménageant les traditions musulmanes, apporter un élément de plus à l’influence française, voire à la paix du protectorat en Tunisie.
Il importe enfin de noter qu’en dépit de la timidité de ses débuts et des réactions suscitées, l’école de la rue du Pacha ne cessa d’accroître ses effectifs qui atteignirent 500 élèves en 1940. D’autres écoles publiques pour les jeunes filles musulmanes ont ouvert leurs portes à l’intérieur du pays: Nabeul, Sousse, Kairouan, etc. L’école de jeunes filles de la rue du Pacha ne tarda pas à faire le pendant du collège Sadiki qui dispensait aux garçons une instruction bilingue et qui fut la pépinière des cadres administratifs du pays. En 1945, l’établissement a été promu au rang de collège secondaire, les jeunes filles accédaient au baccalauréat qui leur ouvrit les portes de l’enseignement supérieur.
Au sein de l’école, l’évolution s’est poursuivie tout doucement mais sûrement, la jeune fille tunisienne maria sa civilisation aux idées modernes sans se défigurer, bien mieux elle participa à la vie politique, à la lutte nationale.
L’école de la rue du Pacha a contribué à la naissance de la première génération de militantes politiques et dirigeantes du mouvement des femmes. Par leurs luttes contre le colonialisme, contre la guerre et pour la paix, par leur solidarité avec les détenus politiques et les condamnés, elles ont prouvé à la société entière que celle-ci a autant besoin de ses hommes que de ses femmes.
En 1952 devant l’ampleur de l’agitation nationaliste: manifestations, grèves des élèves du collège de la rue du Pacha, les autorités coloniales nommaient une directrice tunisienne, Melle Zbeida Amira. Son nom reste gravé dans la mémoire des jeunes générations de la Tunisie indépendante. Elle dirigea le collège avec zèle et dévouement de 1952 à 1974. A l’aube de l’indépendance, la promulgation du Code du statut personnel fut l’une des premières réformes de la Tunisie moderne. Depuis, les bancs de l’école sont accessibles, la Tunisienne s’épanouit sur les plans social, culturel et politique. Elle accède à la vie publique: femme d’affaires, avocate, médecin, pilote... toujours en quête d’un avenir meilleur, elle poursuit sa route.
A l’école de la rue du Pacha, revient l’honneur d’avoir ouvert la première brèche.
Saloua Khaddar Zangar
Directeur de recherches I.N.P.
- Ecrire un commentaire
- Commenter

j ai fait toutes mes études secondaires dans ce lycée .melle AMIRA était notre directrice c était la belle époque : respect, dévouement et discipline. En 1971 une seule terminale sciences expérimentales dont je faisais partie ,2terminales lettres . le taux de reussite au bac était formidable et nos professeurs qui nous faisaient des cours de rattrapage gratuits étaient fiers de nous et des résultats . Parmi ces professeurs je cite mme BOUZAIDI leila en maths,mr ROMANE en physique mr MORITZ en sciences

(1).jpg)