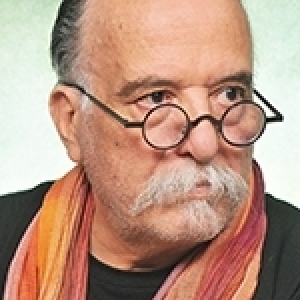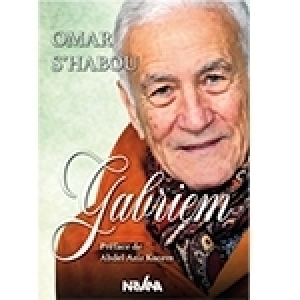Ali Douâji: La mort de l’oncle Bâkhir*

L’écrivain Ali Douâji (1909-1949) peut être considéré comme l’un des fondateurs majeurs de la nouvelle tunisienne, dans son art littéraire accompli. Parolier, esprit libre et bohème, ayant vécu la difficulté matérielle, lié au groupe «Sous la muraille», il se distingue dès l’entre-deux-guerres par son anti-conformisme et son ironie irrésistible, joignant critique sociale et regard attendri.
(1)
Il y avait dans le quartier où je suis né, un vieux vendeur d’eau qui s’appelait l’oncle Bâkhir. C’était un homme bon, pieux et nous ne lui avons point trouvé de faille, sauf qu’il était marginal en tout. Peut-être l’aimions-nous, nous les enfants du quartier, pour sa marginalité, qui soulevait notre curiosité et nous poussait à guetter tous ses mouvements.
Je disais : l’oncle Bâkhir travaillait comme vendeur d’eau. Il entrait dans toutes les maisons du quartier et y voyait toutes les femmes, en toute liberté : il fournissait de l’eau à l’une, empruntait un pilon à l’autre, demandait à une troisième de lui rapiécer un habit. Elles le recevaient, toutes, contentes et souriantes.
L’oncle Bâkhir était sympathique, hideux à voir, mais d’une hideur avec une beauté toute relative qui la rendait acceptable : un grand nez rond avec deux yeux rouges au-dessus, en-dessous desquels, une bouche large, une lèvre inférieure épaisse qui lui tombait au niveau du menton, sur l’ensemble, une couleur rayonnante et une teinte de bonne allure. Ce qui le rendait encore plus sympathique, c’est qu’il n’avait pas de malle à vêtements et portait tout ce qu’il achetait. Par exemple, tu le voyais portant un turban blanc, avec au-dessus, une écharpe rouge, enlaçant le tout d’une ficelle en fil sombre. A ses moments de repos, il portait à la fois la jebba, le burnous, la kachchabiya et la blouse, été comme hiver.
Nous le voyions à longueur de journée, soit à son travail, entre la fontaine et les maisons, soit, assis au seuil de la mosquée, louant Dieu, à basse et à haute voix. Quant à la nuit…
L’oncle Bâkhir habitait un dépôt que lui avait offert l’un des riches du quartier en échange d’attentions à un âne qu’il possédait. C’était un âne-réveil, je veux dire qu’il ne braillait qu’à une heure précise : à l’heure du coucher du soleil. A peine l’oncle Bâkhir entendait-il son compagnon braire qu’il retournait au dépôt, le fermait à clef, le verrouillait et commençait sa vie nocturne …
Après avoir fourni de l’eau nécessaire aux maisons du quartier, il se réservait les trois dernières outres. Je disais: se réserver, car tu vas voir à quel usage l’oncle Bâkhir va les consacrer. Il les versait toutes dans un grand baril. Nous, les enfants, l’espionnions d’une manière honteuse – nous ne savions que c’était un espionnage - mais nous le considérions comme une sorte de « spectacle » qui nous distrayait, ni plus, ni moins.
Dans la porte du dépôt, il y avait autant de trous que nous n’avions d’yeux. Nous l’apercevions, d’abord, manger ce que lui offrait généreusement le propriétaire, puis allumer autour de lui de nombreuses bougies, qui pouvaient atteindre, les jours de bien-être, dix ou plus…Il mettait les bougies allumées, par terre, autour du baril. Sur son bord, il posait une planche, sur laquelle il s’asseyait, les jambes dans l’eau, autour du cou, un chapelet à cent grains. Ensuite, il prenait sa flûte, qu’il caressait avec beaucoup de tendresse, en essuyant la poussière, la plaçait lentement et pieusement entre les lèvres et appliquait ses doigts sur les trous. Puis au nom de d’Allah, il disait : «J’ai l’intention de jouer le premier « targ » pour l’âme de ma mère et de mon père, qu’Allah les bénisse.» Ses airs sortaient et remplissaient l’atmosphère embaumée et illuminée par l’odeur des bougies et leur lumière. Et ainsi de suite, il poursuivait son jeu pour l’âme des saints et des marabouts…
Souvent les «faquihs» les jurisconsultes du quartier et l’imam de la mosquée lui interdisaient de jouer de la flûte et lui demandaient de cesser ces manières qui ne le rapprochaient pas de Dieu, mais il était indifférent à leur interdiction et répondait : «Je suis un homme simple et ignorant, je n’ai rien appris. Je suis allé à l’école coranique et l’ai quittée et n’y ai appris qu’à effacer les tablettes. Si Dieu n’accepte pas de moi mon jeu, ça ne nuira à personne. Que Dieu nous pardonne !» Puis il disait comme s’il s’adressait à lui-même:
«Peut-être que les anges bienfaisants m’élèveront le jour de ma mort vers le paradis…sur les airs d’une centaine de joueurs de flûte ou plus.»
Nous répondions, nous les enfants : «Peut-être»
Le pieux faqih demandait à Dieu de le protéger de notre méchanceté et de l’ignorance de l’oncle Bâkhir et disait:
«- Les anges déchus, eux-mêmes, ne feraient pas attention à la mort d’un pareil joueur de flûte ignorant, têtu et vaniteux.»
(2)
Tout le quartier fut triste le jour où personne ne vit l’oncle Bâkhir, ni devant la fontaine, ni devant la mosquée. Nous apprîmes par les femmes du quartier qu’il avait été atteint de paralysie des jambes et que l’homme riche, le propriétaire de l’âne fut bon envers lui. Il l’emmena chez lui et le confia à ses jeunes filles – qui étaient belles et pures- pour le soigner et veiller sur lui. Les trois jeunes filles le couvrirent de leurs bons soins, comme si elles s’occupaient d’un proche cher.
L’oncle Bâkhir mourut un soir de jeudi, au vingt-sixième jour de ramadhan, devant les filles, pendant qu’elles lui faisaient boire de l’eau de fleurs d’oranger avec leurs mains d’ivoire. Que Dieu lui pardonne!
Quant au faquih et l’imam de la mosquée, ils continuent à vivre avec les biens religieux, les biens des awqafs. Que Dieu allonge leur vie!
(3)
J’ai rencontré dernièrement l’un des camarades d’enfance qui nous accompagnait pour écouter l’oncle Bâkhir et nous nous sommes rappelés ces jours, les trous dans la porte du dépôt, les airs du vieux et ses bougies et je lui ai demandé:
- Qu’advint-il du dépôt?
Il répondit:
- Il fut loué par l’une des troupes musicales. As-tu vu plus étonnante coïncidence ? Vraiment, il n’y a pas à s’étonner de la volonté de Dieu.
Traduit de l’arabe par Tahar Bekri
* Nouvelle parue dans Al-Usbou’, 1946 ; reprise dans Sahirtu minhu al-layâli (Nuits blanches), MTE, 1969.
- Ecrire un commentaire
- Commenter