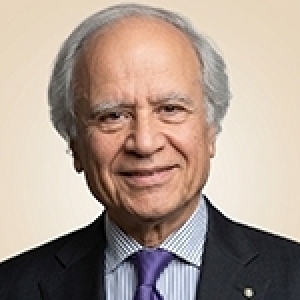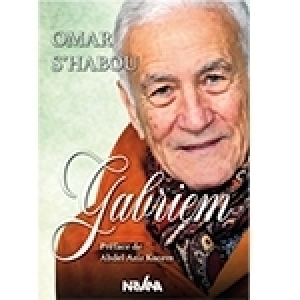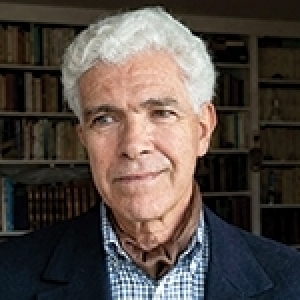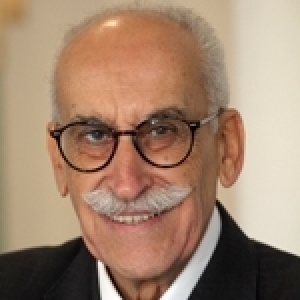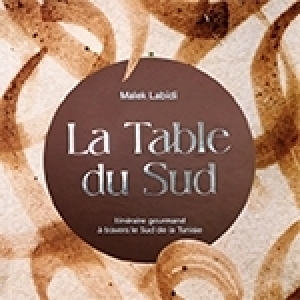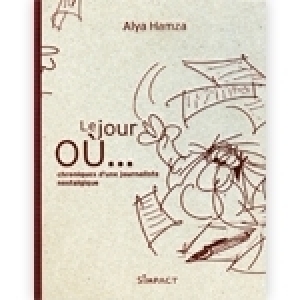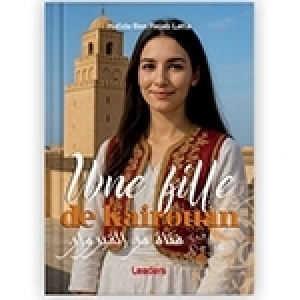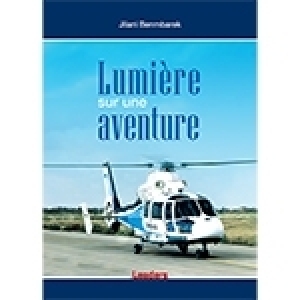Habib Touhami: Le refus du compromis et le paysage partisan tunisien

On ne connaît pas exactement le nombre de partis politiques tunisiens encore en activité. Ce qu’on sait est que ce nombre a littéralement explosé au lendemain de la « Révolution du jasmin », sous la pression parfois de la population tunisienne elle-même. Entre janvier et juillet 2011, 92 nouveaux partis politiques ont été créés, sans rapport aucun avec le nombre de familles de pensée existant dans le pays. L’adoption dans la foulée d’un mode de scrutin à la proportionnelle de liste aux législatives a encouragé une telle inflation partisane. De six partis légalisés avant le 14 Janvier 2011, on est vite passé à 100, puis à près de 250, nombre démesuré, même au regard des moyens humains mobilisables. Cela n’a pas empêché quelques-uns de le présenter comme un signe de bonne «santé démocratique». Ce n’était manifestement pas le cas, et la suite des évènements le démontrera.
En 2011, aucun des partis politiques n’était préparé à exercer le pouvoir dans un pays en ébullition, durement impacté par la crise mondiale de 2008. Tous avaient une culture de contestation, pas une culture de gouvernement. Ils ne connaissaient pas les dossiers et aucun n’avait de programme socioéconomique chiffré et crédible, hormis des feuillets rassemblés à la hâte et présentés aux électeurs comme un projet de gouvernement. Tous voulaient accéder au pouvoir, aucun n’était en mesure de l’exercer pleinement pour le bien commun. Tous ou presque étaient structurés selon le modèle du centralisme démocratique, celui-là même qui ne tolère aucune démocratie interne et dans lequel le sommet de la pyramide finit par élire la base. La série interminable de déstructuration-restructuration par laquelle est passé le paysage partisan en est l’illustration. En admettant que la clandestinité sous l’autoritarisme justifie ce type d’organisation, son maintien au-delà marque le peu de confiance que certains ont placé dans la réussite de l’expérience démocratique tunisienne.
A tout considérer, le refus de recourir au compromis pour régler les différends politiques, à l’intérieur et à l’extérieur des partis, explique ce à quoi ont abouti les rapports de force politiques en Tunisie après la «révolution». Pendant qu’en Tunisie le consensus politique est présenté comme la seule voie à suivre, il n’est question dans toutes les démocraties que de compromis. Même quand une frange est majoritaire à l’intérieur d’un parti, même quand un parti est dominant dans un parlement, le recours au compromis est privilégié. Ce n’est pas le cas en Tunisie où tous, responsables politiques comme simples citoyens, sont formatés pour ne pas percevoir le compromis comme «un accord pour régler les différends par conciliation ou par consentement obtenu par des concessions mutuelles», mais comme une faiblesse indigne, ou pire un maquignonnage honteux.
La configuration partisane actuelle est, peu ou prou, la conséquence de cette culture, ou plutôt de cette inculture. Aussi les partis politiques tunisiens n’ont-ils pas réussi à remplir leur mission fondamentale en démocratie: alimenter et entretenir le débat d’idées, faire de la pédagogie à la place de la propagande, user de la rationalité en politique, concourir à l’expression du suffrage universel. Il est vrai que le terrain ne s’y prêtait guère tant la société tunisienne est aussi victime de l’inculture du compromis. Aucun régime démocratique n’a jamais pu avancer et perdurer dans de telles conditions. Mais aucun régime démocratique n’a pu se consolider non plus sans la médiation et le concours de corps intermédiaires dont les partis politiques, à condition qu’ils soient représentatifs, affranchis de toute dépendance extérieure et entièrement dévoués à la Patrie et au bien public.
Habib Touhami
- Ecrire un commentaire
- Commenter