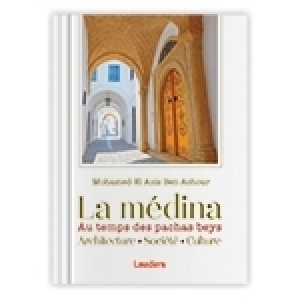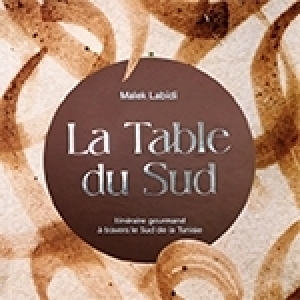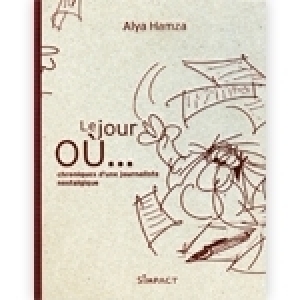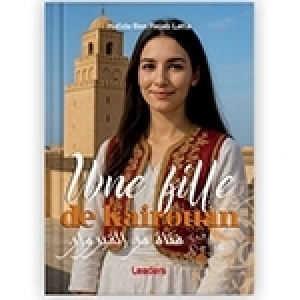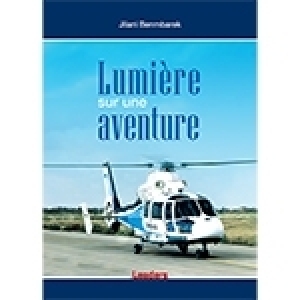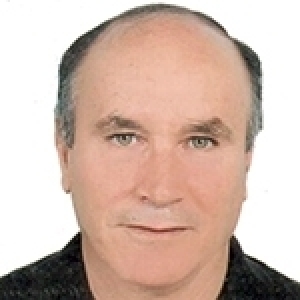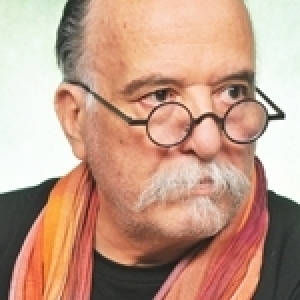La tyrannie du cerveau: grandeur et démesure de l’intelligence humaine
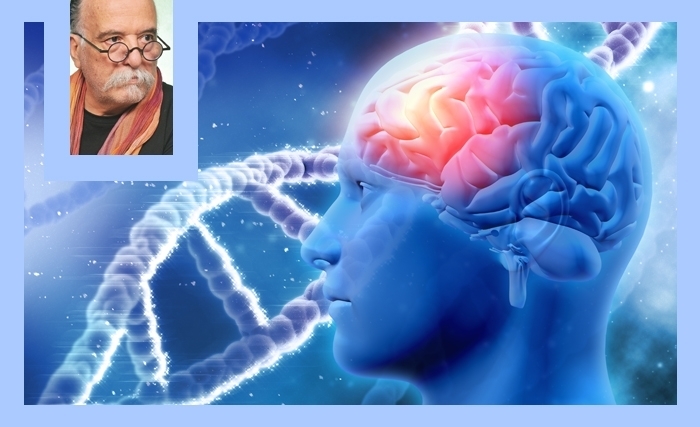
Par Zouhaïr Ben Amor
Introduction
L’humanité s’est imposée sur Terre non par sa force physique, ni par ses griffes ou ses crocs, mais par la puissance de son cerveau. Ce tissu nerveux replié dans la boîte crânienne a permis à Homo sapiens de dominer les autres espèces, de transformer son environnement, d’explorer l’espace et de décoder les lois fondamentales de l’univers. Ce «saut qualitatif» dans l’intelligence a radicalement différencié l’homme du reste du vivant. Mais cette ascension n’est pas sans conséquences: elle porte en elle les germes de la démesure, de la destruction, voire d’une forme de tyrannie exercée sur le monde. Nous nous proposons d’explorer cette intelligence humaine qui, par son éclat et ses excès, a transformé la Terre, pour le meilleur comme pour le pire.
I. L’intelligence humaine: une singularité biologique
Parmi les millions d’espèces ayant habité la Terre, l’humain a franchi un seuil évolutif inédit. Son cerveau — disproportionné par rapport à sa masse corporelle — s’est développé à une vitesse fulgurante. Doté de capacités symboliques, de langage articulé, de mémoire étendue, et surtout de conscience réflexive, l’homme a acquis la faculté de penser le monde, d’anticiper, de projeter, de créer.
L’historien Yuval Noah Harari rappelle que «l’apparition de la fiction a permis aux humains de coopérer à grande échelle. Ce qui les distingue, ce n’est pas l’intelligence pure, mais leur capacité à croire à des choses communes, même imaginaires» (Sapiens, 2011).
Ce n’est pas seulement l’intelligence pratique qui fait la différence, mais la capacité de penser sa propre pensée : la métacognition. L’humain sait qu’il sait. Cette boucle réflexive a permis la naissance de la philosophie, des sciences, des religions, de l’art. C’est aussi cette capacité qui fonde son sentiment de supériorité… et de solitude.
Georges Canguilhem, philosophe de la biologie, écrivait: «L’homme est le seul être capable de se poser comme malade de la nature, et donc d’en vouloir la maîtrise.» (Le Normal et le pathologique, 1943). La conscience de sa vulnérabilité a poussé l’homme à vouloir s’en affranchir.
II. L’espèce qui a façonné la planète
À la différence des autres espèces qui s’adaptent à leur milieu, l’homme a adapté le milieu à ses besoins. Agriculture, élevage, urbanisation, industrialisation: la Terre est devenue un artefact humain. Les paysages sont remodelés, les cycles naturels perturbés, les espèces domestiquées, déplacées, exterminées. L’homme est devenu le grand ingénieur de la biosphère.
Cette transformation du monde, selon Michel Foucault, relève de ce qu’il appelle la biopolitique: «une technologie du pouvoir qui prend pour cible la vie, la santé, les corps et les populations.» (Il faut défendre la société, 1976).
Les scientifiques parlent désormais d’Anthropocène pour désigner l’époque géologique actuelle, dominée par l’empreinte humaine. Le climat est modifié, les océans acidifiés, les forêts décimées, les ressources épuisées. Cette domination, jadis triomphale, devient inquiétante. L’homme est devenu si puissant qu’il menace les équilibres planétaires… et sa propre survie.
Le philosophe Hans Jonas, dans Le Principe responsabilité (1979), avertissait déjà: «Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur Terre.» Cette maxime inverse la logique prométhéenne de conquête pour y substituer celle de la précaution.
III. Avantages de cette suprématie cérébrale
Grâce à son intelligence, l’homme a allongé sa durée de vie, vaincu des maladies, amélioré ses conditions d’existence. Il a exploré les profondeurs de la mer et les confins de l’espace. Il a bâti des sociétés complexes, conçu des œuvres d’une beauté et d’une subtilité inégalées, et posé les bases d’une éthique universelle.
C’est cette intelligence qui a permis, selon Ernst Mayr, que «l’évolution humaine ne soit pas qu’un processus biologique, mais aussi culturel et historique» (This is Biology, 1997). L’homme n’est pas seulement un produit de la nature, mais un acteur de l’histoire.
Contrairement à la brutalité aveugle de la sélection naturelle, l’homme peut freiner ses pulsions, protéger les faibles, sauver les espèces en danger. Il est capable de compassion, de solidarité, de justice. Il peut aussi interroger ses propres actes, reconnaître ses erreurs, envisager des réformes. Cette conscience morale est peut-être son plus grand acquis.
C’est ce qu’espérait Spinoza, qui écrivait dans L’Éthique: «L’homme libre, c’est celui qui vit selon la raison.» La liberté n’est pas absence de contrainte, mais pouvoir d’agir en accord avec une conscience éclairée.
IV. Les revers de la médaille: la tyrannie cognitive
L’intelligence humaine ne connaît pas de limites naturelles. Elle transgresse, invente, dépasse sans cesse. Cette course au dépassement devient une hybris, une ivresse de la puissance. Or, en se croyant maître et possesseur de la nature (comme l’écrivait Descartes), l’homme s’est peu à peu détaché de son inscription biologique. Il vit hors sol, entouré de technologies, oublieux de ses dépendances fondamentales.
Cette critique, déjà formulée par Heidegger, alerte contre un monde devenu Gestell, une mise en réserve du réel au service de la technique. Le danger, selon lui, est que « la technique moderne n’est pas seulement un moyen, mais une manière de révéler le monde comme stock disponible » (La Question de la technique, 1954).
Le cerveau humain, capable d’optimisation, a inventé l’économie de marché, la finance, la production de masse. Mais cette logique de rentabilité a pour corollaire une exploitation sans fin des ressources, une marchandisation du vivant, une aliénation de l’homme lui-même. L’intelligence s’est parfois mise au service de la cupidité et de la domination.
Cette tyrannie n’est pas seulement externe. Elle devient aussi intérieure. L’homme moderne, saturé d’informations, soumis à des injonctions de performance, devient prisonnier de son propre cerveau. Troubles anxieux, burnout, dépressions… Le cerveau tyrannique, qui a dominé la Terre, se retourne contre le sujet qu’il habite.
V. Vers une sagesse du cerveau?
La lucidité consiste à reconnaître que l’intelligence humaine, si elle est un privilège, n’est pas une fin en soi. Elle doit s’inscrire dans une écologie du respect. L’homme n’est pas un sur-animal, mais un animal pensant, lié par une communauté de destin à tous les êtres vivants. Il lui faut apprendre à cohabiter, non à dominer.
Jakob von Uexküll, dans Mondes animaux et monde humain (1934), rappelle que chaque espèce perçoit le monde selon son Umwelt: son univers propre. L’humain doit apprendre à reconnaître la richesse de ces mondes non humains, au lieu de les soumettre à sa seule grille d’intelligibilité.
Le véritable défi de l’intelligence n’est pas de faire plus, mais de faire mieux. Moins de conquêtes, plus de soin. Moins de croissance, plus d’équilibre. Moins d’arrogance, plus de responsabilité. La grandeur de l’homme se mesurera à sa capacité de se décentrer, de se mettre au service du vivant, de redevenir gardien plutôt que tyran.
Conclusion
Le cerveau humain est sans doute le plus formidable produit de l’évolution. Il a permis à Homo sapiens d’émerger, de créer, d’organiser, de rêver. Mais en se posant en démiurge, en maître absolu de la planète, l’homme court le risque de se perdre dans sa propre puissance. La tyrannie du cerveau, c’est l’ombre portée de cette fulgurance évolutive. Pour que cette intelligence reste une chance et non une malédiction, il faudra y adjoindre une autre forme de grandeur: la sagesse.
Zouhaïr Ben Amor
Bibliographie indicative
• Harari, Yuval Noah. Sapiens. Une brève histoire de l’humanité. Albin Michel, 2015.
• Jonas, Hans. Le Principe responsabilité. Cerf, 1990 (éd. orig. 1979).
• Spinoza, Baruch. Éthique. Trad. Saisset, Livre IV et V.
• Foucault, Michel. Il faut défendre la société. Cours au Collège de France, 1976.
• Canguilhem, Georges. Le Normal et le pathologique. PUF, 1966 (éd. orig. 1943).
• Uexküll, Jakob von. Mondes animaux et monde humain. Rivages, 2010.
• Mayr, Ernst. This is Biology: The Science of the Living World. Harvard University Press, 1997.
• Heidegger, Martin. La Question de la technique. Gallimard, 1954.
- Ecrire un commentaire
- Commenter

"La sagesse" sera donc le sujet du prochaine article, aussi intéressant que les précédents !