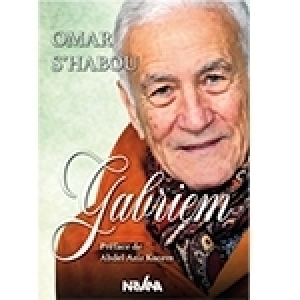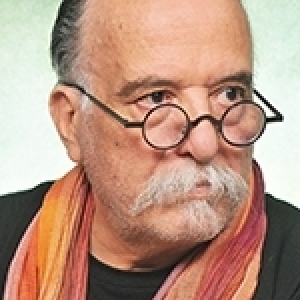Qu’est-ce que la politique ? en conférence inaugurale du Pr Hatem M’rad à la Faculté des sciences juridiques

Le thème ne pouvait être de plus grande actualité. Le professeur Hatem M’rad devait en effet donner une conférence inaugurale sous le thème de « Qu’est-ce que la politique ? », jeudi 12 septembre, à la faculté des sciences juridiques, politiques, et sociale de Tunis, à l’occasion de la rentrée universitaire.
Résumé
« Politique » est sans doute un des maîtres- mots de la pensée philosophique et de la science politique, le maître-mot de l’action du pouvoir et de l’Etat. « Politique » est même le maître-mot de la pensée et de l’action réunies, parce que ce concept préside à la définition de la Cité, à la conceptualisation des régimes politiques, à la symbolisation de la vie et de la sphère sociale, et indique les voies, les moyens et les modèles de communication à établir entre gouvernants et gouvernés.
La politique, on le sait, est l’invention des Grecs et des Etrusques (romains), et avant eux, peut-être, des Phéniciens, comme le relevait Moses Finley, qui ont vécu, eux aussi en cités, « mais que nous connaissons mal à travers leur propre langue ». En tout cas, comme la démocratie, la politique est supposée née en Grèce ancienne dans la cité, dans un monde violent, de luttes de classes entre les riches (aristocrates, patriciens) et les pauvres (plèbe), un monde qui a eu le génie d’inventer à partir du néant, plusieurs techniques de débat, d’action et de contrôle politiques. Elle est née sous la poussée des classes pauvres contre les injustices des aristocrates, avec l’appui des réformateurs, comme Clisthène ou Périclès. Des différents mots anglais qui définissent la « politique », c’est le terme politics (conflit) qui était le plus proche à la Grèce antique, et non le terme policy (programme d’action). C’est la raison pour laquelle le sujet politique par excellence en Grèce était la Justice, perçue en termes de choix ou de conflit entre le bien et le mal, le meilleur ou le pire. Une politique véritable, un Etat véritable était celui qui pouvait actionner, non pas une politique ou un programme déterminé, mais la justice dans la « polis », « cité », lieu de la vie « bonne », pour mettre un terme à des conflits politico-sociaux tenaces. Tout n’était pas bien entendu conflit et lutte dans la Grèce antique, il y avait aussi un consensus sur un petit nombre de questions, à partir desquels jugement politique et jugement moral se confondaient.
Il est certain que la politique a ses caractéristiques spécifiques et déterminantes, des traits permanents et non contingents, qu’on retrouve dans toutes les phases historiques, toutes les civilisations : qu’il s’agisse de l’autorité, du commandement, obéissance, valeurs, harmonie, intégration, coexistence, finalité commune, justice, puissance, sécurité, contrainte, représentation ; la politique a même un caractère ontologique, en ce qu’elle est une des activités vitales de l’existence humaine, sans lesquelles ni l’être humain (en tant qu’être social ayant besoin de la protection du groupe), ni la société (en tant que donnée et objet de la politique) ne seraient plus les mêmes. Il est non moins certain que la politique a fait l’objet d’innombrables définitions, des plus larges jusqu’aux plus restrictives, variables selon le contexte historique, la conception des philosophes. On peut dire qu’un des obstacles à la définition de la notion de « politique », au-delà des différentes philosophies et idéologies des auteurs, est son objet, ou plutôt la multiplicité de ses objets. William Connolly a relevé qu’un des problèmes de la théorie politique, c’est que le « politique » renvoie à plusieurs référents, qui n’ont pas forcément de rapports entre eux. Elle renvoie ainsi à la fois à la décision, à la justice, à la réduction des conflits et violence, à la mobilisation, à l’harmonie du groupe, au dialogue, à la prospérité, au débat public, etc.
En tout cas, la diversité des définitions de la politique, de la conception réaliste à la conception morale, en passant par les conceptions conventionnelles et empiriques ou stratégiques - parce que la politique est à la fois une théorie, un art, une activité, une action, un métier, une fonction -, n’excluent pas l’idée d’un « accord minimum » (J. Leca) chez les philosophes et les politistes, dans la définition du terme « politique ». La nécessité de réduire la violence, de pacifier la société, d’établir une justice, une harmonie sociale, sont des fonctions communes aux différentes sociétés humaines à travers l’histoire, et transculturelles, quelles que soient les traditions, religions et cultures spécifiques de ces sociétés. Donc la politique a des vocations diverses.
On peut regrouper en dernière analyse la politique autour de quatre éléments liés les uns aux autres : la politique est à la fois action politique, idée du bien, institutions régulatrices légitimes et homogénéisation.
La politique est d’abord action, parce qu’en partant des faits, des crises, des conflits, elle est confrontée à des choix, risques et appelle des décisions immédiates. On gouverne pour obtenir des résultats et pour en rendre compte à la nation. Max Weber n’a cessé de répéter dans Le savant et le politique que les vertus du politique étaient incompatibles avec celles du savant ou de l’homme d’études, même si la science qu’il conçoit est appelée à servir l’homme d’action, et même si l’acteur politique responsable doit tenter dans la mesure du possible de faire des choix raisonnables, prudents et modérés (Aristote, Kant, Weil, Aron) sous la pression des événements et des crises politiques et sociales. L’action ne se justifie pas seulement par l’action. La politique tente par la « sagesse » de parvenir à l’efficacité par la modération, consciente qu’elle ne peut parvenir à certains résultats dans l’action que parce qu’elle est consciente qu’elle est l’« art du possible ».
La politique est ensuite une idée du Bien. Très tôt, Aristote a soutenu l’idée que si l’homme est par nature un être social, il est appelé à vivre avec les autres. Mais, il ne s’agit pas seulement de « vivre ensemble », mais de « bien vivre ensemble », c’est-à-dire vivre dans le « bonheur public ». Une société sans vertus, sans éthique, est appelée à se désagréger (Ibn Khaldoun). D’ailleurs, dire que l’action politique tend au bien-être et à l’avantage de la communauté et aux individus, c’est dire qu’elle doit se situer dans une dimension morale, universelle. La politique est utile, parce qu’elle promet le bonheur à tous, parce qu’elle se veut non-égoïste (E. Weil), parce qu’elle se considère morale et universelle, tendant au Bien public, parce qu’elle balise la voie de la liberté. C’est en cela qu’elle peut être éducatrice et humaine. Si la politique ne saurait être réduite à un rapport de domination, c’est parce que la fin dernière de l’Etat, comme l’a bien vu Spinoza, c’est la liberté et non la crainte. De même pour Hannah Arendt qui dans The Human Condition, considère que la politique se pense à partir de l’expérience de la liberté se déroulant au sein de la polis. C’est dans ce sens qu’elle peut nous rendre meilleurs. Quoique pas toujours meilleurs, aux dires de certains utopistes libertariens, comme Jason Brennan. D’après lui, la politique « ne rend meilleurs ni ceux qui ne l’exercent ni ceux qui y participent ». Elle ne nous civilise pas, ne nous éduque pas, ne fait pas de nous des participants civiques. Ses finalités sont trahies, les délibérations ne font pas prévaloir le meilleur argument, les décisions ne sont pas prises par les meilleurs et les citoyens et les électeurs sont incompétents, ignorants et irrationnels. Un tableau loin d’être idyllique de la politique, partagé par certains libertariens. On est loin de l’idée du Bien et de la vertu préconisée par les Grecs. A vrai dire, pour J. Brennan, la politique est tout le contraire de ce qu’elle prétend être : « elle nous sépare, nous abrutit, nous corrompt et fait de nous des ennemis civiques ». A l’évidence les décalages ne sont pas inexistants entre les finalités de la politique et l’expérience des peuples. L’idée du Bien est souvent effectivement trahie par des régimes tyranniques, et même démocratiques. Cela ne remet pas en cause l’idée que la politique, incarnation de la symbolique d’une société, se prédestine au vouloir vivre collectif. Celui-ci suppose la diffusion parmi les individus de l’idée du Bien, de la Vertu, de la Liberté, qui normalement, constituent des valeurs communes susceptibles de cimenter la vie en société et la solidarité entre les individus. Cela n’écarte pas le fait que, sans triomphalisme démocratique, l’expérience de plusieurs sociétés démocratiques enracinées n’est pas trop éloignée de l’idée du Bien qu’elles tentent de faire prévaloir, tant bien que mal, contre les forces contraires, conformément à leurs chartes constitutionnelles et leurs valeurs de base.
La politique est encore institutions régulatrices légitimes. Elle est organisation institutionnelle. Aristote, Bodin, Locke, Montesquieu, Rousseau l’ont compris. Ces institutions légitimement acceptées sont appelées à relier l’action politique (nécessité de l’autorité publique) à l’idée du Bien (nécessité de l’éthique). Elles sont appelées d’une part à rationaliser l’irrationnel, à tenter de concilier le juste et l’efficace ; d’autre part à conférer une légitimité morale à la politique et à ses valeurs. C’est une des raisons pour lesquelles la définition des régimes politiques se trouve, d’après Aristote, au cœur de l’interrogation sur la politique. Les régimes sont classés non seulement par ordre formel, mais aussi par ordre philosophique, politique et moral. Les institutions ne sont pas seulement une forme, mais des systèmes relayant la politique à la morale par la légitimité des décisions. Kant, Hegel, puis, plus récemment Kelsen ont bien démontré comment institution, morale, histoire et droit sont entremêlés. La puissance et les limites de la raison humaine sont contenues dans l’aménagement institutionnel des pouvoirs, parce que la politique ne réalise la vérité de son concept que lorsqu’elle est médiatisée par les institutions et par le droit.
La politique est enfin homogénéisation. En effet, la politique est l’art des gouvernants ou de l’autorité de rendre homogène ce qui est hétérogène. Il ne s’agit pas d’une homogénéité absolue, comme celle qui a été exprimée par Carl Schmitt qui, dans la période nazie, est passée d’une identification nationale pure à une identification raciale redoutable, tendant à fusionner un Etat, un chef et un peuple, il s’agit plutôt d’efforts d’homogénéisation relative. L’homogénéisation est certes une nécessité d’ordre politique, mais soutenue par une homogénéité sociale, comme celle défendue par Herman Heller. Il ne s’agit pas d’une homogénéisation idéologique fondant la diversité et les individualités dans un même moule. L’idée d’homogénéisation est une idée de cohésion, et non d’absorption. L’effort de cohésion ou d’homogénéisation est d’autant plus nécessaire qu’il réduit les conflits sociaux et politiques, même s’il lui est difficile de les éliminer définitivement, essaye d’intégrer les individus et les groupes en marge de la société, et cherche en définitive à pacifier la société. La politique est conflit, conflit incontournable, mais aussi pacification par l’homogénéité sociale. L’homogénéisation politique et sociale exprime une des fonctions de l’Etat ou du pouvoir, qui est d’assurer l’unité politique d’une nation, d’un Etat. Toutefois, un Etat en quête d’unité ne peut tout homogénéiser sous peine de se confondre avec la contrainte. Inversement, un Etat marqué par une hétérogénéité excessive des groupes, des classes, des différentes catégories sociales et professionnelles pourrait être remis en question en permanence, favoriser les conflits, sauf si les écarts entre les uns et les autres, sur le plan politique, économique, social, éducatif, ne sont pas surdimensionnés. Lorsque ces décalages sont excessifs, les groupes en marge, non « socialisés » ou non homogénéisés, se sentiraient non « reconnus », dans une « société du mépris », et demeurent potentiellement en état de rébellion ou de révolte, parce que non intégrés, non homogénéisés. L’hétérogénéité politique est nécessaire à la démocratie, mais le pluralisme des valeurs suppose une homogénéité sociale de base, à même de garantir le fonctionnement libre du pluralisme des valeurs. John Rawls l’a bien compris.
Lire aussi
- Ecrire un commentaire
- Commenter