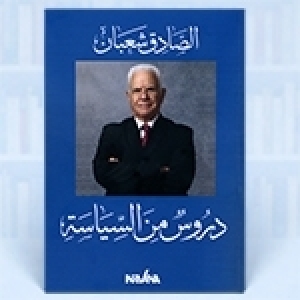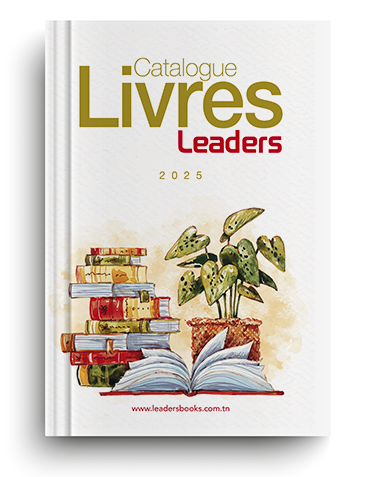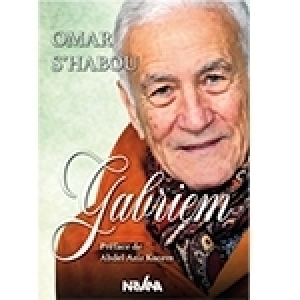Pr Samir Allal - La COP 28 : Raison et scepticisme

La COP 28 ouvre prochainement ses portes à Dubai [aux Émirats arabes unis, du 30 novembre au 12 décembre], l’une des économies les plus dépendantes de l’extraction de pétrole.
Une COP sans importance, une simple occasion pour faire le point sur le désastre en marche et de multiplier les opérations de greenwashing [Faut-il aller à la COP 28? Organiser une conférence sur le climat à Dubaï, une opération de greenwashing.]. Le constat est plutôt amer : le désastre est en marche et l’avenir n’est pas mieux.
Le récent rapport du Programme des Nations Unis pour l’environnement (UNEP), basé sur les objectifs affichés par les grands producteurs d’énergie fossile, est alarmant. Il prévoit une hausse de la production de pétrole et de gaz naturel, au moins jusqu’en 2050.
Dans un contexte d’aggravation des crises, la guerre en Palestine et en Ukraine, souligne l’urgence de s’éloigner des combustibles fossiles. L’épineuse question du rythme de sortie du pétrole et du gaz d’origine fossile sera au cœur des débats à Dubaï.
Que peut-on attendre de cette conférence ? Pas grand-chose : les compagnies pétrolières y seront très présentes, souvent intégrées dans les délégations nationales et veilleront au grain.
On y fera de belles déclarations. On se contentera de murmurer qu’on pourrait ramener la hausse de température de 2,9 à 2,5 °C et, signe d’impuissance absolue, on insistera sur la nécessité de se préparer au pire, et de prévoir des mesures de compensation des catastrophes inévitables à venir. (Jacques Attali)
Presque personne ne dira qu’il faudrait aller bien plus loin qu’un simple remplacement d’une source d’énergie par une autre, et qu’il faudrait changer radicalement notre mode de développement et lutter contre les inégalités.
Les crises de l’inégalité et de la biosphère s’entremêlent. La montée des inégalités étant tout à la fois l’une des causes et l’une des conséquences de la dégradation des conditions d’habitabilité de la planète.
« Toutes choses étant causées et causantes, médiates et immédiates, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes » écrivait Pascal, un génie polyvalent.
Cette phrase de Pascal, perdue dans les éditions des Pensées et souvent ignorée, exprime l'exigence primordiale de toute connaissance pertinente, laquelle ne peut que relier ce qui est séparé ou disjoint.
Elle dépasse le principe analytique de connaissance qui est celui de Descartes dans son Discours de la méthode : « Diviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. »
Dénicher par Edgar Morin, Cette longue phrase de Pascal, suppose une méthode « méta cartésienne » qui oppose « au principe de division un principe de reliance ».
Pour Edgar Morin ce principe de « reliance » permet de « considérer ce qui est à la fois causé et causant comme tout événement historique qui est causé par un processus et cause un nouveau processus, comme dans toute rétroaction où l'effet rétroagit sur la cause et devient lui-même causant ».
Le « principe de reliance pascalien » est le fondement même de ce que Edgar Morin appelle connaissance et pensée complexe.
Crise des inégalités et crise environnementale sont étroitement liées : (re)penser les limites sociales et écologiques de la croissance
Nous connaissons déjà l’idée de limites écologiques de la croissance. Comprendre le caractère « indécent » de la surconsommation, pour mieux la penser, permet en miroir de mieux appréhender les limites sociales de la croissance, et d’enrichir l’analyse des inégalités.
Les inégalités se retrouvent même chez les pollueurs. Les 1% les plus riches de la planète émettent autant de gaz à effet de serre que les deux tiers de la population la plus pauvre, soit environ cinq milliards de personnes, selon un rapport de l'Oxfam.
Si la lutte contre le changement climatique est un défi commun, certains en sont plus responsables que d'autres et les politiques gouvernementales doivent être adaptées en conséquence.
Entre 1980 et 2016, les 1 % les plus riches au niveau mondial ont capté 27 % de la croissance. Globalement, on peut donc dire que « Le quart du travail que nous accomplissons, le quart de toutes les ressources que nous extrayons et de tout le CO2 que nous émettons servent à enrichir les plus riches ». Ces chiffres donnés par Jason Hickel illustrent parfaitement la situation plus que préoccupante.
Une transition juste et cohérente implique de corriger ces inégalités avec une capacité renforcée des acteurs publics d’investir là où nécessité et rentabilité ne vont pas nécessairement de pair.
On ne réglera pas la crise du climat si on ne règle pas la crise de la désinformation. Loin d’être façonnés par nos « préférences », nous dépendons de notre environnement technique et social. Il n’y a pas que la technologie disponible dans la société pour décarboner l’économie.
Les rapports sociaux qui s’y développent et dans lesquels les individus deviennent des êtres humains sont encore plus importants. Un tel constat incite à réinterroger tant les limites écologiques et planétaires de la croissance que ses limites sociales.
Les limites planétaires sont maintenant bien identifiées depuis les travaux des chercheurs suédois du Stockholm Resilience Centre en 2009.
On sait que depuis mai 2022, ce sont six limites planétaires qui sont franchies sur les neuf mises en évidence (le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, le cycle de phosphore et d’azote, les changements d’utilisation des sols et enfin le cycle d’eau douce verte).
Le concept de « limites sociales de la croissance » est moins usité. L’imbrication des questions environnementales et sociales pourrait alors se comprendre comme justifiant une réflexion sur l’indécence de certains « besoins » et de la « surconsommation », question délaissée par la science économique dominante.
Le « limitarianisme éthique et politique » propose des perspectives intéressantes pour gagner en décence et lutter contre les limites tant écologiques que sociales de la croissance.
Selon Hirsch, les conséquences de ces « limites sociales de la croissance » sont potentiellement énormes et dévastatrices quant au mode de fonctionnement actuel de nos économies.
Dans le monde non-idéal tel que nous le connaissons, plusieurs circonstances peuvent justifier le « limitarianisme instrumental » : la persistance d’une grande pauvreté (dans les pays « pauvres » et/ou au sein de certains pays riches) que des ressources financières pourraient faire disparaître, ou encore l’existence de problèmes urgents d’action collective (mondiale) pouvant partiellement être résolus par les gouvernements s’ils avaient les ressources financières nécessaires.
On pense ici évidemment à la crise écologique et au changement climatique et aux débats qui vont s’ouvrir à la prochaine COP.
Les implications du « limitarianisme instrumental » sont nombreuses et complexes, notamment en termes de politiques publiques et fiscales.
Une politique publique s’inscrit dans le « limitarianisme » si son objectif est de mettre en place des structures empêchant l’apparition de richesses « excédentaires ».
Robeyns se prononce en faveur d’une « taxe de crise écologique mondiale », sur les super-riches, afin de financer des fonds d’action pour le climat.
Ainsi, « Le limitarianisme peut contribuer à esquisser une vision d’un monde à la fois moins injuste et écologiquement plus durable ». (Delphine Pouchain, AOC 2023).
Ces réflexions évoquées par Delphine Pouchain, rejoignent des questions explicitement posées dans le rapport Meadows, mais auxquelles les économistes continuent de refuser de se confronter :
• « Croissance de quoi ? Pour qui ? A quel prix ? Financée par qui ?
• De quel type de besoin parle-t-on vraiment et quel est le moyen le plus direct et le plus efficient de le satisfaire pour ceux qui ressentent ce besoin ?
• Comment déterminer ce qui est suffisant ? Quelles obligations avons-nous de partager ? ».
On sous-estime souvent le coût de la transition écologique et sociale et on surestime la capacité de financement
A l’échelle mondiale : l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) estime autour de 5000 Mds $ (4,5 points de PIB) le besoin annuel total d’investissements dans le système énergétique.
L’UNFCCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) estime en cumulé d’ici à 2050 que l’on va avoir besoin d’investir dans la décarbonation 125000 Mds $.
Si ces chiffres peuvent impressionner, en réalité ce sont des estimations à minima car il n’est question dans ces estimations que de transition climatique ou de transition énergétique, mais pas de transition écologique au sens complet, en y intégrant la biodiversité et la pollution.
Il existe désormais de nombreuses estimations des volumes d’investissements nécessaires pour mener la transition écologique et énergétique, à différentes échelles : nationale, voire mondiale. Toutefois, l’éventail reste assez large : le manque d’investissements est estimé entre 2 et 5 points de PIB.
À vrai dire, les comparaisons ne sont pas si simples à établir, pour diverses raisons : le périmètre sectoriel varie d’une estimation à l’autre, les scénarios de transition aussi (certains mettant l’accent sur le progrès technique, d’autres sur la sobriété) et c’est aussi le type de transition considérée qui fait bien entendu varier l’estimation du besoin : transition énergétique, climatique, écologique (en y intégrant la biodiversité).
Plus on accorde d’importance à la préservation de la biodiversité et à celle de la justice, de l’équité, et plus il faut consentir à des dépenses, pour beaucoup sans retour financier.
C’est souvent un point aveugle des estimations, qui font comme si tous les investissements à réaliser étaient rentables et n’identifient pas la part d’investissements nécessaires mais non rentables. (Institut Veblen)
On sous-estime souvent, le coût de la transition (et on surestime la capacité de financement) en supposant que le vert remplace instantanément le carboné alors que pendant un certain temps il s’y ajoute : par exemple, on compte 1740 Mds $ d’investissements dans les énergies renouvelables en 2023 au niveau mondial, qui viennent s’ajouter à 1050 Mds $ d’investissements dans les sources fossiles.
Les investissements verts mettent du temps à remplacer les investissements carbonés. Pendant un temps plus ou moins long, ils s’y ajoutent. Il ne faut surtout pas sous-estimer le poids d’inertie.
Si les investissements rentables (les projets présentant un profil risque-rentabilité suffisant pour intéresser les investisseurs privés, souvent grâce au soutien public initial) peuvent être financés par des fonds privés, ce n’est bien sûr pas le cas des investissements non rentables (dépenses d’infrastructure, restauration de la biodiversité, dépenses d’accompagnement pour une transition juste), qui ne peuvent être financés qu’au moyen de fonds publics.
Cette distinction permet de comprendre pourquoi les actifs privés ne se dirigent pas suffisamment vite vers la transition. L’engagement qui a été pris lors de la COP21 d’aligner les flux financiers « compatibles avec une trajectoire menant à la baisse des émissions des gaz à effet de serre et un développement soutenable » est encore très loin d’être tenu.
Le secteur public doit jouer un rôle clef dans le financement de la transition écologique.
D’abord, nous avons besoin d’un véritable policy-mix climatique, écologique, avec des politiques monétaires et de stabilité financière résolument tournées vers la transition écologique combinées à une politique budgétaire également tournée vers la réalisation des investissements publics et des dépenses publiques indispensables à la transition.
Ensuite, concernant plus spécifiquement les investissements, les fonds publics sont nécessaires à plus d’un titre : ils sont parfois indispensables pour amorcer certains investissements privés.
Le secteur des énergies renouvelables a été rendu viable par des subventions publiques ; Ensuite, certaines transformations sectorielles sont inenvisageables sans une grande part de fonds publics.
Les fonds publics sont absolument indispensables à la réalisation de nombreuse dépenses non rentables : des dépenses de rénovation des ménages modestes, dépenses de désartificialisation des sols, de dépollution des eaux, de grandes infrastructure ferroviaires, reboisement, etc. indispensables et sans perspective de retour financier même à long terme.
S’il n’y a pas de financement public de ces dépenses indispensables non rentables, alors celles-ci ne verront pas le jour parce que les fonds privés n’iront évidemment pas les financer ! La transition sera alors tronquée, injuste.
Pénaliser l’orientation vers le carboné et encourager celle vers le vert: les autorités publiques avancent à pas de fourmis, alors qu’il y a urgence!
Les investissements et les désinvestissements ne sont pas indépendants les uns des autres mais le plus souvent liés entre eux. Il faut pénaliser le carboné et encourager vers le vert.
Un exemple avec les transports : il faut d’abord investir dans les transports en commun pour désinvestir dans la voiture individuelle. D’abord investir dans les infrastructures pour développer les transports en commun. Les investissements publics sont un préalable indispensable.
Par ailleurs, Il y a un énorme poids d’inertie au bilan des banques et des institutions financières dont les bilans sont remplis d’actifs carbonés.
Ces bilans carbonés sont exposés au risque de transition (perte de valeur des actifs détenus si on avance vite dans la transition), soumettant les autorités publiques à un arbitrage entre d’un côté les pertes que peut induire le dérèglement climatique au bilan des banques et de l’autre celles que provoquerait une transition trop rapide : résultat, les autorités publiques avancent à pas de fourmis, alors qu’il y a urgence !
Dans tous les cas, il faut parvenir à mobiliser beaucoup de fonds privés et publics pour réaliser les investissements et dépenses nécessaires à la transition écologique et mener des politiques publiques volontaristes pour réorienter les fonds privés vers le vert et les détourner du carbonés.
Cependant : il ne faut pas sous-estimer la difficulté et la lenteur de cette réorientation à supposer même que l’on parvienne, à réorienter les fonds privés vers les investissements verts nécessaires.
Il ne faut surtout pas réduire le problème de financement de la transition à la question de l’orientation, car les fonds privés quoi qu’il arrive n’iront que vers du « vert rentable ».
Plus fondamentalement, il ne faut pas s’étonner que les flux financiers privés aillent vers les objectifs de rentabilité. Tant que des investissements carbonés rentables existent, les flux financiers privés iront vers du carboné rentable.
Il y a très clairement un problème d’orientation des flux financiers privés. Les politiques publiques ont un rôle majeur à jouer pour corriger cette mauvaise orientation : pour le moment rien de contraignant.
Il serait illusoire de compter sur la dynamique du marché et le comportement volontariste des acteurs pour rapprocher l’échéance du pic
Sur le plan économique, sortir des énergies fossiles implique de désinvestir en retirant ou convertissant les actifs carbonés. Le désinvestissement n’est pas amorcé.
Des signaux récents suggèrent même qu’on marche à contresens : engagement à grande échelle des majors américaines (ExxonMobil et Chevron) dans les pétroles de schiste ; distribution de nouveaux permis d’exploration en mer du Nord ; investissements massifs dans les infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL)…
La raison première de ces projets élargissant la capacité d’offre en hydrocarbures est basique. Leur rentabilité est élevée à court terme, du fait du prix du pétrole et du gaz sur les marchés internationaux.
Il serait illusoire de compter sur la dynamique du marché et le comportement volontariste des acteurs pour rapprocher l’échéance du pic.
Pour limiter le réchauffement global en dessous de 2 °C, il faut dépasser d’ici 2030 le pic des émissions provenant de l’usage de ces énergies fossiles et le faire dès maintenant pour viser 1,5 °C.
Si ces échéances ne sont pas respectées, les grandes déclarations à la COP 28 sur la neutralité en 2050 ou même 2060 resteront lettre morte. Il faut donc changer les règles du jeu économique pour hâter le désinvestissement dans le pétrole et le gaz.
Les investissements rentables (comme les ENR) peuvent être financés par des fonds privés, ce n’est bien sûr pas le cas des investissements non rentables (dépenses d’infrastructure, d’accompagnement pour une transition juste,..).
Les investissements non rentables mais bons pour le climat, ne peuvent être financés qu’au moyen de fonds publics ou un mix de fonds privés/fonds publics (avec prépondérance de fonds publics).
Le meilleur outil pour le faire serait d’introduire un prix du carbone sur toutes les émissions mondiales de carbone fossile.
Comme lors des chocs pétroliers, cela renchérirait l’usage des énergies pétro-gazières et freinerait leur consommation. Mais contrairement au libre jeu du marché, les recettes additionnelles n’iraient plus élargir la rente des producteurs.
Elles seraient prélevées par les États, pourraient être redistribuées vers les pays moins avancés et utilisées pour accélérer l’investissement dans le bas carbone et assurer l’accès à l’énergie des plus vulnérables.
La probabilité pour qu’un tel système soit adopté à la COP de Dubai est voisine de zéro ! La taxation du carbone n’a pas bonne presse chez les politiques, particulièrement chez ceux qui dirigent les économies rentières.
La clé de la baisse des émissions est bien dans le désinvestissement des actifs carbonés. Alors que le changement climatique ne cesse de s’amplifier, les entreprises promettent de développer la technologie du captage de carbone et le climato scepticisme continue de prospérer.
Rassemblés au sein de lobbys tout-puissants et parfois concurrents, ces entreprises de « l’économie de la mort » font bloc pour entraver la lutte contre le réchauffement climatique.
En usant des mêmes méthodes : mobiliser des experts (et des chercheurs) dont la mission est de semer le doute ; financer des associations, des fondations, aux doux noms, comme l’Americans for Prosperity ou Clean Skies ; cibler les politiques élus dans des États très dépendants des hydrocarbures, …
L’accord trouvé en amont des négociations n’augure rien de bon pour la suite des discussions. La COP 28, (présidée par le Sultan al-Jaber, PDG du géant pétrolier ADNOC, la principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis), exacerbe la colère avant même de démarrer.
Les pays du Sud restent majoritairement, dubitatifs quant à la sincérité de l’engagement des pays du Nord
La question de la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud face au changement climatique sera l’un des grands sujets discutés lors de cette COP (avec la transition énergétique et le bilan de l’Accord de Paris). Le mécanisme de « pertes et dommages » n’est toujours pas opérationnel.
Les pays du Sud restent majoritairement, dubitatifs quant à la sincérité de l’engagement des pays du Nord. En 2009, ces derniers avaient promis 100 milliards de dollars par an, pour les aider à lutter face au changement climatique. Cet objectif n’a pas été atteint une seule fois depuis.
Les résultats de ces sommets annuels sont très mitigés. On se donne des objectifs de baisse d’émissions à long terme, sans parler sérieusement des moyens à mettre en œuvre pour faire baisser les émissions : évolution des bouquets énergétiques, sortie des énergies fossiles, problèmes technologiques…
Les pays vulnérables, les scientifiques et la société civile, commencent à perdre espoir.
L’an dernier, la COP 27 a fait un petit pas à ce sujet : les 196 pays réunis en Égypte avaient validé le principe d’un fonds sur les « pertes et dommages ». Les parties avaient alors reconnu que les pays du Nord étaient majoritairement responsables du dérèglement climatique.
Ce fonds doit donc permettre d’aider les pays du Sud à faire face aux événements météorologiques extrêmes, puisque les effets du dérèglement les touchent en premier lieu. Il doit aussi les aider à faire face à des problématiques de long terme, telle que la sécheresse ou la montée du niveau de la mer.
Or, l’accord négocié en amont de cette COP 28 « ne satisfait personne, ni les pays du Nord, ni les pays du Sud ». S’il a été accepté par les parties, précise Lola Vallejo, directrice du programme climat à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), « c’est avant tout pour éviter une copie blanche et que les discussions ne repartent de zéro à Dubaï ».
En effet, le texte de préparation n’est pas contraignant pour les pays du Nord : « Les pays développés sont “exhortés” et les pays en développement “encouragés” à contribuer au Fonds ».
Plusieurs hypothèses sont sur la table, comme des taxes sur le transport maritime, l’aérien ou les industries fossiles, ou encore une taxe sur les transactions financières.
Plus fondamentalement, Le financement de la transition non rentable est malheureusement systématiquement sous mesurée dans les estimations et un angle mort dans les négociations.
Un ordre de grandeur concernant la part des investissements non rentables est celui d’un cabinet de consulting (McKinsey & Company, juillet 2021), qui estimait que 50% des 1000 mds d’investissement nécessaires au niveau européen ne présentaient pas des perspectives de rentabilité suffisante, (probablement beaucoup plus pour les pays vulnérables).
Et ce dans un périmètre très restreint puisque réduit à la transition climatique, sans prendre en compte les dépenses de réparation de la nature, de dépollution, ainsi les aides pour que tous les pays, tous les ménages accèdent à la transition.
La question est de savoir comment mobiliser suffisamment de fonds pour le climat. Un recours massif à l’endettement risque de buter sur la contrainte de soutenabilité de la dette et d’exposer les États aux pressions du marché.
Et puis surtout, la dette est un instrument financier adapté aux investissements qui engendre un retour financier, pas aux dépenses sans retour financier.
Une solution intéressante à examiner semble être une création de monnaie centrale sans dette, affectée au financement de réalisations non rentables sans retour financier mais indispensables humainement, socialement, écologiquement.
Via des sociétés financières publiques à mission chargées d’allouer des subventions à des projets éligibles socialement ou écologiquement indispensables.
Quoi qu’il en soit, une transition non tronquée et juste implique d’être en capacité de réaliser des dépenses sans retour financier, alors même que notre système n’est guère conçu pour rendre possible le non rentable.
La COP 28 va elle nous mobiliser pour nous débarrasser au plus vite de cette « économie de la mort » ? Je crains que, non. On continuera de foncer vers la catastrophe, en regardant ailleurs… Au lieu de trouver de nouvelles sources de financement, pour construire un monde plus inclusif et plus durable.
Nous préférons (hélas !!!) poursuivre indéfiniment notre course. Ce qui nous détournera des vraies questions et des défis de complexités que nous lance le monde où nous vivons… Comme j’aimerais avoir tort !
Je termine cet article par une autre citation de Pascal « l’erreur n’est pas le contraire de la vérité, elle est l’oubli de la vérité contraire ». Le contraire d’une vérité n’est pas nécessairement une erreur.
Pr Samir Allal
Université de Versailles/Paris-Saclay
- Ecrire un commentaire
- Commenter