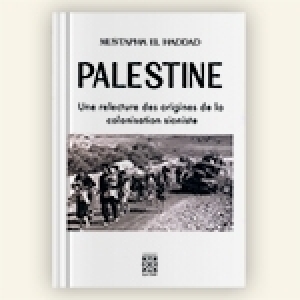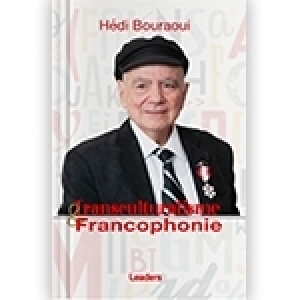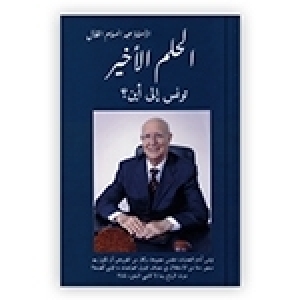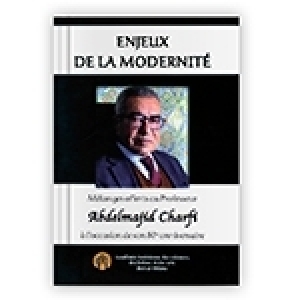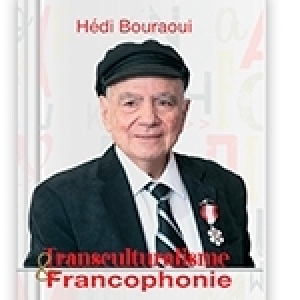Un roman de Zoubeida Khaldi - «J’ai oublié d’aimer»: Un cri qui n’en finit plus...

«J’ai oublié d’aimer» est une œuvre de fiction inspirée d’un fait divers survenu en Tunisie en 2021. Sous l’emprise d’une peur-panique, une fille-mère tue son nouveau-né.
Un fait non rare mais bouleversant malgré sa récurrence ou plutôt par sa récurrence qui inquiète. Qui interroge.
Ce roman se penche sur l’engrenage qui mène vers ce genre de tragédie. Il donne voix à la mère et ranime le bébé qui tient à savoir pourquoi celle qui lui a donné la vie, lui a donné la mort.
J’ai choisi de parer l’héroïne, Sabra, de nombreuses qualités pour tenter de la protéger d’elle-même et des autres. Oui, j’ai mis toutes les chances de son côté pour qu’elle puisse se tirer d’affaire en cas de besoin.
Sabra est vive d’esprit, cultivée, droite et sage quoique ayant un grain de folie, croyante, mais quelque peu révoltée, rêveuse, rieuse, ambitieuse, amoureuse de la vie, en quête d’un bel amour et de complicité. Au départ, elle a des rêves immenses.
Mais ni son niveau moral, ni son niveau intellectuel ne pourront l’empêcher de se brûler les ailes et de se retrouver dans la peau d’un assassin.
Il aura suffi d’une série de petits hasards pour que Sabra ne se ressemble plus, pour qu’elle ne soit plus la promesse qu’elle était. Après le paradis, l’enfer.
Suite à cette traversée avec cette jeune fille si apte, au départ, pour affronter la vie, l’on peut dire aisément que ce qui lui est arrivé peut arriver à n’importe qui.
Ce roman est en fait l’histoire de la fragilité humaine, fragilité souvent aggravée par une action de fragilisation méthodique et ininterrompue exercée par notre société sur la femme, notamment. Un vrai travail de sape de la personnalité féminine. L’enseignement de peurs excessives a toujours été de mise chez nous et même de rigueur. Faut que la peur soit dans le biberon: Postulat de base de l’éducation de nos filles.
Et ces peurs rendent les fillettes craintives. Elles les séparent d’elles-mêmes, les empêchent de grandir. Elles ne les aident pas à se défendre parce qu’elles fracturent la personnalité et obscurcissent le mental.
Et c’est toujours la mère qui se charge du sale boulot qui consiste à traumatiser sa fille à fond. Dans le roman, Imen adore Sabra, son unique enfant mais étant convaincue que la peur est une arme et un vaccin, elle fait tout pour lui transmettre une peur géante et mutilante. «Après m’avoir fait téter son sein, elle m’avait fait téter la peur» dit Sabra.
Perdre son honneur était l’angoisse permanente qui déséquilibrait la fillette jusqu’à rendre sa démarche bancale. A un moment donné, elle s’était mise à marcher à petits pas comme un canard pour ne pas laisser tomber en chemin son hymen, ce trésor public/privé représentant l’honneur.
Selon la mère, la peur et la méfiance sont des talismans. Mais Sabra dira plus tard: «la peur avait foré en moi un puits dans lequel je m’étais noyée».
On la voit souvent se rebiffer, tenter de résister au système. Mais malgré sa révolte, notre héroïne n’échappe pas à ce conditionnement et à ce processus de culpabilisation qui continue de sévir.
«Dès que j’ai aimé, dit Sabra, et malgré mon côté rebelle, la culpabilité m’a tout de suite habitée. Flottante, diffuse, sans objet défini, elle était là, à attendre patiemment la faute...»
Ce roman est une danse fatale avec la peur. On plutôt un duel. L’affrontement d’un corps et d’une société. «Se connaît-on tant qu’on n’a pas connu la peur, cette arme de destruction massive, cette tumeur qui ronge, aveugle, paralyse, anéantit?»
Et n’est-ce pas à cause de cette peur que Sabra va vers l’interdit? Parce que la peur mène à la confusion, voire à la témérité, parce que trop de peur tue la peur, Sabra qui avait tant peur de perdre son honneur, dans un vertige, commet le péché de la chair.
Une fois les jeux faits, l’on voit Sabra, la damnée et la martyre se poser toutes sortes de questions sur le bien et le mal, le destin et le libre-arbitre, sur les jeux du hasard et de l’amour, sur la violence du déterminisme social et des scolioses éducationnelles, sur la duplicité des hommes, l’hypocrisie sociale etc.
L’on se demande, en fin de compte, qui, en réalité, a oublié d’aimer. Est-ce Sabra? N’est-ce pas plutôt la société tout entière qui a oublié d’aimer?
«J’ai oublié d’aimer» est un cri de désarroi qui se répète, qui n’en finit plus. A quand une société moins endolorie et plus équilibrée qui n’oublie pas d’aimer?
J’avoue avoir écrit ce roman par solidarité.
Zoubeida Khaldi
- Ecrire un commentaire
- Commenter

...un livre émouvant