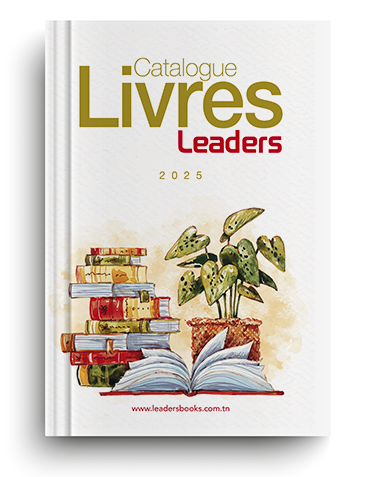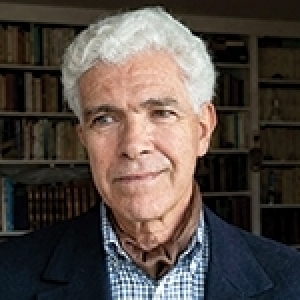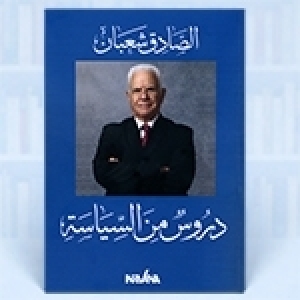Ammar Mahjoubi: Despotisme et tyrannie à l'époque romaine

.jpg) Deux définitions du despotisme reviennent sans cesse dans la littérature antique : le despotisme est un régime arbitraire qui ne connaît pas de loi, affirment certains textes, alors que pour d’autres, le despote gouverne égoïstement dans son seul intérêt. Mais qu’est-ce qui l’empêcherait de traduire l’oppression gratuite en corps de loi, de devenir un despote légaliste ? Car, de toute façon, il ne peut gouverner sans assurer l’ordre public, et son pouvoir serait celui d’un vulgaire bandit s’il ne faisait pas de la politique, s’il ne prenait pas les mesures favorables à certains intérêts matériels qui ne concerneraient pas seulement les siens, tout en se préoccupant constamment de son maintien au pouvoir.
Deux définitions du despotisme reviennent sans cesse dans la littérature antique : le despotisme est un régime arbitraire qui ne connaît pas de loi, affirment certains textes, alors que pour d’autres, le despote gouverne égoïstement dans son seul intérêt. Mais qu’est-ce qui l’empêcherait de traduire l’oppression gratuite en corps de loi, de devenir un despote légaliste ? Car, de toute façon, il ne peut gouverner sans assurer l’ordre public, et son pouvoir serait celui d’un vulgaire bandit s’il ne faisait pas de la politique, s’il ne prenait pas les mesures favorables à certains intérêts matériels qui ne concerneraient pas seulement les siens, tout en se préoccupant constamment de son maintien au pouvoir.
La politique pratiquée par le despote est souvent contraire aux intérêts matériels et immatériels d’une petite ou grande partie de ses sujets et les défavorisés seront soit privés de leurs biens, soit surtout sevrés de libertés. Le despote aura alors recours à la violence pour imposer une politique arbitraire ou légalisée, mais toujours au service du pouvoir, et l’appareil d’Etat fera progressivement prisonnière la collectivité dont il émane, dont il est l’organe. Se délectant de plus en plus dans l’exercice de sa dictature, gouvernant selon une vision, une sorte d’apostolat et savourant les servitudes qu’il fait peser sur ses sujets, il voudra être obéi au doigt et à l’œil. Se souciant de sa popularité, il pourra être momentanément détesté par la plèbe qui, le plus souvent, ne tardera pas à le flatter et à l’adorer. Allégations mensongères d’une part et compliments d’encensoir de l’autre excluront tout avertissement, tout conseil.
Le despotisme, dit-on, vire immanquablement à la tyrannie; mais la notion de tyran reste ambiguë et confuse; pour l’époque antique, il suffit de penser à un personnage aussi déconcertant que Néron. Aux yeux du Sénat, c’était un tyran, alors qu’auprès de la plèbe de Rome, sa popularité ne fait pas de doute. Il cherchait d’ailleurs moins l’exercice du pouvoir que le besoin de plaire pour se faire adorer; face aux contestataires, par contre, immédiat et souvent imprévu était le châtiment. Pourtant, loin d’être seulement un tyran égoïste, comme avait essayé de le faire croire Vespasien en rasant son palais, Néron fut longtemps encensé par la plèbe de la capitale, car il fut le premier empereur à répondre à un vœu onéreux, mais depuis longtemps réclamé par le peuple romain, celui de construire des biens publics. Du reste, le Sénat ne le détestait que pour le tort grave et inutilement ruineux des bienfaits complaisamment répandus sur la populace. Alors que la plèbe cherchait à se faire aimer par l’oppresseur, le Sénat, taraudé par sa susceptibilité chatouilleuse, voulait être avant tout respecté; la dignité qu’il revendiquait n’était donc nullement, comme il le prétendait, le rempart de la liberté commune, mais une revendication égocentrique et exclusive. Afin que le «peuple» soit docile et obéisse volontiers aux directives et à tous les agents du tyran, celui-ci lui fera sa cour et le comblera de réjouissances publiques, faisant progressivement aimer le régime en sa personne. A l’amphithéâtre, les tyrans se feront acclamer par le «peuple» et, forçant le trait, ils auront la prétention de se faire acclamer par le Sénat lui-même. Alors qu’ils n’hésiteront pas à opprimer nombre de sénateurs et à les acculer au suicide, en les accusant de lèse-majesté ou de haute trahison. A propos de ces tyrans et de leurs comportements, le sénateur Dion Cassius raconte une scène dont il fut, en même temps, le spectateur et l’acteur. La scène se situe à l’amphithéâtre de Rome et l’empereur Commode est en train de combattre, en personne, les bêtes dans l’arène. Comme on le leur avait ordonné, les sénateurs l’ont acclamé, avec les slogans obligatoires désormais officiels: «Tu es le maître, tu es le premier, tu es le vainqueur à jamais». L’empereur vient de tuer une autruche : «Il lui coupe la tête et s’avance vers la partie de l’amphithéâtre où nous autres sénateurs avons pris place et tend vers nous la tête de l’autruche de sa main gauche, sans un mot, avec un hochement de tête et un mauvais sourire». Dans l’hommage qu’il leur fait là des dépouilles, les sénateurs reconnaissent ou croient reconnaître une menace silencieuse sur leur propre tête; mais sur le moment, la difficulté fut pour eux de ne pas rire : «Nous avions tous plus ou moins envie de rire que de pleurer, mais il nous aurait tous massacrés avec son épée si nous avions ri. Alors je pris le parti de mordiller des feuilles de lauriers de ma couronne, et je suggérai à mes voisins de faire comme moi, pour que le mouvement incessant de nos lèvres déguisât notre envie de rire» (Dion Cassius, 72 ,20-21).
A l’amphithéâtre, les tyrans se feront acclamer par le «peuple» et, forçant le trait, ils auront la prétention de se faire acclamer par le Sénat lui-même. Alors qu’ils n’hésiteront pas à opprimer nombre de sénateurs et à les acculer au suicide, en les accusant de lèse-majesté ou de haute trahison. A propos de ces tyrans et de leurs comportements, le sénateur Dion Cassius raconte une scène dont il fut, en même temps, le spectateur et l’acteur. La scène se situe à l’amphithéâtre de Rome et l’empereur Commode est en train de combattre, en personne, les bêtes dans l’arène. Comme on le leur avait ordonné, les sénateurs l’ont acclamé, avec les slogans obligatoires désormais officiels: «Tu es le maître, tu es le premier, tu es le vainqueur à jamais». L’empereur vient de tuer une autruche : «Il lui coupe la tête et s’avance vers la partie de l’amphithéâtre où nous autres sénateurs avons pris place et tend vers nous la tête de l’autruche de sa main gauche, sans un mot, avec un hochement de tête et un mauvais sourire». Dans l’hommage qu’il leur fait là des dépouilles, les sénateurs reconnaissent ou croient reconnaître une menace silencieuse sur leur propre tête; mais sur le moment, la difficulté fut pour eux de ne pas rire : «Nous avions tous plus ou moins envie de rire que de pleurer, mais il nous aurait tous massacrés avec son épée si nous avions ri. Alors je pris le parti de mordiller des feuilles de lauriers de ma couronne, et je suggérai à mes voisins de faire comme moi, pour que le mouvement incessant de nos lèvres déguisât notre envie de rire» (Dion Cassius, 72 ,20-21).
Jaloux de son autorité, le tyran veut que sous lui tout soit peuple, mais il préférera la plèbe ; c’est elle le peuple où il se sentira à l’aise, dont il saura se faire aimer, alors que les sénateurs lui font ombrage. La conduite de ces empereurs décriés, de ces monarques tyranniques qui manquent de respect à la caste qui s’élève plus haut que les têtes de tous leurs sujets découle, selon Max Weber, d’un «sultanisme» impérieux qui détermine leur comportement. Refusant de prêter attention et de se rendre accessibles aux plus aptes, ils finissent par négliger les affaires, par faire des coupes sombres dans leur propre famille, par s’adonner aussi parfois à la boisson et à des amours honteuses. Mais c’est Polybe qui dessine l’idéal type de ces potentats:
«Vinrent des rois qui, par droit de naissance, avaient succédé à leur père et avaient, matériellement, tout le nécessaire et même plus. Voyant cette abondance, ils cédèrent à leurs appétits et estimèrent que les gouvernants devaient se distinguer de leurs sujets par le vêtement, que leurs festins devaient être dressés tout autrement… La royauté se changeait en tyrannie, cependant que le régime commençait à être ébranlé par des conspirations». Ces complots, affirme Polybe, sont dus à la fierté des couches dirigeantes : «Ce n’étaient pas les gens du plus bas peuple qui conspiraient ainsi, mais les hommes les mieux nés, les plus fiers et les plus hardis, car eux supportaient plus que mal que tout le monde les abus de leur maître» (Polybe, 6, 7). Mais à Rome, à vrai dire, les sénateurs voulaient-ils vraiment gouverner ou, du moins, diriger? Car un non vouloir latent nourrissait un déchirement intime, cause profonde du conflit entre le pouvoir impérial et le Sénat. Les relations n’étaient qu’une succession d’hypocrisies et les sénateurs en voulaient paradoxalement au prince de leur propre incurie. De fait, ils étaient soulagés de laisser l’empereur les décharger du fardeau gouvernemental.
Lorsque les rois héréditaires étaient en présence d’une noblesse, d’une caste haute à respecter, les relations étaient habituellement sereines et se déroulaient sans arbitraire et sans morgue. Mais quand l’un des partenaires faisait défaut, le sultanisme pointait à l’horizon. Dans un premier cas, le potentat traitait avec mépris l’assemblée et les grands commis de l’Etat, ravalés à la condition de simples fonctionnaires, et dans un deuxième cas, la crainte de perdre le trône fera voir en chaque compétence reconnue la menace d’un dangereux concurrent, d’un compétiteur à éliminer. Lorsque les relations entre l’empereur et l’assemblée étaient confiantes, on avait donc un prince aussi méritant qu’un Philopator, mais à l’opposé, on n’avait plus que des Césars fous, massacreurs de sénateurs.
Des siècles durant, les pouvoirs légitimes étaient dus à l’investiture divine, à l’hérédité ou au mandat populaire. A Rome, les empereurs ne détenaient le pouvoir que grâce à l’héritage fictif d’un père adoptif, et ne l’acceptaient que sur l’insistance du Sénat, feignant de reconnaître qu’ils le devaient à leurs pairs et qu’ils n’étaient pas plus dignes que n’importe quel sénateur. Historiquement, parmi les multiples exemples de régimes illégitimes, fomentateurs de Césars fous, le choix de Paul Veyne – dont l’aperçu sur le despotisme est mis à contribution dans cet article– s’était porté sur le gouvernement communiste. En vertu du centralisme démocratique institué par Lénine, le secrétaire général du Parti n’était qu’un mandataire, choisi grâce à l’aura de son génie ; mais le Parti pouvait lui donner un successeur, immédiatement et sans coup férir. Pour garder un pouvoir dont il redoutait ainsi la perte, le mandataire devenu possesseur devait fréquemment frapper, frapper au hasard ne serait-ce que pour l’exemple. Il ne visera pas des opposants précis, mais une contestation permanente de sa légitimité, exprimée par l’existence même du Parti, et finira par croire aux crimes qu’il avait prêtés à ses victimes.
Rome aussi avait eu l’équivalent des procès à grand spectacle et des purges staliniennes, surtout vers la fin de l’Empire; si bien qu’Ammien Marcellin écrivit que «selon une sorte de coutume reçue de toute antiquité, les accusations mensongères de lèse-majesté battaient leur plein et l’empereur régnant, Constance, pour peu qu’il fût sur la piste d’une accusation d’aspirer au trône, même mensongère ou peu fondée, la suivait jusqu’au bout, perdait le sens du bien et du mal et dépassait en atrocité un Caligula, un Domitien ou un Commode».
Ammar Mahjoubi
- Ecrire un commentaire
- Commenter