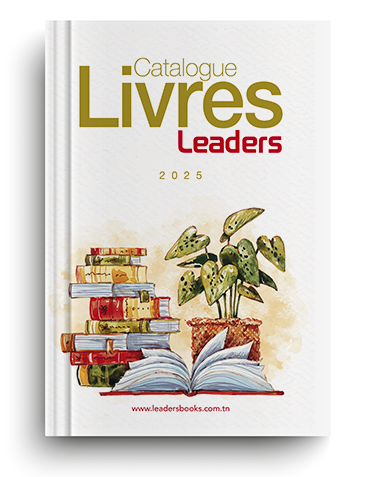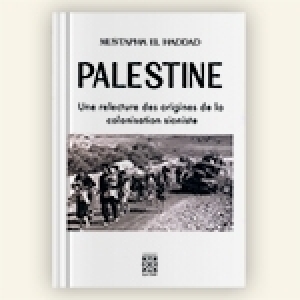Abdelaziz Kacem - Francophonie: Un jeu du «donner et recevoir»

.jpg) Par Abdelaziz Kacem - Avec deux ans de retard, nous fêtons le cinquantenaire de la Francophonie. Avec un F majuscule, en tant que nom propre, désignant les institutions qui organisent les relations spécifiques de coopération entre les pays ayant le français en partage. C’était le 20 mars 1970, à la Conférence de Niamey. Naissance de l’Agence de coopération culturelle et technique (Acct), rebaptisée, en 1996, Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF), pour s’intégrer, en 2006, à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui englobe d’autres instances francophones.
Par Abdelaziz Kacem - Avec deux ans de retard, nous fêtons le cinquantenaire de la Francophonie. Avec un F majuscule, en tant que nom propre, désignant les institutions qui organisent les relations spécifiques de coopération entre les pays ayant le français en partage. C’était le 20 mars 1970, à la Conférence de Niamey. Naissance de l’Agence de coopération culturelle et technique (Acct), rebaptisée, en 1996, Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF), pour s’intégrer, en 2006, à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui englobe d’autres instances francophones.
Ses objectifs sont définis par l’article 1er de sa charte :
«L’Agence a pour fin essentielle l’affirmation et le développement entre ses membres d’une coopération multilatérale dans les domaines ressortissant à l’éducation, à la culture, aux sciences et aux techniques, et par là au rapprochement des peuples.»
Certes, le français, en Afrique noire, au Maghreb et au Levant, est, pour certains, un legs historique, pour d’autres, une séquelle de la colonisation. Mais il a été si bien assumé que Jacques Berque s’en étonna naguère. L’essor de la littérature francophone arabe constitua à ses yeux la «surprise ambiguë de la décolonisation», et cela, ajoutait-il, «dans les temps mêmes où une politique désastreuse nous coupait de l’Orient»(1).
En vérité, la littérature maghrébine de langue française balbutiait, dès l’aube du XXe siècle, sous la forme de gentils poèmes parnassiens, de contes populaires, de récits ethnographiques. Elle commence à s’affirmer dans l’entre-deux-guerres, mais l’état civil des lettres la fait naître aux alentours des années cinquante. Paradoxalement, cette littérature dont on attribue la paternité au colonialisme, obtient ses lettres de noblesse en luttant contre son géniteur présumé. Le français est un butin de guerre, dira Kateb Yacine. La Tunisie, pays d’Apulée, de Tertullien, de saint Augustin, a toujours été par vocation, par tradition et au gré de son histoire tumultueuse, éminemment polyglotte. On y parlait le berbère, le punique, le grec et le latin. Comme jadis, la langue de Virgile, seul, aujourd’hui, le français, langue étrangère, a pu se greffer sur la conscience de ses locuteurs, en matière de production littéraire et artistique. Mais cela n’a jamais laissé d’agacer toute une frange de la population travaillée par des piétés misanthropes ou par des idéologies misonéistes. L’Organisation de la Francophonie a été voulue, conçue et créée par ses Pères fondateurs, strictement africains, le Président Habib Bourguiba et ses homologues L.S. Senghor (Sénégal) et Hamani Diori (Niger) auxquels s’est joint le prince Norodom Sihanouk (Cambodge). La France s’est employée à apporter sa bénédiction et son soutien, tout en insistant sur l’indépendance de l’institution. En son nom, André Malraux, ministre d’État chargé des Affaires culturelles, prononce le 17 février 1969, à Niamey, un discours dans lequel, il donne le ton à ce qu’il appelle la culture de la fraternité : «Seule la culture francophone, dit-il notamment, ne propose pas à l’Afrique de se soumettre à l’Occident en y perdant son âme».
Lors de sa fondation, l’Acct comptait 21 membres, l’OIF en regroupe aujourd’hui 88, ce qui confère au français, plus ou moins présent sur tous les continents, le rang de deuxième langue internationale. Sa devise : égalité, complémentarité, solidarité.
À Bruxelles, capitale de l’Europe, où l’arrivée en force des représentants des pays nouvellement (et trop hâtivement) intégrés à l’UE bouleversait l’équilibre linguistique, au bénéfice de l’anglais. Il m’a été donné d’y rappeler que «si le français doit être le ciment du vieux continent, son avenir est ailleurs. Il est en Afrique noire, au Maghreb, mais aussi en Égypte, au Liban et, potentiellement, en Syrie, malgré une politique française désastreuse à l’égard de ce pays incontournable du Moyen-Orient» (2).
Elle aussi, la Francophonie, cherche à reculer ses frontières. Par-delà la statistique, le quantitatif, ne conviendrait-il pas, d’abord, de consolider l’existant, là où le français a encore des chances de se maintenir ? Force est de constater que Molière ne se reconnaîtra jamais dans ce sabir adventice qui corrompt le langage depuis des décennies. A l’université, on est de moins en moins choqués d’entendre jargonner les étudiants. En France même, tirant la sonnette d’alarme, face à la dégradation, Maurice Druon parlait de «Non-assistance à langue en danger»(3).
Pierre Dumont, sociolinguiste de son état, publie L’Afrique noire peut-elle encore parler français ? (L’Harmattan, 1986). La même question devrait être posée à propos de l’Afrique du Nord. En Tunisie, depuis la «Révolution de la brouette», l’examen du Baccalauréat comptabilise sept mille zéros à l’épreuve de français. Doit-on s’en étonner outre mesure, quand la naissante «démocratie» tunisienne nous traite de «Rebut (houthala) de la francophonie» ou de «Hizb Fransa» (Parti de la France)?
Dans la vie des États et des nations, il y a des hauts et des bas. Ainsi, dans notre région, chaque fois que nos relations avec l’ancien colonisateur se crispent, pavlovien, l’indigénat s’indigne et appelle au remplacement du français, langue «coloniale», par l’anglais, concepteur, pourtant, du colonialisme même. En vérité, les gardiens du temple, identitaristes et autres monolingues, polygames en puissance, veulent en découdre avec les bilingues issus de l’école franco-arabe dont a hérité le système éducatif adopté à l’indépendance. Ce que les premiers reprochent aux seconds, c’est de leur avoir barré la route du pouvoir, en l’accaparant. Ainsi, chercher à détrôner la langue des Droits de l’homme par un business english équivaudrait à une automatique mise à l’écart des francophones. La perfide Albion a toujours encouragé nos tartufes francophobes du Londonistan à aller dans ce sens.
L’AFP, dans une dépêche en date du 16 juin 2010, quelques mois avant l’éclosion du Printemps dit «arabe», rapporte que Christopher Bryant, secrétaire d’État aux Affaires européennes, dans le gouvernement travailliste de Gordon Brown, a déclaré le français langue «inutile», lui préférant le chinois, l’espagnol et l’arabe «parlés dans des pays à forte croissance économique». Les Arabes, bien que prompts à tirer fierté de tout hommage rendu à leur langue, s’aperçoivent que leurs pays continuent d’être perçus comme un espace où doit se déverser à flots la camelote anglo-saxonne et comme un sous-sol à exploiter sans partage. Plus sérieusement, aux yeux des intégristes, l’anglais commercial pur, autrement dit, débarrassé de Shakespeare, est plus neutre que le français où certains mots sont si chargés de sens et d’histoire qu’ils n’ont que des équivalents relatifs dans d’autres langues. Le français est dangereux parce que porteur de notions « honnies » telles que liberté de conscience ou laïcité. Ce dernier concept est utilisé en toute mauvaise foi, comme synonyme d’athéisme. Et puis, le propre de l’obscurantisme n’est-il pas de ne jamais se laisser pénétrer par les Lumières ?
Dans les années soixante du siècle passé, les relations politiques tuniso-françaises n’étaient pas au beau fixe, et plus ces relations se gâtaient, plus le président Habib Bourguiba consolidait ses liens avec les États-Unis. Jamais, cependant, l’idée de se détourner de l’enseignement du français n’a effleuré son esprit. Au contraire, en décembre 1965, peu de temps après la très sanglante bataille de Bizerte et la vengeresse récupération des terres coloniales, il déclarait dans un discours prononcé devant l’Assemblée nationale du Niger : «La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en force les liens de l’idéologie […] Pour vous, comme pour nous, la langue française constitue l’appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, exprime notre action, contribue à forger notre destin intellectuel et à faire de nous des hommes à part entière, appartenant à la communauté des nations libres».
En novembre 1990, au siège de l’Unesco, à l’occasion des Journées internationales organisées par l’Institut Charles de Gaulle, une grande figure de la littérature arabe, l’ancien ministre tunisien de l’Éducation nationale, Mahmoud Messadi (1911-2004), fit une importante communication intitulée De l’empire à la Francophonie. Il y évoqua la décolonisation et son corollaire, le démantèlement de l’Empire sur les débris duquel émergeait l’Acct, à l’initiative, rappelle-t-il, de trois libérateurs de leurs pays, à savoir Bourguiba, Senghor et Diori. Il s’agissait, en l’occurrence, de donner d’abord un statut particulier à la langue française héritée de la colonisation, de lui assigner ensuite une mission revue et corrigée à la lumière des exigences d’une ouverture sur la civilisation actuelle, d’en atténuer enfin les risques d’une francité exclusive. Car la Francophonie, comme le souligne le conférencier, ne saurait tenir le rôle qui lui est désormais confié que par le jeu du « donner et recevoir», «règle d’or, souligne-t-il, dans les rapports entre membres de toute association mutuelle durable»(4).
La Francophonie s’enrichit, en effet, de la diversité de ses locuteurs et c’est bien elle qui, à Mexico, le 27 juillet 1982, par la voix de Jack Lang, lors de la conférence mondiale des ministres de la Culture, sur la défense de la culture contre les dominations économiques. Les écrivains bilingues, dont Mahmoud Messadi (1911-2004), sont peu nombreux au Maghreb. N’ayant pas l’excuse de la méconnaissance de la langue nationale, leur «trahison» ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Un critique marocain, mécontent de voir de jeunes auteurs maîtrisant l’arabe choisir la langue de l’ancien occupant, pense «que c’est là un phénomène pathologique, une aliénation beaucoup plus qu’une création artistique»(5).
Mais quelle nécessité oblige enfin des écrivains arabophones à se rabattre sur la deuxième langue ? Voici le surprenant aveu du Tunisien Salah Garmadi (1933-1982), poète et, de surcroît, professeur de linguistique arabe, à l’Université de Tunis: «C’est, dit-il, par l’intermédiaire de la langue française que je me sens le plus libéré du poids de la tradition ; c’est là que, le poids de la tradition étant le moins lourd, je me sens le plus léger»(6). Il n’est pas le seul Maghrébin à étouffer dans un espace linguistique de plus en plus «théologisé».
Ce n’est pas une fuite. Aux côtés de nos collègues arabisants, nous nous employons, en arabe et en français, à la mise en valeur de nos propres précurseurs des Lumières…
Pour conclure, il faut avouer que la Francophonie n’est pas au meilleur de sa forme, et cela nécessite un diagnostic approfondi. Rien qu’un simple constat: hors l’engagement officiel de l’Hexagone, lui-même essoufflé, il fut un temps où les souchiens étaient bien impliqués dans la défense et l’illustration de leur langue. L’apathie dont ils font preuve, à cet égard, fit dire à Emil Cioran cette vérité que je partage et que je signale au Sommet:
Le français est devenu une langue provinciale. Les indigènes s’en accommodent. Le métèque seul en est inconsolable. Lui seul prend le deuil de la nuance. Je ne veux point gâcher la fête, mais il est à craindre que le «métèque» de l’intérieur, au rythme de l’effondrement continu de l’enseignement du français, ne finisse par prendre le deuil du tout. Prémonitoire, le regretté Rachid Mimouni (1945-1995) nous laisse un sentiment qui donne à réfléchir:
«En définitive, écrit-il, la littérature maghrébine de langue française est une littérature du fait accompli. Elle fut une prise de parole, et son essor a été contemporain du développement du sentiment national. Elle se perpétue en dépit de tous les arrêts de mort, mais sans qu’on parvienne à lui ménager un avenir ni même une situation. Marginale dans la littérature française, elle reste pour la littérature arabe une hérésie. À nous obstiner, ainsi, à crier notre fureur d’être, peut-être nous sera-t-il permis de faire un bout de chemin dans cette périphérie équivoque. Une parenthèse à vivre». La fin du français n’est pas pour demain. Mais sans une grande littérature, la Francophonie ne serait plus qu’une coquille vide.
Abdelaziz Kacem
1) Jacques Berque, Mémoires des deux rives, Le Seuil (édition complétée), mars 1999, p.127.
2) Jean Dutourd et ses amis, Éclat et Fragilité de la langue française, art. Abdelaziz Kacem, En ces temps verbicides…, France Univers, Paris, 2008, p. 113.
3) Lire Le Figaro du 24/02/2004.
4) Mahmoud Messadi, O. C., vol IV, Sud Éditions, Tunis, 2003, p. 276.
5) Ahmed El Yabouri, art. « Reflets de l’hégémonie », dans Lamalif, n°194, décembre 1987, p.71.
6) Salah. Garmadi, dans Alif (Tunis), n°1, décembre 1971, p.37.
Lire aussi
الأمينة العامة للفرنكوفونية: قمّة جربة ستكون ناجحة بامتياز
Être francophone aujourd’hui ?
Sommet de la Francophonie de Djerba 2022 : Quels en seront les moments forts
- Ecrire un commentaire
- Commenter

Je viens de parcourir le texte de notre amoureux de la nuance, notre marcheur rebelle, poète, essayiste, penseur," oseur" définitif... Je lui propose de prolonger sa lecture en évoquant le travail de longue haleine accompli par des chercheurs de l'Université tunisienne qui défendent la francophonie transversale, humaine,retentissante... Une francophonie tissant la meilleure francophonie ,navigatrice des pensées,ayant échappé aux mailles des revues académiques,impénétrables, au cadenassage simpliste... Nous sommes plurilingues, faut-il le gagner de nouveau ,comme un héritage symbolique immense ; Molière, Voltaire, Tawhidi, Césaire, Kateb Yacine, Abdelaziz Kacem, Apollinaire… ça rime, c'est la faute à Chabbi et à Baudelaire. Habib Ben Salha Directeur du Laboratoire de recherches ; Études maghrébines, francophones, comparées et médiation culturelle.