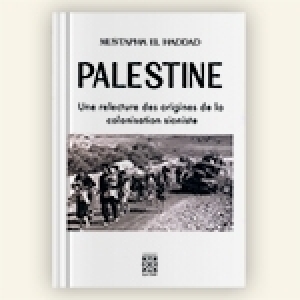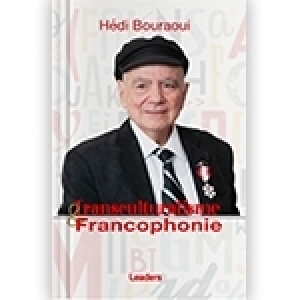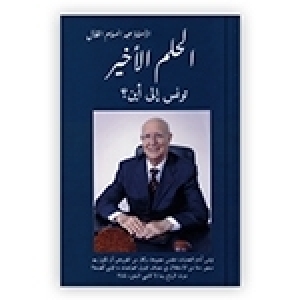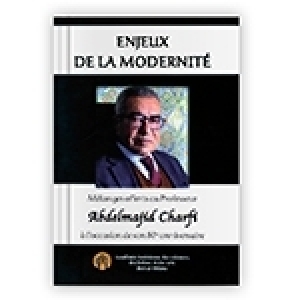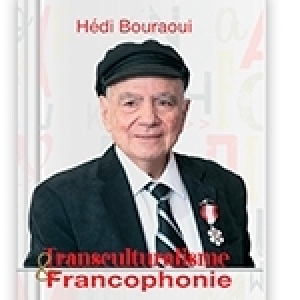François Hollande: Contre un régime d’Assemblée, pour un vrai régime présidentiel
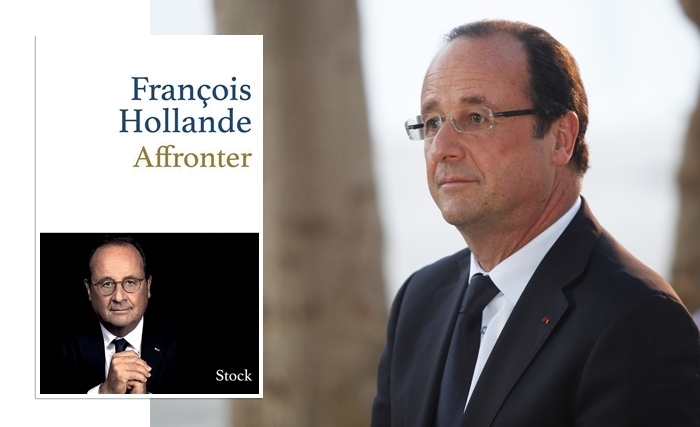
Comment un ancien président peut-il être utile ? «C’est être libre », écrit François Hollande dans son livre Affronter qu’il vient de publier aux éditions Stock. «Libre de s’appuyer sur son expérience pour juger de la situation du pays et de l’état du monde, ajoute-t-il. Libre de penser sans fard, sans désir de plaire, sans crainte de déplaire et sans rien rechercher pour lui-même.» En «observateur engagé et non plus en acteur partisan», l’ancien président français n’a cessé de suivre l’évolution de l’actualité, en examinant le désordre politique et en essayant de démonter les mécanismes destructeurs. Sa réflexion porte sur les défis majeurs que la France doit affronter, portant un regard attentif à l’architecture institutionnelle. Comment doivent fonctionner le président de la République, le parlement et le gouvernement ? Dans quelle séparation des pouvoirs ? Et avec quelle synergie d’efficience ?
D’emblée, François Hollande s’inscrit contre un régime d’Assemblée et en faveur d’un vrai régime présidentiel. Fort de son expérience de député, et de conseiller du président Mitterrand à l’Elysée, de premier secrétaire du Parti socialiste, puis de président de la République (2012 -2017), il développe son analyse. Au moment où la Tunisie aborde une révision constitutionnelle annoncée d’ampleur, les réflexions de l’ancien président français pourraient enrichir le débat.
Affronter
de François Hollande
Editions Stock, 288 pages, 20.90 €
Bonnes feuilles
Je suis convaincu qu’un régime d’Assemblée ne pourrait faire face aux épreuves de notre temps aussi bien internationales qu’intérieures. J’ai pu le mesurer comme président au regard des règles qui pouvaient entraver l’action diplomatique et militaire de mes collègues chefs de gouvernement. Je l’ai notamment vécu lors du drame syrien ; la lourdeur des procédures parlementaires fut l’une des raisons de la passivité de l’Occident devant l’utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad et de la lenteur de la réaction de l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme en Afrique.
Une République parlementaire aurait pour première conséquence d’en finir avec l’élection du président au suffrage universel. Ce prétendu progrès serait vécu par les Français comme une régression. C’est en effet un curieux procédé que de vouloir élargir la démocratie en privant les citoyens du droit de choisir leur premier dirigeant. Les élections législatives deviendraient le scrutin majeur et les partis, pourtant faibles et divisés, auraient le premier rôle pour décider de la vie d’un gouvernement. Où serait le progrès démocratique ?
(...)
Je pense qu’il faut sortir de l’ambiguïté institutionnelle et instaurer en France un vrai régime présidentiel. C’est-à-dire faire du chef de l’État le seul responsable de l’exécutif et donner au Parlement une place bien plus éminente que sa position actuelle.
Dans ce cadre, le président ne nommerait plus un Premier ministre, cette fonction serait supprimée, mais une équipe directement placée auprès de lui. En échange, puisque le gouvernement ne serait plus responsable devant l’Assemblée nationale, le chef de l’État perdrait son droit de dissolution. L’article 49.3 n’aurait plus de raison d’être. L’exécutif ne pourrait donc plus faire pression sur le Parlement: il devrait composer avec lui. Je pense notamment aux lois de finances dont l’adoption conditionne la mise en œuvre de la politique du pays. C’est ce qui se produit aux États-Unis avec l’obligation de trouver un accord dans un temps limité, sous peine d’interrompre le fonctionnement des administrations.
Cette séparation des pouvoirs introduirait une clarté bienvenue dans l’exercice des responsabilités et assurerait l’efficacité de l’action publique. Le président disposerait de larges compétences qu’il exercerait directement. Il réaliserait lui-même les arbitrages au sommet de l’État, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui puisque le Premier ministre, selon l’article 20 de la Constitution, « détermine et conduit la politique de la Nation » et « dispose de l’administration et de la force armée ». Or, qui peut encore prétendre qu’il en est ainsi ? Qui peut vraiment affirmer que le chef du gouvernement est le chef de la majorité ? Qui peut croire qu’il tire sa légitimité de la confiance de l’Assemblée, alors qu’il est nommé et révoqué par le président ?
Pourtant, sa place dans l’appareil d’État n’a pas changé. Le Premier ministre dispose en effet de tous les rouages pour assurer sa fonction d’animation et de coordination interministérielle et notamment du secrétariat général du gouvernement. Cet organe est chargé de suivre la préparation des projets de loi, de décrets et d’enregistrer les arbitrages rendus par le Premier ministre, dont le cabinet est bien plus étoffé, pour cette raison, que celui du président.
Tel est le paradoxe de nos institutions. Elles sont organisées comme si nous étions dans un régime parlementaire avec un chef de gouvernement qui contrôle l’essentiel de l’administration, alors que l’opinion croit que le président prend toutes les décisions et qu’il est informé du moindre arrêté ministériel. Quant au Premier ministre, il doit sans cesse en référer au chef de l’État, lequel ne peut rien lui imposer. D’où les malentendus et les causes de rupture. Je n’ai pas d’autres explications pour comprendre le renvoi d’Édouard Philippe. La place qu’il avait prise durant la gestion de la pandémie et la popularité qu’il avait gagnée durant cette crise a été regardée comme un écran entre le président et lepays.
Cette dyarchie pouvait se comprendre avec le septennat, qui laissait le président au-dessus de tout et loin de l’intendance. Elle n’est pas compatible avec le quinquennat et avec ce qu’il induit dans les relations entre le pouvoir et les citoyens. C’est ce constat qui justifie ma préférence pour le régime présidentiel.
Dans un tel système, le Parlement verrait son rôle accru, notamment sur le plan législatif et budgétaire, puisque toutes les contraintes qui pèsent aujourd’hui sur lui disparaîtraient. Le président n’aurait en retour aucune prise sur lui, au-delà du lien politique avec les partis, et donc les parlementaires qui le soutiennent.
Si l’Assemblée nationale, à la suite de son renouvellement, se révélait hostile au président, nous serions alors dans une parfaite cohabitation ; elle ne se situerait pas au sein de l’exécutif (ce qui écarte ipso facto les risques de confusion), mais entre l’exécutif et le législatif. Le conflit ne pourrait alors se régler autrement que par la recherche d’un compromis, y compris sur les nominations, car dans un régime présidentiel, l’accord du Parlement est nécessaire pour autoriser l’accès aux plus hauts postes des candidats présentés par l’exécutif. Si le chef de l’État était heurté par le vote d’une loi qu’il estimerait contraire à l’intérêt du pays, il pourrait demander une nouvelle délibération. Il prendrait ainsi l’opinion à témoin mais il ne pourrait pas s’opposer à son adoption. Il ne disposerait pas d’un droit de veto.
- Ecrire un commentaire
- Commenter