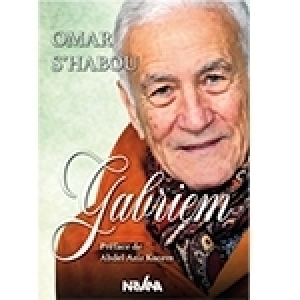Kamel Jendoubi (1): Tunisie, qu'est-il advenu de ta révolution ?

Quel regard portez-vous sur la situation de la Tunisie aujourd'hui?
Un regard sombre assorti d’un goût amer face au risque de plus en plus réel d’assister à la remise en cause du processus démocratique. La Révolution a impulsé une dynamique qu’on a communément appelé «transition démocratique» dont l'un des temps forts a été, en 2014, l’adoption d’une nouvelle Constitution, démocratique pour l’essentiel. Rappelons surtout que, dès 2011, plusieurs décrets-lois (relatifs aux associations, aux médias, aux élections, aux partis politiques, des décrets-lois élaborés par la Haute instance pour la préservation des objectifs de la Révolution, la réforme politique et la transition démocratique présidée par Yadh Ben Achour, puis adoptés par le gouvernement provisoire dirigé par Beji Caïd Essebsi et ratifiés par le Président de la République Foued Mbazaa) ont posé les premières pierres de la sortie de la dictature Ben Ali. Ils ont aussi permis la mise en place d’institutions de régulation indépendantes (Instance supérieure indépendante pour les élections/ISIE, Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle/Haica, Instance de lutte contre la corruption, Instance nationale pour la prévention de la torture). Or, on assiste depuis 2019 et en particulier depuis les dernières élections législatives et présidentielle (octobre 2019), à l’inversion du processus, en quelque sorte une dé-démocratisation avec, d’une part, des manœuvres de «détricotage» des institutions existantes (en particulier en matière de médias et de lutte contre la corruption) ou en cours d’instauration (la Cour constitutionnelle), d’autre part, la multiplication de discours populistes s’attaquant à l’égalité homme-femme (en matière d’héritage en l’espèce), à la liberté d’expression au nom de la défense du sacré, à certaines libertés individuelles , et prônant le recours à la peine de mort et le renforcement des pouvoirs des forces de sécurité intérieures.
Cette transition semble bloquée voire compromise en raison notamment d’une configuration partisane dépassée et d’une classe politique totalement discréditée. Le sentiment d’échec est prégnant, surtout quand j’observe comment, insidieusement, les acquis de la période 2011-2014 s’effritent peu à peu. Une grande part de cet échec est imputable aux forces dites modernistes et progressistes qui, dépourvues d’un projet politique d’ensemble prenant à bras le corps les revendications économiques et sociales émises par les manifestants de 2011, ont failli face aux discours d’imposture des populistes en tous genres, islamistes comme «séculiers».
Qu’il s’agisse des populistes religieux qui affirment que la religion a réponse à tous nos problèmes tout en attendant des «impies» et des «mécréants» qu’ils trouvent le vaccin contre la Covid-19, des populistes nostalgiques de l’ancien régime qui font croire que la situation était meilleure avant la Révolution, réduisant celle-ci à un complot ourdi par des forces maléfiques de l’intérieur et de l’extérieur, ou encore de ceux qui tirent à boulets rouges sur les politiques et les défenseurs des droits de l’homme.
La majorité des Tunisiens, et en particulier les intellectuels, n’a pas suffisamment conscience, à mes yeux, de l’étau qui nous enserre avec, d’un côté, le désordre provoqué notamment par l’action concertée des imposteurs islamistes «modérés» comme «violents», de l’autre, le régime autoritaire qui guette le pays, une perspective à laquelle de plus en plus de Tunisiens se résignent par lassitude, parfois par faiblesse.
Le processus démocratique n’est pas seulement menacé sur le plan intérieur. Il l’est tout autant par un environnement géopolitique instable qui amplifie les vulnérabilités internes de plusieurs manières. Premièrement, sur le plan régional, le voisinage immédiat de la Tunisie est source de dangers récurrents, qu’il s’agisse du terrorisme jihadiste qui, utilisant une partie significative du territoire libyen comme base arrière, étend ses opérations de l’Afrique du Nord au Sahel, ou encore de la prolifération des armes en raison de la guerre qui sévit en Libye même. Face à cette situation, les pays du Maghreb sont impuissants parce que désunis. Sans revenir sur les difficiles relations algéro-marocaines, la réaction ou plutôt le manque de réaction en Tunisie lors du Hirak algérien est révélateur de ce manque de solidarité maghrébine Tout en suscitant un mouvement de sympathie de la part de nombreux militants tunisiens, il a surtout été regardé avec crainte et méfiance par une grande partie de la population et par la classe politique.
Les conséquences sur la Tunisie de la situation en Libye sont dramatiques, qu’il s’agisse des centaines de milliers de Libyens réfugiés sur son territoire ou encore de la perte financière occasionnée par la disparition d’un débouché économique qui, avant 2011, jouait un rôle important pour une partie non négligeable de la population tunisienne, notamment dans le sud du pays.
Deuxièmement, considérée sinon comme un modèle, du moins comme une exception, voire une rescapée des printemps arabes, la Tunisie est devenue la cible d’acteurs, étatiques ou autres, hostiles à la réussite de sa transition démocratique. Nombreux sont les dirigeants, notamment dans le monde arabe, qui ne rêvent que de faire payer aux Tunisiens le fait d’avoir «dégagé» une dictature longtemps traitée avec beaucoup de complaisance par nos partenaires du Nord.
En réalité, tout se passe comme si, n’ayant pensé la post-révolution que d’une manière autocentrée sans tenter d’envisager notre devenir au niveau du Maghreb et au-delà, nous avons laissé le champ libre à des acteurs extérieurs dotés de leurs propres agendas et décidés à peser de tout leur poids pour influencer voire pour changer le cours des événements. Je fais référence ici aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, au Qatar, à l’Arabie saoudite, à la Turquie bien sûr, mais aussi à l’Union européenne. S’agissant de cette dernière, la déception est profonde : face à ses angoisses identitaires, ses obsessions sécuritaires et ses turbulences économiques, le soft power européen a eu vite fait de s’évaporer et de renoncer à «accompagner» la Tunisie dans l’élaboration d’un modèle de développement économique et social en phase avec les demandes de la Révolution. Ainsi, l’ambition, affichée durant un temps de démocratiser les relations euro-méditerranéennes en considérant le Sud non comme un parent pauvre mais comme un partenaire égal à égal (surtout quand celui-ci emprunte la voie de la démocratie), s’est effacée devant la volonté d’établir un partenariat bancal dans lequel les pays du Sud sont assignés à la mission de gardiens des frontières de l’Europe (voir le plan Frontex).
Sur le plan économique, on sait que les conséquences de la "Révolution" furent et sont toujours dramatiques pour les plus faibles mais qu'en est-il sur le plan politique?
Le pouvoir semble fragmenté, affaibli par un conflit triangulaire entre les trois têtes de l’Etat (Assemblée des représentants du peuple/ARP, présidence de la République, gouvernement) qui mine la conduite des affaires du pays.
On a, d’une part, un président de la République dont l’activisme cache mal l’impuissance: impuissant parce qu’il ne parvient pas à obtenir du chef du gouvernement qu’il a désigné de se limiter au rôle de simple exécutant, ni à empêcher le président de l’ARP de s’agiter, notamment sur le plan extérieur, domaine normalement réservé au chef de l’État. Bien que censé être le symbole de l’unité de l’État et du pays, le président de la République ne cesse de souffler sur les braises et d’accentuer les divisions, n’assumant pas son rôle de médiateur et de régulateur des institutions. Principal garant de la Constitution, Kaïes Saïed donne de celle-ci , en absence de cour constitutionnelle, une lecture populiste et conservatrice conformément à celle qu’il a développée lors de sa campagne électorale de décembre 2019 : refus de l’égalité hommes-femmes dans l’héritage sur la base de sa lecture du texte coranique ; refus d’abolir la peine de mort ; condamnation de l’homosexualité considérée comme une perversion encouragée par l’étranger, soumission des libertés individuelles au conformisme ambiant, en assimilant, par exemple, le fait de ne pas observer le jeûne en public durant le ramadan à une provocation.
L’enceinte parlementaire est prise en otage par divers courants populistes. Le regroupement de circonstance entre, d’une part, les deux formations islamistes - Ennahda et sa «succursale» dure, Itilaf El Karama (Coalition de la dignité)-, d’autre part, Qalb Tounes emmené par l’homme d’affaires Nabil Karoui (soit un total de 102 sur 217 sièges) permet à ces composantes, tout en ayant voté la confiance à un gouvernement composé de personnalités réputées indépendantes en octobre 2020, de monnayer pied à pied leur soutien. Cette alliance offre l’avantage pour Ennahda de ne pas s’exposer seule en cas d’éventuelles turbulences politiques tout en restant maitresse du jeu.. .et, au passage, de faire passer, grâce à des majorités de circonstance, des lois s’en prenant à la Haica, au paysage audiovisuel, au mode de désignation de la Cour constitutionnelle.
Quant au chef de gouvernement, réduit à composer avec l’ARP et à se prémunir des empiétements de la présidence, il n’a aucune marge de manœuvre, se limitant à gérer les affaires courantes.
L’hypothèque que font peser les différents courants populistes sur la démocratie naissante est très inquiétante. On a, d’une part, l’activisme d’Itilaf El Karama, incarnation de l’aile radicale de l’islamisme, sorte d’attelage proto-fasciste déterminé à entraver le processus de sécularisation du pays, à revenir sur le «compromis constitutionnel» de 2014 et à remettre en cause les avancées démocratiques consenties par Ennahda. Pour ce faire, elle mobilise toutes les ressources de la contre-révolution: défendre l’ordre moral le plus rétrograde, élaborer un discours identitaire d’une rare violence, réhabiliter le rôle politique des mosquées et des écoles coraniques, viser l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) dans le droit fil de ce qu’avaient fait les Ligues de protection de la révolution dissoutes en 2014. Un discours agressif qui fait mouche dans plusieurs milieux: jeunes, quartiers populaires et conservateurs.
D’autre part, le Parti destourien libre (PDL), présidé par Abir Moussi, avocate fervente de Ben Ali joue sur la nostalgie de l’ancien régime, ce qui ne traduit nullement une adhésion à un programme qui, du reste se réduit à un seul objectif : éliminer les Frères musulmans. Le PDL (soit 16 députés) a réussi à attirer des forces issues en partie du délitement de la droite post-bourguibiste (rassemblée en partie de 2014 à 2019 au sein de Nidaa Tounes, mouvement hétérogène s’il en fut). Certains sondages lui prédisent une victoire éclatante dans l’hypothèse d’élections législatives anticipées. Il se pose plus que jamais comme alternative au système «perverti» de la post-révolution et surtout comme rempart contre les islamistes, polarisant ainsi un peu plus la vie politique. Dotée d’une forte personnalité, A. Moussi est même parvenue à rallier certains membres de la mouvance de gauche qui, cultivant une haine irréductible de l’islam politique, sont prêts à renoncer aux acquis démocratiques pourvu qu’on les débarrasse de ces «ennemis de la démocratie», rééditant en quelque sorte leur ralliement à Ben Ali durant les années 1987-2010.
D’autres inconnues hantent le paysage politique et social tunisien. À commencer par le rôle de l’UGTT. Considérée comme un recours démocratique et un arbitre ultime, rôle qu’elle a su tenir par le passé, elle apparaît aujourd’hui affaiblie. À trop fréquenter les coulisses politiciennes, sa direction actuelle peine à encadrer les mouvements sociaux. Elle n’en demeure pas moins un acteur-clé quand bien même les apprentis sorciers d’Ennahda comptent sur les nervis d’El Karama pour la déstabiliser. Quant aux composantes de la société civile ou plutôt du mouvement civique, elles ne semblent pas aujourd’hui en mesure d’impulser des mobilisations d’envergure comme celles qui ont soutenu le Quartet (UGTT, Union tunisienne pour l’industrie et le commerce (patronat), Conseil de l’ordre des avocats et Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme) lors du Dialogue national en 2014 ou qui ont permis de peser sur le débat constitutionnel en 2012-2013.
Sporadiques et circonscrits à des enjeux locaux ou catégoriels, les mouvements sociaux, fréquents, expriment l’urgence d’une transformation profonde. Le danger est qu’ils soient de plus en plus en plus instrumentalisés par des forces populistes et/ou extrémistes religieux qui, tout en se drapant d’un discours révolutionnaire, dénaturent des revendications sociales légitimes à l’instar, depuis 2017, du conflit d’El Kamour dans la région de Tataouine. Aucune force aujourd’hui n’apparaît en mesure de fédérer ces mécontentements.
Et plus précisément que la plan social (forte abstention par exemple)?
La Tunisie est arrivée à un stade alarmant de précarité, de détresse sociale et de pauvreté endémique. Un sentiment profond d'injustice, en particulier dans les régions de l’intérieur du pays et dans les quartiers populaires, se généralise, renforcé par celui d’être abandonné par la classe politique tout entière. Les décideurs sont considérés comme incompétents, corrompus et indifférents aux préoccupations du simple citoyen. Les jeunes désespèrent de la possibilité d'avoir un avenir, proche comme lointain, en Tunisie, compte tenu de l'absence d'une vision économique et sociale claire , capable de redonner espoir et de rompre avec la politique de colmatage pratiquée depuis 2011 et qui n’a fait qu’empirer la situation.
S’ajoute à présent, à ce sombre tableau, la crise de la Covid-19 qui frappe durement les petites entreprises et les couches populaires et aggrave les discriminations déjà criantes : 1 % de la population possédant 60 % des richesses nationales. Le PIB risque de connaître une chute brutale de près de 20 points au second semestre 2020 ; les recettes du tourisme ont diminué de près de la moitié au premier semestre de 2020 comparé aux six premiers mois de 2019. Une étude de l'Institut national des statistiques a également indiqué que 40 % des retraités (soit quelque 950 000 personnes) gagnent moins que le salaire minimum garanti d’un montant de 400 dinars par mois (soit 124 euros). Ainsi, le nombre de personnes vivant avec moins de 4,6 dinars par jour (1,5€) qui était de 1,7 million en 2015 pourrait dépasser les deux millions d’ici la fin de l’année, soit quelque 20 % de la population, ramenant le pays dix ans en arrière.
L’arrêt du recrutement dans la fonction publique (auquel Ennahda a recouru sans retenue – le nombre de fonctionnaires a plus que doublé en dix ans-) va de pair avec une augmentation du nombre des chômeurs (officiellement + 111 600 en 2020). Le taux de chômage est ainsi passé de 15 % en 2019 à 18 % en 2020.
Que traduit la multiplication des partis: un difficile apprentissage de la démocratie électorale? Des ambitions personnelles? Un éclatement de la société politique, chaque groupe poursuivant ses intérêts?
En dix ans, le nombre des partis politiques est passé de six (à l’époque de Ben Ali) à quelque 240 ! Au lendemain du 14 janvier 2011, sur la base d’un texte juridique inchangé, le ministère de l’Intérieur (chargé à l’époque de délivrer les visas) a légalisé plusieurs partis jusque-là interdits (des mouvances islamistes et d’extrême-gauche pour l’essentiel) et accordé tant de nouvelles autorisations qu’aux élections du 23 octobre 2011, leur nombre dépassait déjà la centaine. Cependant, la plupart d’entre eux n’ont pas d’activité réelle, se limitant à présenter des listes aux élections (non sans difficulté compte tenu du manque de candidats) et, pour beaucoup, à profiter des subsides accordés dans le cadre de la campagne électorale grâce à des dispositions particulièrement libérales. Ce développement débridé du nombre de partis a également été encouragé par un décret-loi d’octobre 2011 qui facilite leur création, notamment en transférant l’instruction des demandes au secrétariat du gouvernement et en allégeant considérablement la procédure de reconnaissance. En réalité, seule une trentaine de formations politiques sont actives sur le terrain. Soumis au verdict des urnes lors des scrutins successifs (élections de la Constituante en octobre 2011 puis législatives et présidentielle de 2014 et 2019), l’échiquier partisan s’est progressivement atomisé. A l’heure qu’il est, onze formations comptent des députés à l’ARP. Cet émiettement a généré une instabilité politique et gouvernementale chronique (soit neuf gouvernements en moins de dix ans), obéré la mise en place de politiques publiques et de réformes structurelles prenant en compte les attentes de la population et nui à la confiance des partenaires extérieurs.
L’atomisation du champ partisan est alimentée par un mode de scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste qui a fixé un seuil de 3% des suffrages exprimés pour qu’une liste obtienne un ou plusieurs sièges (il n’est pas rare de trouver dans la même circonscription un député élu par moins de 3 000 voix et un autre par 60.000 voire 80 000 voix). L’ARP est ainsi devenu le repaire d’ambitions personnelles, parfois mafieuses, l’immunité parlementaire conférant un statut d’impunité quasi-totale.
Le spectacle affligeant que donne à voir l’enceinte législative, que ce soit au travers des débats parlementaires, de l’inconstance des députés passant d’un groupe à l’autre au gré des circonstances et surtout du « plus offrant » (un homme d’affaires accusé de corruption et actuellement en prison ne se targuait-il pas de disposer d’un groupe de 30 députés !) et des renversements d’alliances. Bref, tout ceci concourt à dévoyer le suffrage universel ...et à écœurer les Tunisiens. Ce comportement sans foi ni loi, érigé en mode de gouvernance décrédibilise les partis qui prétendent exercer le pouvoir. Le parlement est devenu au fil des années une institution perçue comme «arbitraire», aux mains de quelques présidents de partis forts de leur seule légitimité électorale et agissant en dehors de tout contrôle. La Cour constitutionnelle est toujours dans les limbes, menacée par un projet de loi qui vise à soumettre son mode de désignation au bon vouloir des principaux groupes parlementaires. D’ailleurs, n’est-ce pas en contournant l’instance législative (l’Assemblée nationale constituante /ANC à l’époque) que la Tunisie est parvenue à trouver, grâce au Dialogue national, une issue à la crise politique de 2014 ? C’est à une situation de blocage comparable que nous sommes aujourd’hui confrontés.
En réalité, le régime politique post-révolution s’apparente à une partitocratie qui mine le processus de démocratisation Un simple rappel des pourcentages d’abstention et des scores des différentes formations en lice lors des échéances électorales depuis 2011 révèlent la fragilité de cette légitimité électorale et la représentativité toute relative de l’instance législative. Avec un taux d’abstention de 66 % et un score important des listes indépendantes qui ont recueilli plus de 30 % des suffrages, les élections municipales de 2018 ont été, elles aussi, un désaveu cinglant pour les formations politiques. De même, la déroute électorale des candidats de partis au scrutin présidentiel de 2019 illustre la montée en force des candidats qualifiés d’indépendants à commencer par l’actuel président et l’homme d’affaires, Nabil Karoui, les deux finalistes du second tour. Le premier continue de bénéficier de sondages très favorables alors que le second figure toujours parmi les présidentiables. K. Saïed n’a toujours pas créé de parti politique et ne semble guère en avoir l’intention comme il l’a déclaré à France 24 en juin dernier, estimant la durée de vie du système partisan en Tunisie à une décennie, au mieux deux... Ainsi, trois quarts des Tunisiens ne feraient pas confiance au Parlement, et par ricochet, au gouvernement puisque ce dernier doit obtenir la confiance de l’ARP. Il devient donc difficile (pour ne pas dire impossible) pour un gouvernement quel qu’il soit de faire adopter les réformes indispensables pour sortir le pays de l’impasse dans laquelle les partis politiques l’ont entraîné.
Ennahda après un premier succès aux législatives qui ont suivi la chute de Ben Ali semble affaibli. Qu'en est-il aujourd'hui de sa crédibilité dans la population?
Ennahda (La Renaissance) en tant que mouvement politico-religieux demeure un acteur politique majeur du pays et la principale force de la nébuleuse de l’islam politique en Tunisie de ces quarante dernières années. Sa trajectoire témoigne de sa capacité de résistance et d’adaptation. Ses principaux chefs condamnés à mort par Bourguiba en 1986, ont été graciés par Ben Ali après son coup d’État médical du 7 novembre 1987. Celui-ci les a associés au Pacte national de 1989. Unique candidat à la présidentielle de 1989, il bénéficiera alors de leur soutien, R. Ghannouchi, déjà président du mouvement, déclarant alors qu’il faisait confiance «à Allah et à Ben Ali» dont «la démarche réformiste doit permettre à la Tunisie de réussir à communiquer avec le réveil islamique, à le rationaliser et à l’intégrer à toutes les forces nationales». Les listes islamistes (listes sans étiquette) réalisent une percée électorale au scrutin législatif de 1989 (officiellement, 18% des suffrages). Ces élections seront suivies, deux ans plus tard, d’une répression implacable contre le mouvement (arrestations arbitraires, tortures, procès iniques, exil) qui ne prend fin qu’avec l’avènement de la Révolution de 2011 à laquelle les islamistes n’ont pas pris part (sceptiques, ils préconisaient la prudence). Le mouvement s’organise en quelque mois avec le soutien des Frères musulmans d’Égypte et des conservateurs américains et européens, notamment allemands qui, à l’époque, s’inspirant de l’exemple turc, faisaient la promotion de sa modération avec l’aide de quelques intellectuels complaisants. Depuis qu’elle a remporté les premières élections démocratiques de l’histoire du pays, celles de l’Assemblée nationale constituante / ANC du 23 octobre 2011, Ennahda est au pouvoir avec, comme objectif majeur, d’y demeurer coûte que coûte croyant (ou donnant à croire) que cela protège le mouvement de toute répression. La victimisation autant que la piété affichée sont un puissant facteur de propagande et de cohésion interne qui alimente alors l’adhésion d’une partie non négligeable de la société et l’empathie dans certains milieux à l’étranger.
En accédant aux commandes du pays, Ennahda a dévié le sens de la Constituante qui consistait à élaborer une Loi fondamentale dans un délai d’un an. En se maintenant trois ans au pouvoir avec deux autres partis (Ettakatol du social-démocrate Mustapha Ben Jaafar et le Congrès pour la République de Moncef Marzouki), elle a trahi le mandat confié par les électeurs tunisiens et provoqué une crise sans précédent, politique économique, sociale et identitaire allant jusqu’à vouloir remettre en cause des conquêtes sociales et civiques ayant fait date dans l’histoire du pays. La mobilisation citoyenne a néanmoins permis de sauvegarder le caractère civil de l’État (article 2 de la Constitution). Quant à l’article 1, adopté lors de la Constituante de 1959, il a été maintenu en l’état. Ambigu (« la Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, sa religion est l’islam, sa langue est l’arabe et son régime la République»), celui-ci permet une interprétation savamment développée par les ténors d’Ennahda qui font de l’Islam la religion de l’État et non celle du pays. La Constitution consacre un chapitre important aux droits et libertés dont la liberté de conscience et affirme l’égalité entre «les citoyens et les citoyennes», laissant ainsi espérer une mise en échec de l’islamisme politique sur les plans doctrinal et pratique puisque empêché de mettre en œuvre son projet de «réislamisation» de la société.
Ennahda a fini par s’aliéner de larges couches de la population qui ont pris conscience que le problème n’est pas l’islam, mais l’islam politique jugé incompatible avec la conduite d’un pays vers la liberté, la dignité et la démocratie et une gestion rationnelle et apaisée des affaires publiques. En 2014, les résultats des élections législatives et présidentielle ont donné la victoire à Nidaa Tounes, une constellation de forces dites modernistes et centristes (Bourguibistes, franges de la gauche, syndicalistes, indépendants) autour de feu Beji Caïd Essebsi, élu président de la République à l’âge de 89 ans avec, pour programme de «rééquilibrer le champ politique (rééquilibrage fondé sur une opposition forte à l’islam politique et à son représentant Ennahda) et de restaurer l’autorité de l’État» (dans la lignée de l’époque bourguibienne que la période de Ben Ali avait dénaturée) afin de mettre un terme à la gestion calamiteuse des Nahdaouis. Le fameux rééquilibrage a été dévoyé et s’est transformé en alliance avec Ennahda au nom d’un «nécessaire consensus» allant jusqu’à bloquer toute velléité de réformes, y compris celles initiées par B. C. Essebsi lui-même (épisode de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité – Colibe). Quant à l’autorité de l’État, elle a été vite oubliée au profit d’une dérive népotique qui a scandalisé les Tunisiens. Résultat: un quinquennat pour rien et une hécatombe électorale en 2019 qui a réduit à peau de chagrin les forces dites modernistes et/ou progressistes mais épargné Ennahda ! Certes, son score électoral a chuté de 40 % par rapport à 2014 (soit 561 132 voix contre 947 054 voix) et de 63 % par rapport à 2011 (où elle avait obtenu 1 501 320 voix), soit une érosion de son électorat de près d’un million de voix en moins en huit ans. Son groupe parlementaire est passé de la première place en 2011 avec 89 députés à 69 en 2014 (deuxième groupe derrière Nidaa Tounes) puis à 54 en 2019. D’aucuns ont alors dit qu‘Ennahda s’est réduite à son pré carré naturel. La formation islamiste ne s’en est pas moins maintenue au pouvoir, retrouvant, bien qu’affaiblie la première place à l’ARP, en 2019, permettant ainsi à R. Ghannouchi d’en prendre la présidence et de devenir ainsi selon l’ordre protocolaire, le deuxième personnage de l’État. Et ce grâce aux voix des députés de Qalb Tounes dont le mentor, N. Karoui, avait pourtant mené une campagne électorale anti-Nahdha si énergique qu’elle lui avait valu d’être emprisonné, lui dont l’Isie avait précédemment validé la candidature! Par ailleurs, un des facteurs de cette «réussite» revient à une loi électorale devenue inadaptée et dont Ennahda tire avantage ainsi qu’à une mise au pas de l’instance électorale par le biais d’une modification législative contestable. Un exercice dans lequel les islamistes excellent.
Ennahda bénéficie du soutien du Qatar – le financeur de «l’islamisme démocratique» et de la Turquie dont le président endosse le costume de guide de l'Oumma islamique. Durement réprimés depuis 2013, les Frères musulmans égyptiens, longtemps premier soutien de leurs congénères tunisiens, ne jouent plus un rôle déterminant. La montée des salafistes et de leur frange jihadiste, soutenue, ouvertement ou en sous-main, par les islamistes tunisiens a déclenché de vives réactions de la part du voisin algérien ainsi que des bailleurs de fond occidentaux, par ailleurs perplexes face au piteux état des finances publiques du pays provoqué par les milliers d’embauches clientélistes des dirigeants islamistes.
La découverte, en 2018, d’une organisation secrète aux membres réputés proches ou issus des rangs d’Ennahda et qui serait impliquée dans plusieurs assassinats politiques à commencer par ceux, perpétrés en 2013, des militants progressistes Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a accentué une suspicion déjà tenace sur le mouvement. La lenteur de l’instruction de cette affaire devenue une affaire d’État est symptomatique des méandres d’une justice à l’évidence sous influence. «Modérés», les islamistes affirment l’être devenus en avançant qu’ils ont cédé sur l’essentiel: point de charia dans la Constitution (mais «le sacré» que la Constitution fait obligation à l’État de protéger réintroduit subrepticement la charia !). Démocrates, ils le seraient aussi puisqu’ils ont accepté l’alternance voire même, avant 2014, de ne pas avoir de ministres islamistes au gouvernement comme c’est d’ailleurs aussi le cas, actuellement, avec le gouvernement Mechichi. Mais garder la main sur l’ARP n’est-il pas le plus important ? Ce qu’on appelle le double discours des islamistes a une double fonction : composer avec les «partenaires» à l’intérieur et rassurer les chancelleries occidentales. Hier, quand on défendait leur droit à l’existence et qu’on dénonçait la répression sans pitié qui les visait, on disait : il faut les prendre au mot. L’expérience a démontré qu’il faut aussi se méfier de cette duplicité.
Le rôle des femmes dans la société aujourd'hui? Elles mènent un combat pour la défense de leurs droits qui suppose une forte détermination. Elles sont parfois soutenues dans leur combat par des hommes: est -ce seulement dans les grandes villes en milieu urbain et éduqué? Ce qui donnerait à penser que la société tunisienne est désormais très polarisée comme, hélas, nombre de sociétés aujourd'hui
Au regard de la législation de la famille et des acquis réalisés depuis l’indépendance du pays en 1956, les femmes tunisiennes jouissent d’une situation unique si on la compare aux autres pays arabes. Il y aurait matière à s’interroger sur l’apport de la Révolution à leur émancipation, elles qui ont été présentes à toutes ses étapes, occupant une place centrale dans son déroulement ainsi que dans la transition démocratique. Mais aujourd’hui, on doit légitimement s’inquiéter des possibles remises en cause de ces acquis avec la montée des forces conservatrices. Par ailleurs, les avancées importantes réalisées sur les plans politique, social, professionnel, éducatif et économique ne doivent pas cacher les fortes inégalités et discriminations ainsi que les nombreuses violences dont elles sont victimes. En attestent les âpres débats autour du rapport de la Colibe, une commission nommée par Béji Caïd Essebsi et présidée par la militante féministe et défenseure des droits humains, Bochra Bel Haj Hamida ainsi que les campagnes haineuses qui ont visé sa présidente et ses membres, s’agissant en particulier de l’égalité dans l’héritage, question qui concerne plus encore les femmes rurales qui travaillent la terre que les hommes possèdent.
La Constitution de 2014 a consacré le principe d’égalité en matière de citoyenneté, de travail, de l’égalité des chances pour l’accès aux responsabilités dans tous les domaines ainsi que celui de la parité en ce qui concerne les conseils élus de même que des garanties en vue d’éliminer la violence contre les femmes. Mais la réalité est tout autre. En 2020, la Tunisie compte un peu plus de femmes (50,2 %) que d’hommes sur une population totale de près de 12 millions d’habitants. Les femmes ont deux fois moins de droits que les hommes selon un rapport récent de la Banque mondiale (Les femmes, l’entreprise et le droit, 2019). Pour preuves, le taux de chômage des femmes est près du double de celui des hommes et celui des diplômés du supérieur touche deux fois plus les filles que les garçons alors que le pourcentage des filles diplômées est plus de deux fois supérieur à celui des garçons. Les disparités les plus criantes sont dans les zones rurales que ce soit en matière de salaire (de 25 % à 50 % inférieur pour les ouvrières agricoles), de conditions de travail (pénibilité et précarité du travail) et de protection sanitaire et sociale qui échappe à tout cadre légal. L’abandon scolaire (35 000 enfants par an avant 2011, plus de 100 000 par an depuis) touche davantage les filles de 10 à 12 ans. Selon l’UGTT, les jeunes filles en-dessous de l’âge légal de travailler (16 ans) sont contraintes de quitter l’école et de chercher du travail en usine ou en tant qu’employées de maison. Sans parler du secteur informel où l’emploi des femmes est nettement plus développé.
Bien qu’une loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes ait été adoptée en juillet 2017, les statistiques comme des faits tragiques tel que le meurtre crapuleux de la jeune Rahma Lahmar en septembre 2020, nous rappellent l’ampleur de ce phénomène et la nécessité urgente de mettre en place un dispositif global alliant mesures législatives de protection et de réhabilitation des victimes et poursuites judiciaires des auteurs de violences.
La représentation des femmes à l’ARP reste minoritaire voire diminue: moins du quart des députés en 2019 contre plus du tiers en 2014 en dépit d’une loi électorale qui consacre la parité. Leur nombre dans les gouvernements successifs (souvent pléthoriques) dépasse rarement les doigts de la main. Sans parler des partis politiques où on peine à les trouver aux postes de direction.
Les Tunisiennes n’en continuent pas moins leur ascension sociale et professionnelle, investissent l’espace public comme l’ont montré leur forte présence parmi les cadres hospitaliers durant la pandémie ou encore le dynamisme des organisations féministes à commencer par l’Association tunisienne des femmes démocrates. Ce rôle croissant contre vents et marées donne des sueurs froides aux conservateurs de toutes sortes mais trouve une résonnance encourageante dans les milieux progressistes (pas uniquement féministes) qui puisent dans l’histoire récente et lointaine du pays les raisons de poursuivre la lutte pour une égalité totale. Égalité sans laquelle la démocratie demeurera boiteuse. Telle est ma conviction. Même si j’ai parfois l’impression que celles et ceux qui la partagent se sentent un peu seul(e)s par les temps qui courent...
Nombre de jeunes Tunisiens sont partis en Irak mener le combat pour Daech, pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
Autre paradoxe: le pays qui a déclenché le «printemps» et inspiré les autres soulèvements arabes et dont la société civile a été nobélisée en 2015, ce même pays fournit des contingents de jeunes fanatisés à bloc par la radicalisation islamiste pour servir de chair à canon à des groupes de jihadistes à des milliers de kilomètres du pays. Ce passage du statut de victime (économique, sociale, etc.) à celui de bourreau et d’implacable guerrier d’une utopie mortifère interpelle tout un chacun.
Je n’ai pas d’explication «consensuelle» à ce phénomène qui a fait l’objet de nombreux travaux où les experts, sociologues et psychologues rivalisent de propositions et de médiations. Disons qu’on entend souvent deux types d’interprétation. L’interprétation sociale selon laquelle le jihadisme se nourrit du désespoir de la jeunesse marginalisée dans les quartiers suburbains (en Tunisie comme en France) ou dans les régions oubliées du développement. Le jihad serait l’expression extrême de la révolte de la Tunisie oubliée contre la «Tunisie utile» ou l’Occident colonial. L’interprétation culturaliste de son côté perçoit la radicalisation comme un avatar monstrueux de l’islam politique voire de l’islam tout court. Elle traduit l’émergence d’une nouvelle génération en forme de nébuleuse travaillée par un principe d’alliances autant que de conflits (Daesh, Ansar-acharia, El Qaeda) et dont le rigorisme verse dans une violence apocalyptique, Les deux approches peinent à expliquer l’enrôlement dans le jihadisme de «jeunes» intégrés au système scolaire et issus de la classe moyenne (25 % des jihadistes français partis au Moyen-Orient sont des «français de souche» provenant de milieux sociaux divers). D’un autre côté, la notion de dérive post-islamiste est inopérante car elle n’explique pas le bagage religieux ultraléger (ultra et léger) exhibé parfois par des repris de justice «convertis» par des imams eux-mêmes quasi incultes. La formule d’Olivier Roy, peut-être un peu lapidaire - «il ne s’agit pas de radicalisation de l’islam mais de l’islamisation de la radicalité» fait mouche en soulignant que, souvent, la dérive violente précède la revendication idéologique.
La tentation du jihad intervient dans un contexte de double délitement du lien social et du lien national: lorsque des franges de la jeunesse se retrouvent littéralement «hors circuit». Mais le passage à l’acte, c’est-à-dire la violence radicale, n’est pas pour autant automatique. Ce constat amène à prendre en compte un autre élément: le fait que le sentiment d’appartenance à une entité nationale, à une patrie se trouve affecté par le processus de désocialisation. La collusion entre contrebande et terrorisme qui advient ici et là (sans être généralisée) est une illustration de la concomitance du double processus de désaffiliation sociale et nationale. La «radicalisation» (le jihad) apparaît comme une identité de substitution à ceux qui ne se sentent plus d’identité.
Le contexte post-révolution, qui a ouvert un espace d’expression débridée où la liberté et le fanatisme ne pouvaient faire bon ménage, va alimenter un engrenage favorisant l’épanouissement du salafisme en général et du salafisme jihadiste en particulier. Cet engrenage va s’emballer à la faveur de la libération et de l’amnistie de chefs jihadistes immédiatement héroïsés, du laxisme coupable de certains gouvernants (par naïveté ou par calcul), de la guerre des mosquées, des tentes de prédication et des kermesses de takfir, notamment à Kairouan. Le renoncement social, la vacance d’autorité étatique et une certaine cécité politique, il faut le dire, ont réuni les conditions pour le développement de ce fléau des Monts Chaambi (à la frontière algéro-tunisienne) au Moyen-Orient en passant par l’Europe.
La radicalisation «à la tunisienne» est l’histoire d’un immense gâchis qui a conduit à la prolifération d’un phénomène quasi inexistant au préalable. Le tout dans un contexte géopolitique marqué par un marché mondialisé du terrorisme où le libre échange triomphe.
Que pensez-vous qu’il faille adopter comme politique publique face à ce fléau?
Pour pouvoir combattre le terrorisme et la violence, il faut avoir le courage et la détermination de comprendre ce qui nous arrive à nous les Tunisiens. Jamais un débat national n’a été organisé sur cette question. Aussitôt annoncé, sitôt abandonné. Les appels n’ont pas manqué mais n’ont jamais été entendus. Surtout au lendemain des actes terroristes qui ont endeuillé le pays (des assassinats de C. Belaïd et M. Brahmi aux attaques contre l’armée et les forces de sécurité, de l’attentat du musée de Bardo à celui de Sousse ou à ceux de Tunis,). Comme si on voulait fuir, ne pas regarder ce qui nous mine.
Pour l’avoir vécu quand j’étais chargé par le chef de gouvernement Habib Essid, au lendemain de l’attentat de Sousse (2015), de la préparation d’un congrès national sur le terrorisme, j’ai pu mesurer les résistances et la lâcheté de beaucoup. Plus de deux mois de préparations et de tergiversations n’ont abouti à rien. Il était urgent de ne rien faire et d’attendre ! Il est clair que les hautes sphères de l’État et les principaux partis politiques ont préféré temporiser en donnant des gages à Ennahda (partie prenante au gouvernement) laquelle craignait (non sans raison) que pareil congrès ne se transforme en procès à charge. Il m’était alors apparu combien le désarroi de nos dirigeants était grand face à l’absence d’une véritable stratégie contre le terrorisme. Depuis, un certain nombre de mesures ont été prises avec, parfois, des résultats significatifs sur le plan sécuritaire. Mais sans aborder les faiblesses qui nécessitent une refonte totale de notre approche.
En effet, toute notre manière d’envisager, de dire et de faire de la politique est aujourd’hui en jeu. Trois mots peuvent résumer les défis auxquels la Tunisie est confrontée: réhabiliter l’État, faire société et faire nation. La réhabilitation de l’État comme unique détenteur de la violence légitime fondé sur l’État de droit qui soit aussi un État social qui doit s’attaquer réellement aux rapports incestueux entre la politique et l’argent qui gangrènent la classe politique, ruinent toute velléité de réforme et dont la persistance discrédite a priori, aux yeux du peuple, les efforts les plus sincères. Faire société, c’est-à-dire retisser le lien social, reparler et agir social. Le discours de l’État lui-même est important mais il l’est encore davantage s’il s’accompagne dans l’immédiat de gestes symboliques forts en direction des couches et des régions déshéritées comme autant de signaux d’un engagement durable pour des réformes sociales profondes qui ne peuvent advenir ni d’un coup, ni d’un seul tenant. La réforme de l’enseignement doit être au cœur du dispositif. Faire nation, valoriser l’appartenance à la nation sans fétichiser la dite exception tunisienne. Le lien national ne peut se limiter aux seuls attributs culturels et territoriaux : il nous faut promouvoir une sorte de «patriotisme constitutionnel», comme on dit en Allemagne, qui mobilise autour des valeurs essentielles de notre Loi fondamentale et donne du sens au travail pour le bien commun. La Constitution dont la Tunisie s’est dotée est une grande avancée dans ce sens malgré les ambiguïtés et les dysfonctionnements inhérents au type de régime tel qu’il a été constitutionnalisé. Ce patriotisme-là n’est pas réductible au patrimoine que nous ont légué les pères fondateurs de notre modernité. Il ne sera pas le produit d’une action bienfaisante de l’État mais la résultante de petites et de grandes mobilisations politiques, sociales, économiques, intellectuelles, culturelles, pédagogiques incluant tous les acteurs de la compétition démocratique, au premier chef les acteurs de la société civile.
Encore un mot sur un autre chantier important qu’on tarde à entamer: celui qu’on peut appeler la politique religieuse. L’expression peut choquer. Les « religieux » disons intégristes vont objecter que le religieux ne peut être soumis à la politique et le sacré géré par le profane. Les puristes de la «laïcité» veulent quant à eux cantonner le religieux à la sphère domestique. Comment, dans ce cas, organiser le vivre ensemble ? Si l’État ne doit pas se mêler de la foi, il est tenu de s’occuper de la dimension collective, sociale de la religion et de protéger le culte. Il y a une politique religieuse (en l’espèce une politique de l’islam) comme il y a une politique culturelle, éducative etc. Il s’agit d’organiser l’exercice du culte dans l’espace public (la gestion des mosquées, les fêtes religieuses, le pèlerinage…), l’enseignement de la religion, le statut personnel et les questions matrimoniales : autant de question qui doivent relever de l’État et non de l’interventionnisme cacophonique d’une nébuleuse d’associations plus au moins contrôlées.
L’affaissement de l’État consécutif à la Révolution a créé une situation propice à de graves dérives : l’annexion d’une partie des mosquées par le takfirisme; la confusion entre la prédication et le savoir religieux, ce qui a permis la promotion de prédicateurs à la tête d’institutions religieuses y compris à la mosquée Zeytouna mais aussi dans les médias ; la prolifération d’associations «religieuses» hors de tout contrôle; d’écoles maternelles évoluant en dehors de l’Éducation nationale et de ses normes; les attaques contre les artistes, les intellectuels libres penseurs…Tout cela a profité du laxisme et de l’obsession identitaire qui donnaient des ailes aux extrémistes. La référence dans la Constitution à la liberté de croyance et conscience (art.6) ne semble pas avoir eu, jusqu’à nos jours, une traduction dans les faits. La remise à plat de la politique religieuse pour traduire ce que B. C. Essebsi avait résumé en une phrase «un pays musulman et un État civil» est un travail urgent même s’il est de longue haleine et qu’il doit associer tous les acteurs. Faute de quoi, on est condamné à subir pendant longtemps les méfaits des prédicateurs qui affichent leur piété exhibitionniste en guise de compétence avec la complaisance de certains partis et médias, à laisser les mosquées (près de 6 000 en Tunisie) devenir des tribunes politiques et des lieux de mobilisation électorale pour islamistes et les salafistes (la Constitution demeure ambiguë à ce sujet puisqu’elle ne parle que de prohiber les activités partisanes dans les mosquées) et à maintenir la situation de non droit qui régit aujourd’hui les associations religieuses, laissant la porte ouverte à toutes les dérives et à tous les abus.
Que reste-t-il de la fierté et de la joie du peuple tunisien à avoir été le premier des États arabes à faire tomber son dictateur?
En 2011, notre fierté était immense, flattés que nous étions par le reste du monde. «Tunisiens restez débout, le monde est fier de vous» (disaient les murs de la médina). Aujourd’hui, celle-ci bat de l’aile. Altérée, elle n’en demeure pas moins enfouie au fond de chacun d’entre nous, comme une sorte d’antidote au découragement.
Au nombre des acquis jusqu’à présent sauvegardés, la liberté de parole longtemps étouffée. Aujourd’hui, on peut dire ce qu’on pense, s’exprimer, écrire, critiquer le gouvernement, les instances sans être inquiété, n’était-ce l’auto-censure qui persiste en raison de la peur diffuse du « regard de la société » et des tabous séculaires qui pèsent encore de tout leur poids. Cette indéniable liberté a des effets pervers: l’emprise des forces de l’argent sur le paysage médiatique livré à la médiocrité, aux invectives et à la désinformation. Il n’est pas rare, par ailleurs, que des poursuites judiciaires soient engagées pour fait d’opinion. Il n’empêche. Des journaux et des journalistes, des jeunes militants, des blogueurs et des artistes, des féministes, des acteurs associatifs, des syndicalistes et des forces politiques se battent et résistent pour défendre cet acquis précieux. Une liberté que les Tunisiens ne me semblent pas disposés à sacrifier, en particulier les jeunes.
Ensuite, le droit de choisir ses responsables au suffrage universel direct et libre est une autre source de fierté. La Tunisie a connu plusieurs élections majeures depuis 2011 au déroulement sans incident majeur et dont les résultats, acceptés, ont permis des alternances pacifiques. C’est un bien rare que nous envient les peuples de la région. La forte participation des jeunes en 2019, contrairement aux précédentes échéances électorales de 2011 et de 2014, l’atteste même si celle-ci est motivée par un certain «dégagisme» à l’égard du système politique.
Le fait que le pays n’a pas sombré dans le chaos - comme le prédisent régulièrement les Cassandre - à l’instar d’autres pays de la région, en dépit de la gravité de ses crises et des pressions fortes qu’il subit est une source à la fois de soulagement et de dignité. Il y a comme une résilience, une singulière obstination de cette Tunisie «unique rescapée des printemps arabes». D’aucuns l’imputent aux traits de modération des Tunisiens, à leur penchant au dialogue et au compromis. Caractéristiques et habitudes forgées par une longue histoire où le réformisme tunisien mais aussi le syndicalisme a joué un rôle déterminant. Vision parfois idéalisée certes, mais qui a permis de surmonter des crises graves et d’éviter à chaque fois le pire. Mais au prix du report incessant des arbitrages indispensables dans des domaines clés, donnant le sentiment (faussement rassurant) de préserver des équilibres instables alors que ceux-ci ne font que pérenniser des injustices et des inégalités génératrices de tensions et de conflits.
Au lendemain du 14 janvier 2011, date de la fuite de Ben Ali, comme au cours des crises successives qu’a connues le pays, l’État a tenu bon, ne s’est pas effondré. L’administration, les banques, les entreprises, les écoles, la poste, les transports ont continué à fonctionner dans un contexte d’insécurité et de tension parfois extrême. L’armée nationale s’est distinguée par son loyalisme et son esprit républicain, faisant alors la fierté des Tunisiens. L’armée continue de jouir de l’estime et du respect d’une forte majorité d’entre eux si l’on en croit les sondages. Les rapports avec la justice et les forces de sécurité internes (la police et la gendarmerie) sont plus compliqués étant donné leur passé répressif et leur forte propension à reproduire les mauvaises habitudes d’antan. Mais les sacrifices de ces dernières dans la lutte contre le terrorisme n’en sont pas moins régulièrement salués. L’État est à la fois source de fierté quand il défend la société et de craintes quand il est travaillé par des tentations autoritaires et liberticides (comme en témoigne le projet de loi sur la protection des forces de sécurité). Notre fierté et notre dignité retrouveront véritablement leur raison d’être quand on reprendra le chemin des réformes visant à faire de la Tunisie un État intègre, social et démocratique.
Interview in Hérodote n°180, 1er trimestre 2021. Hérodote, Revue de Géographie et de Géopolitique (herodote.org)
Beatrice Giblin
1) Défenseur des droits de l’homme, président du réseau Euromed-Droits (2004-2012), ancien président de l’Instance indépendante pour les élections (2011-2014) et ancien ministre (2015-2016). Entretien réalisé le 15 novembre 2020.
- Ecrire un commentaire
- Commenter