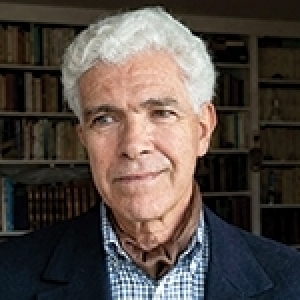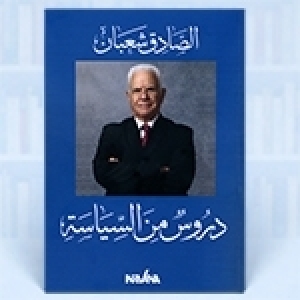Ammar Mahjoubi: protéger le sacré du profane

.jpg) Je n’ai pas pu retrouver, parmi mes livres, celui très vieux de Roger Caillois, l’Homme et le Sacré que j’avais lu à l’époque lointaine de mes études ; mais je viens de parcourir une contribution de cet auteur au tome XIX de l’Encyclopédie Française, à laquelle cet article est en partie redevable. Le sacré y est présenté comme la catégorie fondamentale de la sensibilité religieuse, l’idée-mère de la religion, celle qui lui confère son caractère spécifique. C’est ce sentiment du sacré qui impose au fidèle un respect singulier, une vénération particulière, qui prémunit sa foi contre le doute, l’esprit d’examen, qui le place dans une sphère située au-delà de la raison. Les manifestations de la vie religieuse, plurielles et diverses, apparaissent alors comme autant de rapports entre l’homme et le sacré : dogmes, croyances, mythes qui développent ces rapports, les détaillent, rites qui en rassurent la pratique.
Je n’ai pas pu retrouver, parmi mes livres, celui très vieux de Roger Caillois, l’Homme et le Sacré que j’avais lu à l’époque lointaine de mes études ; mais je viens de parcourir une contribution de cet auteur au tome XIX de l’Encyclopédie Française, à laquelle cet article est en partie redevable. Le sacré y est présenté comme la catégorie fondamentale de la sensibilité religieuse, l’idée-mère de la religion, celle qui lui confère son caractère spécifique. C’est ce sentiment du sacré qui impose au fidèle un respect singulier, une vénération particulière, qui prémunit sa foi contre le doute, l’esprit d’examen, qui le place dans une sphère située au-delà de la raison. Les manifestations de la vie religieuse, plurielles et diverses, apparaissent alors comme autant de rapports entre l’homme et le sacré : dogmes, croyances, mythes qui développent ces rapports, les détaillent, rites qui en rassurent la pratique.
Le sacré se manifeste comme un attribut fixe, stable, ou seulement comme une vertu éphémère,  provisoire. Il concerne et affecte certains objets, comme les instruments du culte chrétien, certaines personnes, l’imam conduisant la prière, ou le prêtre prononçant la messe, quelques espaces, comme la mosquée, l’église ou le temple, certaines journées enfin ou certains temps, comme le vendredi ou le dimanche, le jour du Mouled ou de Noël, le mois de Ramadan. Une grâce mystérieuse leur confère, par moments ou durablement, une qualité transcendante qu’ils ne possèdent pas en eux-mêmes. Tous, objets, êtres, temps et espaces sont parés par le fidèle ou sa communauté d’un prestige inégalable. Ils s’en trouvent transfigurés et on se comporte différemment à leur égard. Suscitant un sentiment de respect, mêlé d’effroi, ils apparaissent comme un interdit, un haram, dont on n’approche pas sans appréhension. Malheur à celui qui forcerait l’interdit ! Le don de fascination du sacré est tel que la suprême tentation qu’il inspire recèle en même temps le plus grand des périls, commandant ainsi la prudence et invitant pareillement à l’audace.
provisoire. Il concerne et affecte certains objets, comme les instruments du culte chrétien, certaines personnes, l’imam conduisant la prière, ou le prêtre prononçant la messe, quelques espaces, comme la mosquée, l’église ou le temple, certaines journées enfin ou certains temps, comme le vendredi ou le dimanche, le jour du Mouled ou de Noël, le mois de Ramadan. Une grâce mystérieuse leur confère, par moments ou durablement, une qualité transcendante qu’ils ne possèdent pas en eux-mêmes. Tous, objets, êtres, temps et espaces sont parés par le fidèle ou sa communauté d’un prestige inégalable. Ils s’en trouvent transfigurés et on se comporte différemment à leur égard. Suscitant un sentiment de respect, mêlé d’effroi, ils apparaissent comme un interdit, un haram, dont on n’approche pas sans appréhension. Malheur à celui qui forcerait l’interdit ! Le don de fascination du sacré est tel que la suprême tentation qu’il inspire recèle en même temps le plus grand des périls, commandant ainsi la prudence et invitant pareillement à l’audace.
Mais la force que recèlent l’être ou la chose consacrés est toujours prête à se répandre, à se décharger. Aussi faut-il protéger le sacré du profane, de son atteinte souillante, qui altère son être, détruit ses qualités spécifiques, l’absorbe à le vider de la vertu puissante et fugace qu’il recèle. Certes, le profane est aussi inconsistant que le néant en face de l’être, mais un néant actif, qui se dégrade et avilit. Aussi faut-il dresser une cloison étanche pour protéger le sacré. «Les deux genres ne peuvent se rapprocher et garder en même temps leur nature propre», note Durkheim, mais tous deux sont indissolubles, indispensables au développement de la vie, l’un en tant que milieu de son déploiement, l’autre comme source inépuisable qui la crée, assure son maintien et son renouvellement.
Le croyant attend du sacré tout secours véritable, toute réussite accomplie. Il lui impute son bonheur, ses succès. Quant aux malheurs, aux échecs, il les attribue au diable, ou à quelque principe qu’il s’efforce d’infléchir, ou même, par la prière ou les incantations, de contraindre. Peu importent les origines de cette grâce ou de ces épreuves ; le Dieu omnipotent des religieux monothéistes, les divinités païennes, les âmes des morts, la force diffuse et indéterminée, qui donne à chaque objet la maîtrise de sa fonction, ou encore l’aliment approprié, qui sont tous des réceptacles de cette force sacrée, de cette force redoutable. Cette force qui, dans sa forme élémentaire, est une énergie dangereuse, incompréhensible, mais extrêmement efficiente.
Alors que dans le domaine du profane les actes individuels ou collectifs sont libres, dans les limites des lois humaines, on est dans le domaine religieux face à une multitude de prohibitions dont beaucoup sont plus ou moins arbitraires, ou même totalement inexplicables. Les interdits du profane sont d’ordre juridique et, plus ou moins rationnels, ils sont généralement justifiés par l’intérêt du groupe. Ceux du religieux sont, par contre, toujours primordiaux, transcendants, que ce soit dans la religion la plus fruste, ou dans celles où les subtilités théologiques sont les plus complexes. La Bible ne commence-t-elle pas par un interdit fondamental : celui de manger le fruit d’un certain arbre?
Les rapports du sacré et du profane doivent être sévèrement réglés : c’est la fonction des rites. Positifs, ils transforment la nature du profane ou du sacré selon les besoins de la société ; négatifs, ils empêchent tout contact inopportun entre le sacré et le profane. Les positifs sont les rites de consécration, qui introduisent l’être ou la chose dans le monde du sacré et les autres, des rites d’expiation qui, à l’inverse, rendent l’être ou l’objet pur ou impur au monde profane. Quant aux prohibitions, qu’on désigne par le nom polynésien de tabou, elles élèvent entre sacré et profane une barrière isolante, susceptible de prévenir les catastrophes. «On appelle de ce mot (tabou), écrit Durkheim, un ensemble d’interdictions rituelles, qui ont pour effet de prévenir les dangereux effets d’une contagion magique, en empêchant tout contact entre une chose ou une catégorie de choses, où est censé résider un principe surnaturel, et d’autres qui n’ont pas ce même caractère, ou qui ne l’ont pas au même degré.»
Destiné à maintenir l’intégrité du monde organisé, ainsi que la bonne santé physique et morale de l’être qui l’observe, le tabou est un impératif catégorique négatif, car il est toujours interdiction et défense et n’est jamais prescription. Il ne faut pas l’enfreindre parce qu’il définit de façon absolue le licite et l’illicite, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, sans aucune justification morale. Chaque transgression provoque maladies et catastrophes. Ce n’est pas la seule personne du coupable qui est mise en danger, mais l’ordonnance du monde dans son ensemble ; les désordres, les troubles occasionnés la détraquant de proche en proche. Dangereux, le domaine du sacré est ainsi celui de l’interdit ; on ne s’en approche pas sans risquer de mettre en branle des forces devant lesquelles la faiblesse de l’homme est désarmée. Mais sans leur secours, tout espoir, toute ambition sont voués à l’échec. Ces forces sont la source de toute réussite, de toute fortune, de toute puissance, mais tout en les sollicitant, on doit redouter d’être leur victime.
Objet d’épouvante et de convoitise, le sacré exprime la pluralité religieuse en apparaissant sous les formes antagonistes du pur et de l’impur. Tour à tour attribués à tel être, à tel objet, à tel état, selon leur développement dans un sens bénéfique ou maléfique, ces qualifications leur conviennent mêmement et soulignent ainsi l’ambiguïté du sacré. Aussi suscite-t-il, à la fois, chez le fidèle, la peur que ce sacré survienne pour son malheur et l’espoir qu’il s’empresse à son secours. Ambivalence fortement soulignée dans le mot arabe , qualifiant en particulier le «Saint des Saints», l’édifice sacré de la Ka’aba . Tant qu’elle demeure virtuelle, cette force du sacré est toujours ambiguë ; mais en passant à l’acte, elle devient univoque et on sait alors qu’on est face à l’impur, qui pénètre au tréfonds de l’être, ou à l’inverse face à la pureté, synonyme de santé et susceptible d’atteindre la sainteté. Souillure et sanctification qui sont les deux pôles même dans les civilisations les plus avancées. C’est ainsi qu’à l’exemple du mot arabe haram, qui qualifie mêmement ces deux pôles, le mot agos signifie en même temps, à l’époque grecque archaïque, la souillure et le sacrifice qui efface la souillure. A Rome, sacer désigne «celui ou ce qui ne peut être touché sans être souillé, ou sans souiller». Lorsque le peuple assemblé déclare quelqu’un sacer, il le retranche de la communauté, car il a commis un crime à l’encontre de la religion de l’Etat, mais il y a toujours risque mystique à le tuer. Avec un double sens de « sacré » et de «maudit», le coupable est voué aux dieux des enfers.
Plus la force du sacré est intense, plus son efficacité est prometteuse. Il en découle la tentation de l’invoquer pour changer la souillure en bénédiction, avec un recours au prêtre, au Saint, qui peuvent approcher l’impureté sans crainte et qui connaissent les rites qui les préservent de ses méfaits, possédant seuls le pouvoir et connaissant les moyens de transformer une menace de mort en garantie de vie. Mais l’impureté, à l’inverse, peut aussi procurer une force mystique à l’être qui s’est exposé victorieusement au sacrilège : Œdipe, après le parricide et l’inceste, après ces abominations, apparaît, lorsqu’il met le pied sur le territoire d’Athènes, comme paré, nimbé de sacré et devient source de bénédiction. Par sa violation de la loi la plus sainte, il s’est acquis le dangereux concours des forces surnaturelles.
Obéissant à la maxime quieta non movere, la vie religieuse est d’ordinaire paisible et routinière ; mais à cette quiétude s’oppose l’effervescence de la fête. Ses manifestations extérieures sont, dans toutes les civilisations, identiquement récurrentes : un paroxysme de vie et le grand concours d’un peuple agité et bruyant, qui favorise la propagation d’une exaltation intense, exprimée par des gestes et des impulsions irréfléchies. Oubliant les soucis de la vie quotidienne, les fêtards vivent des instants d’exception. Dans les sociétés primitives, ils sortent les masques, qui les transforment en dieux, esprits, ou en animaux-ancêtres, dotés de forces surnaturelles terrifiantes ; forces fécondantes qui sont censées revigorer la société et revivifier la nature. Le porteur de masque s’incarne à ces puissances, il les mime au point qu’aliéné, en proie au délire, il se croit véritablement le dieu dont il a pris, par ce déguisement puéril, l’apparence. C’est lui le dieu qui fait peur, la puissance inhumaine et monstrueuse. La simulation aboutit à une possession qui n’est pas simulée. Dans un passé récent, un vague souvenir de ces fêtes primitives avait survécu dans notre pays. Il advenait alors aux fêtards, dans des quartiers populaires, d’organiser des Aïssaouia ou des Stanbali, dont les officiants, blancs dans les premiers cas et toujours noirs dans l’autre, étaient saisis, dans leurs délires, d’un égarement tel qu’ils avalaient des clous et se tailladaient le corps. Après ce délire, cette frénésie, l’acteur émerge dans un état d’hébétude et d’épuisement, qui ne lui laissent qu’un souvenir confus de ce qui s’était produit en lui, sans lui. Les invités de la fête sont complices de ces convulsions sacrées et certains parmi eux participent à la danse, prélude à l’excitation ascendante, au vertige de l’aliénation.
Mais si, de nos jours, le sacré reste, dans nombre de civilisations, «la catégorie fondamentale de la sensibilité religieuse», la civilisation occidentale contemporaine a, pour une large part, réussi à le détourner du domaine religieux, à son remplacement, sa commutation en un sacré en quelque sorte laïque et purement humain. Le sacré traditionnel des religions est remplacé par la valeur suprême qu’on vénère, par ce à quoi on sacrifierait, au besoin, sa vie. La laïcité, en France, la liberté d’expression, érigées en valeurs universelles…Au sacré religieux a succédé un sacré profane. Ce sont ces valeurs qui sont devenues sacrées. C’est aussi l’être, la chose ou l’idée, qu’on n’accepte pas de mettre en discussion, de voir bafouer, de devenir objet de plaisanterie, comme le racisme, l’antisémitisme…C’est ce qu’on ne renierait ou ne trahirait à aucun prix. Même si le sentiment qui pousse l’homme à élever des temples est loin d’avoir disparu, même si islamisme d’un côté et néo-évangélisme de l’autre ne sont que des exacerbations maladives…mais qui perdurent et se répandent.
Ammar Mahjoubi
- Ecrire un commentaire
- Commenter