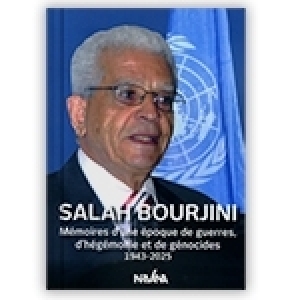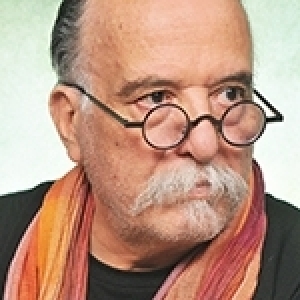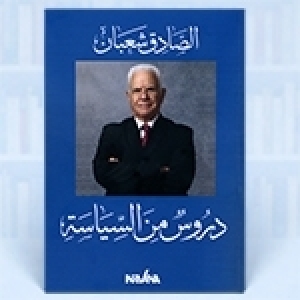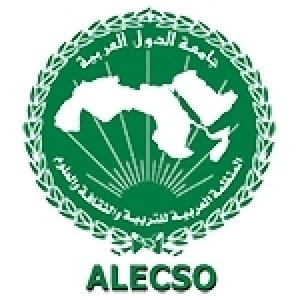Mohamed Fessi : Le cercle vicieux des crises budgétaire, bancaire et monétaire

Par Mohamed Fessi - Même si je n’ai jamais été un adepte du « Ah ! C’était mieux avant », force est de reconnaitre, qu’avant, c'est-à-dire, dans les décennies 1990 et 2000, les fondamentaux de l’économie tunisienne étaient sains, avec une classe moyenne qui grossissait et une mobilité sociale qui permettait aux enfants de réussir mieux que leurs parents. (En disant cela je n’occulte en rien le pilonnage par le régime de l’ex président Ben Ali des valeurs fondamentales sur lesquelles s’édifie toute nation qui se respecte. Mais ça, c’est un autre sujet). Puis l’amateurisme, les calculs partisans et les errements des gouvernements qui se sont succédé depuis 2011, ont détruit l'Etat et fait exploser la dette extérieure.
La dégradation de l'économie se poursuit sous la « démocratie », avec l'apparition d'une pauvreté croissante. L’instabilité et l’inconstance du pouvoir, conjuguées à l’absence d’un projet de société mobilisateur, ont provoqué un affaissement de l'Etat. Un énorme gâchis. La faiblesse de l'Etat a de lourdes conséquences: des secteurs productifs et générateurs de devises à l’arrêt (pétrole et phosphate notamment) et un secteur informel qui dépasse en volume et en chiffres l’économie organisée, privant l’Etat de ressources douanières et fiscales précieuses. Pour les acteurs de l’économie souterraine, ne pas payer ses impôts reste un sport. La corruption et un goût pour l'argent facile y sont érigés en règle depuis des lustres. Et il semble que l'Etat n'a pas trouvé les moyens de changer la donne, à brève échéance.
Sur un autre plan, depuis dix ans, le pays vit au-dessus de ses moyens. Les déficits –budgétaire, de la balance courante, de celle des paiements…, s’enchaînent sans que cela semble émouvoir grand monde.
Aujourd’hui, l’économie tunisienne, paie le prix d'une politique populiste fondée sur la priorité absolue donnée à la consommation au détriment de l'investissement, la priorité donnée au jour le jour au détriment du long terme. L’Etat avec son armada de fonctionnaires et d’agents publics, est obligé de servir une masse salariale de 20 milliards de dinars, pas loin du cinquième de la richesse produite. Qui ose imaginer que, dans une entreprise industrielle ou même commerciale, les salaires puissent atteindre une telle proportion ? Ce serait la faillite assurée. Dans les activités relevant du service public, les autorités, en empêchant les hausses de tarifs (il est vrai que ces hausses doivent être accompagnées par des mesures de soutien qui ciblent les couches sociales qui en ont besoin), ont asphyxié les entreprises. Ceci sans parler de la gestion chaotique de la quasi-totalité de ces entreprises (ni objectifs clairs et daté ni contrats-programmes). Résultat des courses, des déficits chroniques qui enflent d’année en année, creusant davantage le déficit budgétaire de l’Etat.
Le pays semble ne rien apprendre de ses erreurs passées. Des solutions de facilité sont envisagées. Pourquoi ne pas monétiser la dette de l’Etat ? Ou bien augmenter les impôts et les taxes?
Si la pression fiscale continue d’augmenter (avec une infrastructure et des services publics qui ne cessent de se détériorer) et que le gouvernement change les règles fiscales en permanence, qui oserait investir un dinar? Et comment ferait-on pour drainer les capitaux étrangers dont nous avons grandement besoin pour faire tomber la pression sur le dinar ?
La monétisation de la dette est l'opération par laquelle une banque centrale achète directement ou indirectement (sur les marchés primaire et/ou secondaire) les emprunts émis par l'Etat. Ce qui est, en théorie, bien pratique lorsqu'un pays ne parvient plus à se financer sur les marchés parce que les investisseurs traditionnels doutent de sa solvabilité. La banque centrale se substitue à eux. Il suffit juste pour acheter les dettes et créer de la monnaie, de fabriquer des billets autant qu'elle le désire, puisque c'est elle qui détient la planche à imprimer. Problème, la monnaie créée en grande quantité, bien au-delà de l'augmentation de la richesse du pays fabrique de l'inflation. L’exemple de la Turquie, qui a subi un taux d’inflation de 11,8% en septembre 2020, nous paraît édifiant pour illustrer nos propos. Selon une étude Euler Hermes parue le 10 septembre 2020, la Turquie est en tête des pays à marchés émergents qui ont creusé leurs scores de risque d'inflation suite à la mise en place par leurs banques centrales de politiques monétaires, dîtes non-conventionnelles sans précédent et pas toujours appropriées (politiques monétaires d'assouplissement quantitatif visant à générer de l'argent frais pour stimuler l'économie), afin de lutter contre la crise liée au Covid. L'enquête en question, pose la question de l'inflation et de la soutenabilité de la dette publique et conclut « sans un engagement budgétaire fort et sans cadre bien défini et de taille suffisante, les effets des politiques d’assouplissement monétaire seront contre-productifs et susceptibles d'augmenter le coût d'emprunt du gouvernement à moyen terme. En fait, dans un contexte de hausse de l'inflation et de préoccupations concernant la viabilité de la dette, les investisseurs peuvent demander des primes de risque plus élevées pour les nouvelles émissions de dette des pays émergents ».
Même si la réserve fédérale américaine et, depuis 2015, la banque centrale européenne (BCE), sous l’impulsion de Mario Draghi –et son fameux whatever it takes- ont largement usé de ce moyen, les banques centrales qui pensent que leurs politiques qui visent à inonder les marchés de liquidités pourraient régler les problèmes structurels commettent une funeste erreur. Qu'attendent les banques centrales de ces politiques monétaires incroyablement expansionnistes? Ces dernières, en achetant de grandes quantités de dettes publiques et en abaissant leurs taux directeurs, permettent de faciliter le financement budgétaire et espèrent relancer l’économie (La BCE, par exemple, essaie d'accroître les liquidités détenues par les banques jusqu'au point où celles-ci recommenceront à prêter à l'économie). Mais en aucun cas ces politiques ne peuvent résoudre les problèmes structurels de l’économie réelle d’un pays. Elles ne peuvent en aucun cas en corriger les anomalies structurelles. Quelles sont-elles en Tunisie? Il est vrai que la liste est longue. En premier lieu, le manque de compétitivité de l'industrie, causé par la faiblesse de la productivité du facteur travail et le manque d'innovation. Cette industrie est par ailleurs faiblement exportatrice, ou si on veut être plus précis, exportatrice de produits et de services à très faible valeur ajoutée. En deuxième, lieu le défaut de rigueur dans la gestion des finances publiques. En troisième lieu, le mauvais rendement du système fiscal. En quatrième lieu, un système éducatif obsolète est inadapté aux besoins du marché de l’emploi. En cinquième lieu, une lourdeur bureaucratique qui entrave la liberté d’entreprendre…
Pour résumer, disons qu’il y a trois facteurs de production en économie: le capital, le travail et la confiance. Force est de reconnaitre, qu’actuellement, en Tunisie, les trois font défaut. Plutôt que de monétiser la dette publique, ne convient-il pas mieux de s’attaquer aux racines du mal ? Ces racines nous renvoient au problème des déficits budgétaire et public, au poids de la dette (80% du PIB selon l’ITCEQ), au niveau des taux d'intérêt et, enfin, au niveau de l'inflation. Malheureusement, depuis dix ans, le pays n'a pas eu de grande vision politique (ni socio-économique). L'urgence électorale et les intérêts catégoriels font perdre de vue les objectifs à long terme. Tout au long de ces années, nos dirigeants n’ont pas cessé de mal lire les moments importants.
Je ne pourrais clôturer cet article sans faire remarquer à ceux qui disent que le scénario grec guette la Tunisie, que malgré beaucoup de similitudes inquiétantes entre la situation économique de la Tunisie et celle qu'a connue la Grèce en 2010- une dette publique colossale qui ne cesse de gonfler, année après année, une corruption et une évasion fiscale et, plus globalement, une économie souterraine très répandues, des salaires publics qui bouffent une grande partie des ressources budgétaires et qui sont un bon exemple de l’incohérence de l’État...-, deux éléments majeurs distinguent les deux situations.
D’abord la Grèce a été soutenue par l'Europe qui y a injecté près de 300 milliards d'euros (excusez du peu). Ensuite, le gouvernement grec a été contraint d’engager une foule de réformes structurelles dont les conséquences sociales ont été très douloureuses pour la population.
A notre sens, par delà la polémique qui fait rage autour du refus de la banque centrale de monétiser la dette de l’Etat (même si, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées au Covid, il acquis que la BCT va lâcher du lest, il n’en demeure pas moins légitime de s’interroger sur l’ampleur de son intervention et les conditions qu’elle va poser au gouvernement), les seules questions qui vaillent la peine d’être posées sont les suivantes : Quand est-ce que nos gouvernants comptent-ils engager les réformes structurelles-certes douloureuses- à même de sauver le pays de la faillite annoncée ? Et les Tunisiens sont-ils prêts à en endurer le corollaire ?
Le débat de ces derniers jours, en marge de la loi de finances complémentaire de 2020 et celle de 2021, témoigne d’un début de prise de conscience. Pourvu qu’elle ne soit pas parasitée par les calculs politiciens partisans.
Mohamed Fessi
Expert comptable et consultant d’entreprises
- Ecrire un commentaire
- Commenter