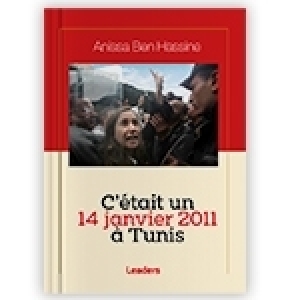Hélé Béji - Tunisie : la dictature démocratique

« Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable ». L’art politique tunisien ressemble à l’art poétique de Boileau. Le résultat du premier tour des élections tunisiennes, si invraisemblable qu’il paraisse, a fait ressortir le vrai de la volonté populaire par des chemins mystérieux dont le tracé nous reste flou. Nous avons beau observer de près la course échevelée des élections, le tracé intérieur du vœu final de chacun nous échappe.
Deux candidats parfaitement opposés par leur personnalité atypique, qu’une grande partie de la classe intellectuelle et politique a ignorés ou « méprisés », avec une pointe d’outrecuidance aveugle, sont pourtant les finalistes du premier tour présidentiel où vingt-six candidats se sont disputés la fonction suprême. Les étiquettes de « salafiste » collées à l’un, M. Kaïs Said, de « populiste » à l’autre, M. Nabil Karoui, sont la preuve de ce déni de reconnaissance par la classe intellectuelle et politique. Nos préjugés brouillent notre intelligence et nous tirent du côté de notre a priori, plutôt que des signaux d’alerte qui les contrarient.
Pourtant, cette révolution électorale avait été annoncée avec une précision mathématique par les instituts de sondage, que la quasi-majorité des postulants professionnels à l’élection ont écartée d’un dédain sceptique, entretenus dans leur illusion par une valetaille si bruyante de soutiens, de conseillers, de flatteurs, de subalternes, de faux amis et de courtisans, qu’ils n’ont pas vu venir la vague anonyme qui les submerge aujourd’hui. Mais le feu qui couvait sous l’écran de fumée où ils croyaient discerner leur victoire, était celui de leur défaite.
La force du vote démocratique est précisément cette flamme invisible, discrète qui brûle modestement dans l’anonymat. Elle est nourrie du jugement incertain mais sincère de chacun, celui de la masse silencieuse des sans-pouvoirs qui renverse les prétentions exorbitantes d’une classe abusive, soudain rejetée par une volonté populaire dont elle avait sous-estimé la puissance d’être. La vanité d’ambitions démesurées a été réduite à l’humble mesure du blâme des citoyens. La démocratie est ce moment où la liberté du vote rejoint l’arrêt invisible de la sentence des hommes.
Les deux finalistes sont très différents, pour ne pas dire opposés. L’un s’exprime avec une rectitude doctrinale où l’autorité savante du professeur en impose même si on ne comprend pas son langage châtié ; l’autre a mis l’affect du prochain au centre d’une campagne sentimentale et fusionnelle, en usant aux yeux d’une partie de l’opinion de procédés irréguliers. L’un est un docte pédagogue du savoir. L’autre un protagoniste empathique de la charité. L’un n’a aucun parti, hormis ses fidèles étudiants ; l’autre a créé une sorte d’épopée humanitaire, une république caritative en marche qui a grandi au fur et à mesure que la vie quotidienne des gens se dégradait. Mais tous deux ont comme point commun d’avoir transgressé les mécanismes habituels de la démocratie, où la forfanterie des partis a fini par détruire chez les Tunisiens le goût de la politique.
Malgré leur personnalité si contraire, ils ont dévoilé l’existence d’un no-man ’s land électoral, resté jusque-là en dehors du réservoir démocratique, territoire fantôme de la démocratie. Kais Said, omniprésent dans le paysage des campus universitaires, prêchant avec une constance imperturbable une jeunesse instruite et désargentée, sensible à la pédagogie des cours magistraux sur l’État de droit, que le candidat veut transformer en une « société de droit », en remettant à l’honneur le slogan révolutionnaire de 2011: « Le peuple veut !... » ; et Nabil Karoui, naissant aux peines populaires dans le trauma d’une perte personnelle muée en grâce compassionnelle, sa tragédie familiale le poussant vers tous les infirmes, les malheureux, les blessés, les crucifiés de la vie dans une résilience où s’est mise à vibrer « l’insigne dignité des pauvres » sous le slogan « Le peuple a besoin !... ». Privé de parole par une arrestation violente, arraché à ses électeurs qui ne peuvent plus ni l’entendre ni le voir, il a quand même gagné la deuxième place dans la résonance de son silence et de son absence forcés. Kaïs Said, lui, sur son quant-à-soi impavide, refusant le débat médiatique à l’occidentale pour mieux illustrer son bréviaire de « démocratie directe », a su battre, au pas lent d’une carapace de tortue, tous les lièvres de la galopade électoraliste bruyante et trébuchante.
L’un et l’autre ont recueilli le suffrage massif de tous ceux pour qui le terme « peuple » s’était tari en un discours politicien abstrait, distant et désincarné. L’espoir s’est traduit dans leur personne par la proximité des petites gens, l’image grandeur nature de l’injustice, de l’exclusion, de l’arbitraire, de l’inégalité qui ont rempli les urnes de bulletins pacifiques, et ont vidé celles du pouvoir où modernistes et islamistes, par leurs dérives flagrantes, ont été emportés ex æquo dans le naufrage. Ils avaient confisqué trop longtemps l’avantage d’une révolution qu’ils n’avaient pourtant pas faite, mais dont le pouvoir les avait gâté de prébendes, de sièges au parlement, de postes prestigieux dans le monde international, de rentes bureaucratiques, de directions ministérielles, d’instances où ils se sont rengorgés avec des airs de marquis qui croyaient que la plèbe leur faisait révérence, alors qu’elle était entrée depuis longtemps en résistance, loin des officines connues des partis en compétition.
C’est ici qu’on découvre que la démocratie peut devenir un ersatz de dictature, un outil de déshumanisation collective au service d’une nomenklatura de petits seigneurs parjures, congédiés par une majorité d’électeurs floués par un jeu d’intrigues, d’appétits, de manipulation, de pratiques attentatoires à la vie ou à la liberté, de promesses de prospérité qui ne se sont jamais réalisées, tandis que les conditions de vie des gens n’ont cessé de se délabrer. Les stéréotypes romantiques de la révolution, qui avaient scellé les bases d’une vie politique libre et réconciliée, ont vu poindre non pas un État consensuel ou équitable, mais le danger d’un appareil de domination, d’intimidation et d’arbitraire.
Ici, deux suspenses tiennent en haleine le thriller invraisemblable de nos élections. L’économie de la révolution, au lieu de la prospérité annoncée, a produit une régression socio-économique où les ressources de l’Etat se sont affaissées. Liberté, dignité nationale, justice sociale sont redevenues les ressorts d’un soulèvement moral, cette fois non pas contre un « ancien régime » comme en 2011, mais contre une « jeune démocratie » où la représentation populaire s’est sentie trahie par des politiciens désormais perçus comme des usurpateurs sans foi ni loi.
Cette question met en doute l’efficacité progressiste des démocrates eux-mêmes. Le slogan révolutionnaire « le peuple veut ! », suffit-il à créer le bien-être vainement attendu depuis presque dix ans ? La prospérité découle-t-elle automatiquement de la fin de la tyrannie ? Au contraire, la liberté de la jouissance semble s’être changée en fatalité de la privation. La désillusion est si dure aujourd’hui que je n’ose imaginer quel sera le malheur du pays dans cinq ans, si les futurs élus voient leur vanité chuter encore dans l’impuissance, face à une pauvreté incurable, séditieuse, rétive aux théories sommaires de ce que Roger Scruton, le philosophe anglais, appelle en parlant des idéologues, « les machines à non-sens » .
La deuxième question grave que posent ces élections est celle de l’application du droit. Le fait que le favori actuel soit un juriste qui se réclame de la rigueur et de l’intransigeance de sa discipline, alors que son concurrent détenu est spolié de ses droits d’expression, n’est-il pas déjà un déni de la « société de droit » qu’il annonce à une jeunesse conquise ? Comment augurer de la vertu incorruptible de la république, si la victoire des urnes au bénéfice de l’un aura tordu le cou à l’autre en lui interdisant la tribune ? Comment l’accuser de corruption si les règles de l’élection elle-même sont perverties ? Le monologue est-il la nouvelle morale de cet absolutisme électoral, où la compétition condamne le candidat bâillonné d’avance, si un appel à sa libération n’est pas lancé de la part d’un challenger célébré pour son honnêteté et sa droiture ? « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Accuser un présumé coupable sans preuves équivaut à l’innocenter. L’éliminer par des procédés dépravés entraîne sa rédemption. C’est un cas extravagant d’anti-démocratie qu’un duel électoral se réduise à un soliloque d’où la liberté de débattre, d’offrir au citoyen les moyens de choisir, c’est-à-dire d’élire en connaissance de cause, est annulée. N’est-ce pas là une prise de pouvoir sans discussion, où la victoire d’un seul sur personne peut sonner le prélude d’un pouvoir absolu, ou de l’invention inquiétante d’une « dictature démocratique » ?
Hélé Béji
- Ecrire un commentaire
- Commenter