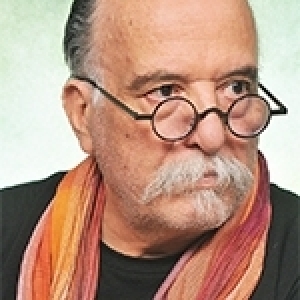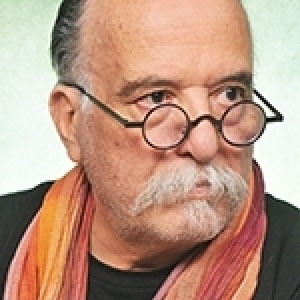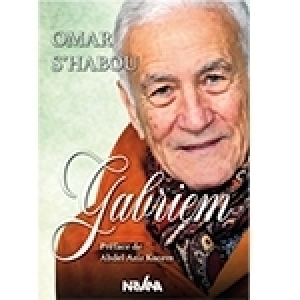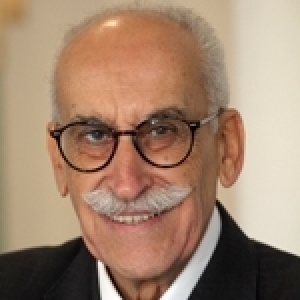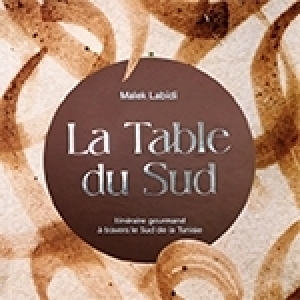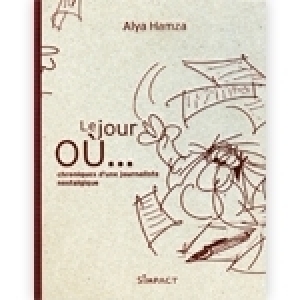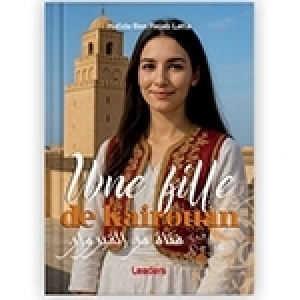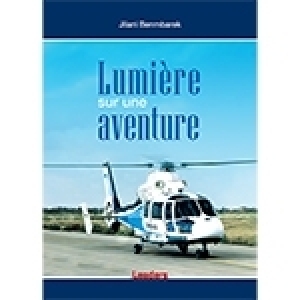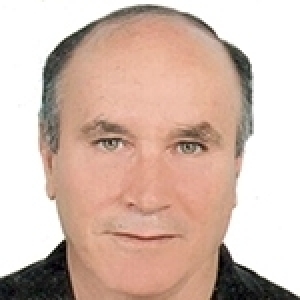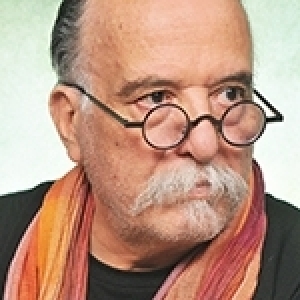Mondher Khaled: Le paradigme de la post-vérité sous la présidence de Donald Trump
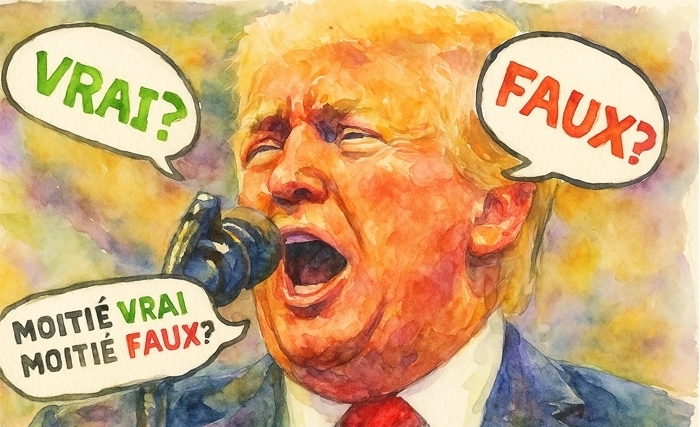
Introduction: L'avènement de la "post-vérité" et la naissance des "faits alternatifs"
.jpg) Au lendemain de l’investiture présidentielle de Donald Trump, son attaché de presse déclara que l’évènement avait rassemblé le plus grand nombre de spectateurs de l’Histoire. Pour défendre ce qui a été manifestement un gros mensonge, une des conseillères de la Maison Blanche(1) affirma qu’il s’agissait de «faits alternatifs».
Au lendemain de l’investiture présidentielle de Donald Trump, son attaché de presse déclara que l’évènement avait rassemblé le plus grand nombre de spectateurs de l’Histoire. Pour défendre ce qui a été manifestement un gros mensonge, une des conseillères de la Maison Blanche(1) affirma qu’il s’agissait de «faits alternatifs».
Cet épisode, loin d'être anecdotique, fut le point de départ emblématique d'une nouvelle ère fondée sur un nouveau paradigme qualifié par le dictionnaire Oxford de la «Post-vérité», où la réalité objective devenait malléable, et où l’émotion et les croyances vampirisent le débat public, éclipsant toute objectivité.
Ce terme a vu sa popularité exploser lors du référendum sur le Brexit et l'élection de Donald Trump. Les deux événements ont révélé une dynamique où des affirmations manifestement fausses, mais émotionnellement puissantes, pouvaient s'avérer électoralement efficaces.
Cet article se propose d'analyser comment la présidence Trump a non seulement incarné, mais aussi systématisé et amplifié le paradigme de la post-vérité. Nous examinerons les stratégies et les outils déployés, les domaines d'application concrets de cette méthode, et enfin, les conséquences profondes et durables de cette rupture avec le factuel sur le fonctionnement de la démocratie contemporaine.
La Mécanique Trumpienne de la Post-Vérité: Stratégies et Outils
La relation de Donald Trump avec la vérité ne se résume pas à une simple série de mensonges. Il s'agit d'un système complexe et délibéré, une véritable mécanique conçue pour remodeler la perception de la réalité. Pour comprendre ce phénomène, il faut analyser non seulement le contenu des fausses déclarations, mais surtout les stratégies qui les sous-tendent.
Le Déluge de Fausses Déclarations: La Stratégie du "Firehose of Falsehood"
La première arme de l'arsenal de la post-vérité est le volume. Selon un décompte méticuleux du Washington Post, Donald Trump a formulé 30 573 affirmations fausses ou trompeuses au cours de ses quatre années de mandat. Plus révélateur encore est le rythme de ces déclarations: d'une moyenne de 6 par jour la première année, il est passé à 16 la deuxième, 22 la troisième, pour atteindre un pic de 39 par jour durant sa dernière année. Cette accélération n'est pas le fruit du hasard, mais d'une stratégie consciente.
Cette tactique a été théorisée comme étant une technique de propagande qui consiste à submerger le public et les médias sous un flot continu et rapide de messages, diffusés sur de multiples canaux, sans se soucier de leur véracité ou de leur cohérence. L'objectif n'est pas tant de convaincre que de semer la confusion, de saturer les capacités cognitives et de rendre le fact-checking quasi impossible.
L'efficacité psychologique de cette méthode repose sur un biais cognitif bien connu: l'«effet de vérité illusoire». Des études en psychologie ont démontré que la simple répétition d'une affirmation, même fausse, augmente la probabilité qu'elle soit perçue comme vraie. Une étude universitaire(2) a spécifiquement montré que la répétition des fausses déclarations de Trump augmentait la croyance en celles-ci, particulièrement chez les individus consommant principalement des médias conservateurs qui les amplifiaient sans les contredire.
La Construction de Récits Puissants: Du "Fait Alternatif" au "Grand Mensonge"
Au-delà du volume, la stratégie de Trump repose sur la construction de récits alternatifs puissants. Le plus emblématique est sans doute celui du «Grand Mensonge»(3) , une technique de propagande qui consiste à affirmer une contre-vérité si colossale que le public peine à imaginer qu'on puisse mentir avec une telle audace. Cette stratégie a été appliquée avec une efficacité redoutable pour contester le résultat de l'élection présidentielle de 2020.
Pendant des mois, Trump et ses alliés ont martelé l'idée d'une fraude électorale massive, sans jamais fournir de preuves crédibles. Ce récit a été maintenu malgré le rejet de plus de 60 recours en justice par des tribunaux, y compris par des juges nommés par Trump lui-même. L'insistance sur ce «Grand Mensonge» a culminé avec l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 et a conduit à des inculpations pénales, notamment en Géorgie, où les fausses déclarations sur la fraude électorale constituent des éléments centraux de l'accusation.
Cette approche soulève une question philosophique: s'agit-il de mensonges classiques ou d'autre chose ? Le philosophe Harry Frankfurt, dans son essai «On Bullshit», distingue le menteur du «baratineur» . Le menteur connaît la vérité et cherche à la dissimuler. Le baratineur, lui, est indifférent à la vérité; ce qui compte pour lui n'est pas la véracité de ses propos, mais l'effet qu'ils produisent. De nombreux analystes estiment que cette définition s'applique parfaitement à Donald Trump, pour qui l'exactitude factuelle semble souvent secondaire par rapport à la capacité de ses affirmations à mobiliser sa base, à attaquer ses adversaires et à construire un récit qui le place au centre d'une lutte héroïque.
La Délégitimation de la Vérité: La Guerre contre les Médias et les Experts
La troisième composante de cette mécanique est la destruction des arbitres traditionnels du fait. Pour qu'une réalité alternative puisse s'imposer, il est nécessaire de discréditer les sources qui pourraient la contredire. Trump a mené une guerre systématique contre les médias d'information, qualifiant de manière répétée toute couverture critique de « Fake News » et désignant les journalistes comme des «ennemis du peuple».
Cette stratégie vise un double objectif. D'une part, elle sape la confiance du public dans le quatrième pouvoir, une institution essentielle au contrôle démocratique. D'autre part, elle permet de créer et de maintenir une «bulle de filtres» pour ses partisans. Dans cet écosystème informationnel fermé, seules les sources validées par le leader (comme Fox News à certaines périodes, ou des médias plus marginaux) sont considérées comme légitimes, tandis que les informations provenant de l'extérieur sont rejetées a priori comme étant partiales et malveillantes.
Ce rejet de l'expertise s'est étendu bien au-delà des médias. Les institutions scientifiques et gouvernementales, dont le rôle est de produire des données objectives, ont également été la cible d'attaques. Que ce soit en contestant les statistiques de l'emploi, en qualifiant le changement climatique de «canular», ou en contredisant les recommandations des agences de santé publique durant la pandémie, l'administration Trump a systématiquement cherché à substituer son propre narratif aux conclusions fondées sur des données probantes.
La Post-Vérité en Action: Études de Cas Concrètes
Les stratégies de la post-vérité ne sont pas restées théoriques ; elles ont été appliquées à des enjeux politiques majeurs, avec des conséquences tangibles ;
L'analyse de cas spécifiques permet d'illustrer concrètement leur fonctionnement.
• Cas 1: La Pandémie de Covid-19
La crise sanitaire mondiale a été un terrain d'expérimentation majeur pour la post-vérité. Dès le début de la pandémie, Donald Trump a systématiquement minimisé la gravité du virus, le comparant à une simple grippe.
Une étude de l'Université Cornell a analysé des millions d'articles de presse et a conclu que Donald Trump était « le plus grand moteur de la désinformation sur le COVID-19 » dans les médias anglophones. En attaquant des figures comme le Dr Anthony Fauci et en remettant en cause les mesures de santé publique comme le port du masque, il a transformé la gestion de la pandémie en un enjeu de loyauté politique, où croire le leader devenait plus important que de suivre les recommandations scientifiques.
• Cas 2: L'Économie et l'Emploi
L'économie a été un autre domaine où les récits ont primé sur les faits. Trump a constamment affirmé avoir créé «la meilleure économie de l'histoire», une affirmation largement exagérée et contredite par de nombreux indicateurs historiques. Lorsque les données économiques étaient favorables, elles étaient brandies et amplifiées. Mais lorsque les chiffres étaient décevants, l'administration n'hésitait pas à attaquer la source.
Cette attitude illustre une volonté de ne reconnaître comme valides que les données qui confirment son propre narratif, rejetant toute autre information comme étant une manipulation politique.
• Cas 3: L'Immigration
L'immigration est peut-être le domaine où la stratégie de répétition et d'appel à l'émotion a été la plus visible. Le discours de Trump sur ce sujet a été marqué par l'utilisation d'un vocabulaire chargé, qualifiant l'arrivée de migrants d'« invasion » et associant systématiquement les immigrés à la criminalité et au danger.
Une analyse approfondie(4) a quantifié cette rhétorique. Elle a révélé que Trump a répété certaines fausses affirmations des centaines de fois : plus de 675 fois pour la nécessité de construire un mur, plus de 575 fois pour l'idée que les Démocrates veulent des «frontières ouvertes», et plus de 560 fois pour l'allégation selon laquelle les immigrés proviennent de « prisons et d'asiles psychiatriques ». Cette répétition acharnée, en dépit des données factuelles montrant que les immigrés ont un taux de criminalité inférieur à celui des natifs, vise à ancrer une perception négative dans l'opinion publique par la simple force de l'habitude, exploitant pleinement l'effet de vérité illusoire.
Conséquences et Défis pour la Démocratie
L'instauration d'un paradigme de post-vérité au sommet d’un État n'est pas sans conséquences. Elle ébranle les fondements mêmes du contrat social et du débat démocratique, laissant derrière elle un paysage politique fracturé et une méfiance généralisée.
Dans son ouvrage «la Faiblesse du Vrai», la philosophe Myriam Revault d’Allonnes, soutient que la post-vérité ne menace pas seulement la vérité factuelle, mais surtout notre capacité à vivre dans un «monde commun». Lorsque les faits eux-mêmes deviennent un sujet de discorde partisane, le dialogue devient impossible. Sans une base de réalité partagée, le débat public ne porte plus sur l'interprétation des faits ou les solutions à apporter, mais sur la question de savoir ce qui est réel. La démocratie, qui repose sur la délibération rationnelle, se trouve ainsi paralysée.
Dans une analyse pour le New York Times, l'historien Timothy Snyder va plus loin en établissant un lien direct entre ce phénomène et une menace autoritaire. Il écrit: «La post-vérité est le pré-fascisme». Selon lui, l'abandon des faits objectifs cède le pouvoir à ceux qui maîtrisent le spectacle et l'appel à l'émotion. Quand la vérité n'est plus un repère, la société civile perd sa capacité à s'organiser et à se défendre contre les dérives du pouvoir, laissant le champ libre à la force brute et au charisme du leader.
Face à ce déluge, les outils traditionnels de défense de la vérité se sont révélés insuffisants. Le fact-checking, bien que nécessaire, atteint ses limites. Le volume et la vitesse de la désinformation rendent la réfutation systématique quasi impossible. Pire, certaines études suggèrent que réfuter une fausse nouvelle peut parfois la renforcer en lui donnant une visibilité accrue, un phénomène connu sous le nom d'effet de retour de flamme(5).
Enfin, il est impossible d'ignorer le rôle catalyseur des nouvelles technologies. Les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes conçus pour maximiser l'engagement, favorisent la propagation rapide de contenus émotionnels et polarisants, qu'ils soient vrais ou faux. L'émergence récente d'intelligences artificielles conversationnelles, ajoute une nouvelle couche de complexité, offrant la possibilité de générer des «vérités» à la demande, personnalisées pour appuyer n'importe quel argument, brouillant encore davantage les lignes entre fait et fiction.
Conclusion: Vivre et Résister à l'Ère de la Post-Vérité
La présidence de Donald Trump n'a pas simplement été marquée par des mensonges ; elle a représenté la mise en œuvre à grande échelle d'un système de gouvernance par la post-vérité. Trump n'a pas inventé la post-vérité, mais il en a été le praticien le plus accompli et le plus influent de notre époque.
Face à ce défi fondamental, la simple réfutation factuelle ne suffit plus. La résistance à la post-vérité doit s'opérer sur un plan plus profond. La première piste est celle de l'éducation à l'esprit critique. Il est devenu crucial d'apprendre aux citoyens, dès le plus jeune âge, non pas quoi penser, mais comment penser : comment évaluer la fiabilité d'une source, reconnaître les techniques de manipulation rhétorique et comprendre le fonctionnement des algorithmes qui façonnent leur perception du monde.
La seconde piste concerne la responsabilité des acteurs de l'écosystème numérique. Les plateformes de réseaux sociaux, dont le modèle économique a prospéré sur la polarisation, doivent être tenues de faire preuve de plus de transparence et de modérer plus efficacement la désinformation virale. Parallèlement, les médias traditionnels doivent réinventer leurs méthodes pour regagner la confiance perdue, par exemple en rendant leur processus de vérification plus transparent et en expliquant non seulement les faits, mais aussi comment ils les ont établis.
La question finale reste ouverte: la post-vérité est-elle une parenthèse politique liée à une figure charismatique, ou une caractéristique structurelle et durable de nos démocraties à l'ère numérique ? La facilité avec laquelle ces stratégies se sont propagées et ont été adoptées par d'autres acteurs politiques à travers le monde suggère que le défi est profond. Résister à l'attraction des récits simplistes et émotionnels au profit de la complexité du réel est sans doute l'un des combats civiques les plus importants du XXIe siècle.
Mondher Khaled
Ancien fonctionnaire international
1) Sean Spicer
2) Université Vanderbilt
3) “Big lie »
4) The Marshall Project
5) Back fire effect
- Ecrire un commentaire
- Commenter