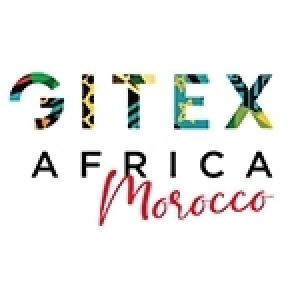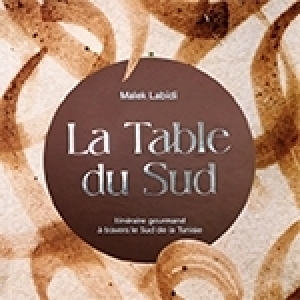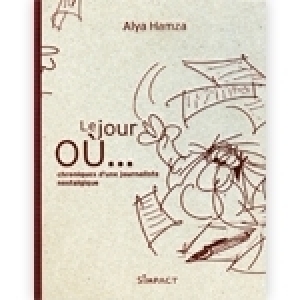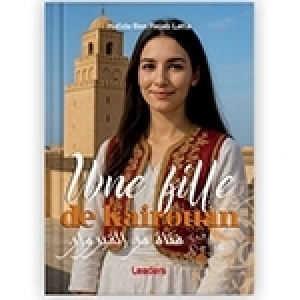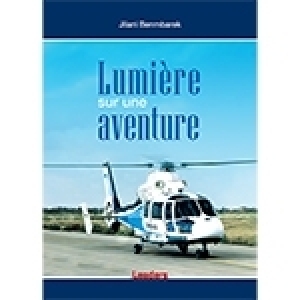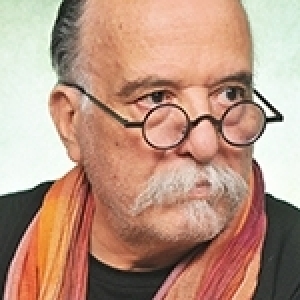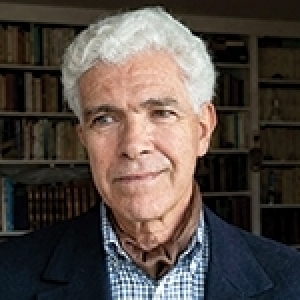L’aide internationale: levier du développement économique, social et culturel ou instrument de domination sans fin?

Par Riadh Zghal - La politique de suppression de l’aide internationale et d’expulsion des immigrés vers leurs pays d’origine décidée par Trump dès son arrivée au pouvoir a suscité un débat sur ce que les pays sous ou mal développés peuvent attendre de l’aide internationale et de son efficacité en matière de développement effectif, de réduction de la pauvreté et autres objectifs annoncés.
Lorsque les pays anciennement colonisés se sont libérés de la colonisation, leurs élites ayant pris en main la gouvernance du pays, ils avaient fortement cru en leur capacité de libérer les populations de la pauvreté, de la maladie, de l’analphabétisme et de tout ce qui fait leur vulnérabilité. Une fois le pouvoir en main, les nouveaux gouvernants ont entretenu des liens forts avec l’ancien colonisateur, comptant sur son aide pour réaliser les projets de développement.
L’espoir était là et l’on croyait à un décollage économique possible qui allait entraîner dans son sillage un développement social et culturel. Certes des progrès ont été réalisés avec les indépendances plus ou moins formelles mais, en dépit des aides bilatérales et internationales, la plupart des anciennes colonies n’ont pas réussi à réaliser le développement espéré malgré quelques progrès variables d’un pays à l’autre et d’un domaine à l’autre. En revanche, la plupart de ces pays se sont retrouvés lourdement endettés. La question qui se pose alors avec insistance est quelle a été l’utilité de l'aide au développement? Faut-il regretter les décisions de Trump ou y voir une opportunité pour changer de politique?
Si l’on en croit Dambisa Moyo(1), l’aide internationale a fait plus de mal que de bien. Cependant, il faudra reconnaître que de nombreux projets à but économique, éducatif ou social ont été réalisés grâce à l’aide internationale ou bilatérale, c’est selon. Reste à savoir pourquoi cela n’a pas réussi à sortir des masses de la pauvreté et assurer le développement inclusif et durable tant attendu des indépendances ? Pourquoi cet échec cuisant qui fait que plus de 700 millions de personnes dans le monde, selon les estimations de la Banque mondiale, vivent encore dans une extrême pauvreté? Alvar Jones Sanchez, anthropologue social de la Fondation Croix-Rouge française, écrivait en 2019(2): «Le paysage rural africain regorge de pancartes bancales rouillées à la gloire des bailleurs. Il est semé d’édifices abandonnés, d’infrastructures agricoles en rade, d’équipements défectueux avant même d’avoir été utilisés, de périmètres maraîchers délaissés… Ces «résidus» sont les traces d’interventions de développement menées par des ONG et des agences internationales. Ils font partie de l’environnement quotidien des populations. Ces vestiges questionnent l’efficacité de beaucoup d’actions menées sur le continent sous la bannière du développement.»
Cet expert fait plusieurs reproches en rapport avec les méthodes et les concepts des projets d’aide financés et diligentés par les agences internationales: il n’est pas exigé de l’expert chargé du projet de veiller à l’amélioration de la qualité de vie des populations sur le long terme d’autant que le suivi des projets achevés bénéficie rarement d’un financement, l’aide nuit à l’engagement des citoyens à réaliser des projets répondant aux besoins collectifs et encourage plutôt à la passivité, il n’y a pas de processus d’évaluation fiables, si l’Etat dépend financièrement de l’aide des organisations internationales, il s’expose à l’intervention de celles-ci dans la définition des politiques publiques(3), l’aide revêt un caractère idéologique dans la mesure où le concept de développement qui la sous-tend reflète une vision politique et un projet de société.
Mais peut-on se passer de l'aide internationale? Et que faut-il en espérer vraiment lorsqu’on est un pays dit sous-développé ou, pour faire politiquement correct, un pays émergent ? Un pays où le taux de pauvreté, les inégalités sociales et régionales, le déficit des infrastructures diverses, l’index de développement humain stagnent à des niveaux critiques peut-il assurer le comblement de toutes ces insuffisances en comptant seulement sur ses ressources endogènes?
Répondre à ces questions ne peut faire l’impasse sur les conséquences durables de la colonisation sur les esprits affectant les choix politiques des pays supposés libérés du joug colonial. D’abord, la domination des empires coloniaux a donné un coup d'arrêt à la dynamique évolutive des sociétés assujetties à l'impérialisme durant des siècles. La dynamique évolutive historique aurait permis à ces sociétés de franchir à leur rythme des étapes de découverte scientifique et technique, de réaliser des changements sociaux et culturels. Elles auraient puisé dans leur héritage et leur culture des leviers de changement sociaux, de même que dans leur ouverture aux autres cultures par le biais des relations commerciales et des proximités géographiques. De plus, le passage par la colonisation a laissé une profonde empreinte cognitive poussant à entretenir les relations économiques et culturelles avec l’ancien colonisateur prolongeant sa présence dans certains pays et son statut de référence quant aux questions de développement. Cette empreinte, c’est celle de la sous-estimation, voire de la dévalorisation, du soi collectif qui détourne les regards des capacités endogènes de développement et de changement social.
Aujourd’hui, les aides internationales viennent des pays dominants qui, souvent, convoitent les ressources des pays dominés et entretiennent la colonialité, c'est-à-dire la dépendance assortie de la sous-estimation des potentiels endogènes, ceux du capital immatériel humain et ceux des ressources matérielles. Pourtant, suite à l’annonce de la suppression de l'aide américaine, une militante de la lutte contre la pauvreté habituée à cette aide constate que l'attention est désormais tournée vers la recherche d'aides locales qui doivent sans doute exister. Peut-être que l’absence d’aide internationale stimulera la conception de projets de développement davantage orientés par les besoins locaux, l'exploitation des ressources et des savoirs locaux, en plus de l'engagement des bénéficiaires, désormais valorisés individuellement et collectivement en tant qu'acteurs à part entière des projets sélectionnés et mis en œuvre selon une approche participative.
Il ne s'agit pas de rejeter en bloc l'aide internationale, surtout si elle est bien intentionnée, mobilise les savoirs locaux, ceux des populations visées et ceux des experts nationaux. Il est temps, au vu des échecs de tant de projets financés par cette aide, de revisiter les paradigmes qui la fondent dont la conception du développement durable, l’approche de l’évaluation des projets et le financement du suivi après achèvement des projets dans un souci de développement durable. Il y a besoin de nouveaux principes débarrassés d’un regard hautain de l’expertise qui sous-estime les savoirs des populations au point de négliger la nécessité de les associer à la conception et à la conduite des projets, se privant ainsi de l’énergie favorisée par l’engagement collectif en faveur de la réussite du projet et de l’entretien de son apport sur le long terme.
Riadh Zghal
1) Dambisa Moyo, (2009), L’Aide fatale : les ravages d’une aide inutile et de nouvelles solutions pour l’Afrique, Paris, Lattès.
3) L’exemple courant est celui des plans dits d’ajustement structurel imposés par les bailleurs de fonds internationaux.
- Ecrire un commentaire
- Commenter