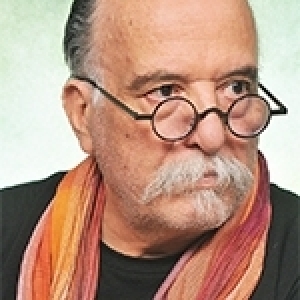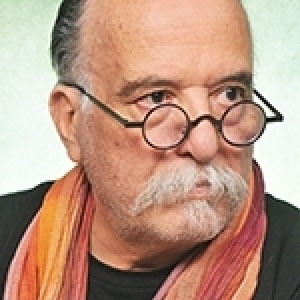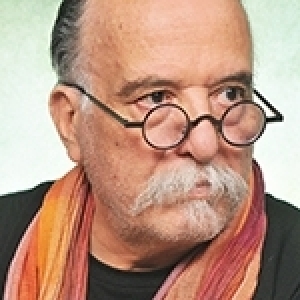Hedi Zaiem - Dix ans, pour rien ?

Que l’on se réfère à la situation économique ou sécuritaire par exemple, dix ans après la « Révolution » de Janvier 2011, tout le monde s’accorde à dire que la situation de la majorité du peuple tunisien est moins bien que ce qu’elle ne l'était auparavant. La crise sanitaire globale n’a fait qu’aggraver dramatiquement une situation, qui était déjà catastrophique.
A part ceux qui ont tiré profit, et de multiples manières, de la révolution, je fais sans doute partie d’une minorité qui ne regrette pas « l’ère défunte », et qui n’ont aucun désir d’y retourner, malgré la décrépitude totale du pays ; et de la décennie « révolutionnaire » je ferais un bilan tout à fait particulier.
Je soutiendrai d’abord, que la débâcle économique tout en étant inédite, représente un «coût» qui a été somme toute très supportable. D’autres pays frères ont payé mille fois plus cher et plus lourd –et souvent en sang et en larmes- la révolution qu’on leur a imposée, et sur ce plan on peut s’estimer heureux. Comparés à d’autres, nous faisons figure de miraculés. Une révolution ça coûte cher, et ça dure ; la Révolution Française de 1789 a mis près d’un siècle pour que la république s’installe durablement.
Devant cette débâcle économique beaucoup se sont égarés à chercher une solution « économique », mais tous les observateurs et les « experts » en tous domaines se sont accordés à dire que notre problème est avant tout « politique ». Derrière cette conviction, réside le constat d’une impuissance endémique de l’Etat. L’épisode du Kamour, où l’Etat s’est résigné à négocier avec des émeutiers enfreignant toute loi, et de céder, en est l’aspect le plus récent. Ceci indépendamment de tout jugement sur la légitimité des revendications.
Un débat monocorde
Cette quasi unanimité sur le caractère politique de la crise a fait le printemps d’une frange particulière de l’élite, à savoir les spécialistes de droit constitutionnel, en l'absence de politologues, c'est-à-dire les spécialistes de « l'étude des phénomènes qui renvoient aux différentes facettes de la gestion de la vie en collectivité ». Car il faut bien faire la différence entre les uns et les autres, même si l’on ne peut être un bon constitutionnaliste, si l’on ne s’adosse pas à une grande culture en science politique, ce qui est assez rare. Ainsi, ceux qui ont « fait le plus de bruit » pendant la décennie écoulée, furent sans doute les « constitutionnalistes ». C’est logique quand on observe que le premier souci de la classe politique a été, au lendemain de la révolution, de rédiger une nouvelle constitution, et le premier projet fut d’élire une « assemblée constituante » dédiée à cette tâche. Il en sortira après un séjour trop prolongé de cette assemblée, et une grave crise politique heureusement endiguée, une constitution considérée alors par ses rédacteurs comme « la meilleure du monde ».
La décennie, et plus particulièrement la période post-constituante, ont été caractérisées par une grande instabilité gouvernementale, puisque le pays connait actuellement son neuvième gouvernement. Cette grande instabilité est rapportée par les observateurs à la nature du système politique et au régime électoral mis en place. Concernant le système politique, il lui est reproché d’avoir adopté un pouvoir tricéphale (Présidence de l’Etat, Gouvernement et Assemblée des représentants du peuple) où aucun des trois pôles ne concentre suffisamment de pouvoirs pour trancher et pousser dans une seule direction. Concernant le mode de scrutin, en penchant vers la proportionnelle il aboutit à un émiettement de la représentation sur un grand nombre de partis et l’impossibilité de dégager une force politique stable capable de gouverner.
De nombreux professeurs de droit constitutionnel avancent ce diagnostic, et en font la principale –sinon l’unique- source du mal dont souffre le pays. Faute de substance, la plupart des partis politiques épousent également cette approche étroite jusqu’à en faire parfois la principale matière de leurs programmes et action. En reconnaissant à juste titre que le problème est aujourd’hui de nature politique, ils pèchent par une vision qui réduit « le politique » à l’institutionnel. Tous ne voient la solution que dans la nécessité de réformer le régime politique (la constitution) et la loi électorale dans deux directions: révision du système électoral pour permettre une majorité confortable et stable à l'Assemblée des représentants du peuple, et revoir les pouvoirs du Président de la République dans le sens de son renforcement, le but étant d'éviter la fragmentation du pouvoir entre les deux présidents de l’exécutif.
Une aspiration non avouée à l’autoritarisme
En somme, le système politique mis en place dans le cadre de la constitution de 2014, qui devait être une forme « progressiste » de gouvernance est perçu comme une source de régression. Dans son essence, il est progressiste puisqu’il permet d’éviter la mainmise d’une seule personne sur le système, et une représentation de tous les courants politiques à l’assemblée, les spécialistes reconnaissent que la meilleure constitution est celle qui assure l’équilibre entre les pouvoirs. Et j’ajouterai - au risque de choquer- que ce proposant, nos constitutionnalistes rêvent - consciemment ou inconsciemment - d'un retour à un «système politique de type autoritaire similaire à celui qui prévalait depuis l'indépendance. Certains l’appellent système « néo-patrimonial» pour désigner un système hybride qui fusionne l'héritage traditionnel avec des institutions empruntées à l'État moderne.
Cette aspiration, inavouée, à un régime autoritaire est étayée par la comparaison non pertinente entre la situation dans laquelle se trouvaient la majorité des citoyens sous le régime précédent, et celle qui a prévalu depuis la révolution. Elle recèle aussi une couche de populisme, la réaction épidermique des masses à la décomposition de l’Etat est de réclamer un homme (ou une femme, pour coller plus à ce qui se passe dans la réalité actuelle !) de poigne, pour « remettre les gens dans le droit chemin ».
Par ailleurs, s'il faut reconnaître que changer le régime politique et le code électoral est possiblement bénéfique, nous considérons que l'erreur consiste à croire que cela constituerait la solution du problème politique ; simplement parce qu’il peut s’avérer inefficace. L'urne octroie en la légitimité formelle au gagnant et lui donne le droit d'exercer le pouvoir, mais elle ne lui garantit pas la légitimité réelle garante de stabilité et de durabilité. La troïka qui dirigeait la Tunisie après les élections d'octobre 2011 avait la légitimité des urnes et disposait d'une majorité confortable au parlement, même si on peut la considérer comme ayant perdu cette légitimité, lorsqu'elle a dépassé les pouvoirs pour lesquels elle a été élue, à savoir préparer une nouvelle constitution pour le pays et organiser des élections générales. Cependant, cette légitimité ne l’a pas protégée - sous la pression de la rue - de la nécessité d’abandonner le gouvernement et de laisser la place à un gouvernement « indépendant » qui dirigea les affaires du pays en attendant les élections. Tous les gouvernements, y compris l’actuel, disposaient en principe d’une majorité suffisante pour gouverner, mais y parvenaient avec peine, la légitimité des urnes n’étant plus suffisante pour le faire. Et cela ne servirait pas de « bricoler » la constitution et la loi électorale pour dégager un groupe majoritaire. Cette majorité serait en fait le résultat d’une arithmétique fallacieuse, l’expérience du Nidaa créé par Beji Caïd Essebssi en 2014 est édifiante. Construit sur le rejet des islamistes, Nidaa a pu réussir sur le plan électoral, puisqu’il a été le parti majoritaire et qu’il pouvait former avec les composantes « modernistes » une confortable majorité pour gouverner. Mais, à la grande déception de ses électeurs, il s’est empressé de pactiser avec ceux qu’il a désignés comme adversaires, et de s’allier à eux. Beaucoup reprocheront à BCE son « pacte » avec Rached Ghannouchi qu’ils considèrent comme une trahison responsable du dépérissement de leur parti.
Dix années et zéro projet
Nous pensons que le dépérissement de Nidaa est dû moins à cette « alliance contre nature » avec les islamistes, qu’à l’absence de projet « positif » capable de fédérer ses différentes composantes; et nous entendons par « positif », un projet qui ne soit pas seulement la négation de l’autre, mais un ensemble cohérent de propositions capables de remporter l’adhésion des masses. Même si ce terme, désignant une vague catégorie sociale, toutefois majoritaire, a besoin d’être précisé. On l’emploie tantôt au singulier pour signifier simplement le plus grand nombre ; tantôt au pluriel, pour désigner des ensembles déterminés de personnes qui, au surplus, sont considérées par certains comme des formations sociales réelles et par d'autres comme de simples regroupements statistiques commodes, et très utiles quand on compte les voix. Il serait en effet coûteux à une des composantes d’un parti de le quitter quant ce dernier est bâti sur la base d’un projet et d’une idéologie. C’est cette double absence qui est derrière son dépérissement ; et derrière le pacte que BCE a choisi de faire avec les islamistes sans préjuger d’autres considérations, à savoir de probables interférences étrangères. En homme d’expérience, BCE était conscient de l’ampleur des attentes de la population, et savait qu’aucun pouvoir n’aura les moyens d’y faire face, encore moins quand il n’a pas de projet pour cela. Exclure les islamistes du pouvoir, aurait consisté à le leur offrir à terme, et pour longtemps. Si cette option est devenue aujourd’hui possible et souhaitable, c’est parce que le temps a fait maintenant son effet. Les islamistes qui se sont vu offrir le pays sur un plateau d’argent, n’ont pas pu asseoir durablement et solidement leur emprise. Si, dix ans après, ils sont de facto au pouvoir et s’ils réussissent encore à s’y maintenir, c’est grâce à l’excellence dans la manœuvre, les appuis extérieurs massifs, bien que non avoués -et pas seulement de certains alliés évidents-, et aussi la bienveillance d’un occident qui y voit une carte, à ne jamais jeter. Et force est de constater aujourd’hui que les différentes élections ont montré que leur audience est désormais fort restreinte, et pour longtemps. L’un des principaux acquis de la révolution restera sans doute le fait de leur avoir ôté l’aura d’intégrité et de probité dont ils se prévalaient. Vue sous cet angle, la « trahison » de BCE n’en est pas une, et c’était une nécessité historique.
Oui, la crise que connaît ce pays est politique. L’erreur est de réduire le politique à un mauvais fonctionnement des institutions. La Révolution n’a fait qu’exploser le mal endémique de ce pays, à savoir « la crise de l’Etat ».
Ceux qui essaient de faire un bilan de la Révolution, et encore plus ceux qui la regrettent, s’égarent et se situent en dehors de l’histoire. Dans la longue marche vers la modernité, il fallait sans doute passer par là. Ceux qui pensent qu’on a perdu dix ans, sont dans la fiction ; et ceux qui prônent le retour en arrière sont à comprendre. Ils ont rêvé d’« emplois, de liberté et de dignité nationale ». En place, ils ont eu un cauchemar où une meute de loups venus d’ici et d’ailleurs, a dévoré leur troupeau et louche maintenant vers leur maigre chair.
Il est temps de se réveiller, pour que le cauchemar cesse.
A suivre…
Hedi Zaiem
(*) Ceci est le premier article d’une série consacrée au bilan des dix années de post-révolution, mais surtout de proposer les orientations futures. Le bilan ne concernera que les points qui serviront à éclairer les orientations futures.
- Ecrire un commentaire
- Commenter