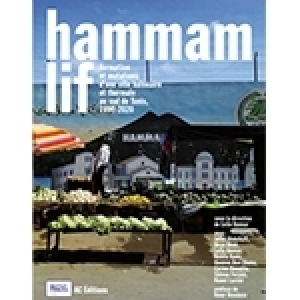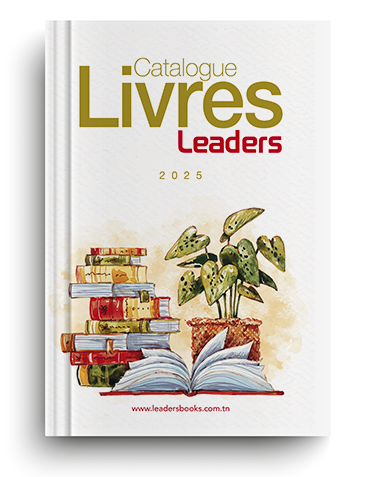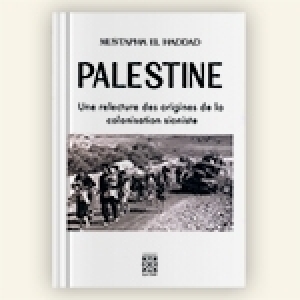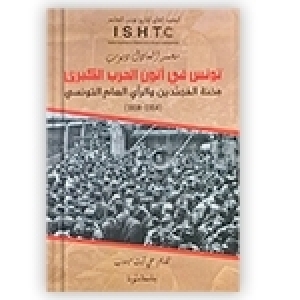L’initiative de BCE: le mariage de la carpe et du lapin

Dans l’interview accordée à Elyes Gharbi et diffusée le jeudi 2 juin 2016 sur la Wataniya 1, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, après avoir fait un état des lieux du pays, évalué l’activité gouvernementale et listé les difficultés et obstacles rencontrés, a proposé comme solution la constitution d’un gouvernement d’union nationale avec l’obligation d’y inclure l’UGTT et UTICA.
Un mariage arrangé
.jpg) De prime abord, cette initiative semble se limiter à un bilan dressant un constat d’échec ou du moins pointant l’insuffisance de l’équipe gouvernementale actuelle, mais en réalité, elle constitue une mesure préventive. En fin stratège, le Président voit s’approcher la crise qui se profile depuis l’éclatement de NidaaTounès et dont la contestation de certains ministres est un signe avant-coureur. Au lieu d’attendre, il a décidé de devancer la crise et d’aborder le problème de l’équilibre des forces auquel le parti qu’il a fondé doit faire face tôt ou tard. En ce sens, le retour à Nidaa de l’un ou de l’autre de certains députés «égarés» n’est peut-être pas étranger à cette stratégie. Equilibrer le rapport de forces tout en limitant les dégâts dans les rangs de Nida, tel semble être un des objectifs de cet habile souhait présidentiel dans cette interview scénarisée comme une téléréalité tellement les rôles et les réparties entre l’interviewer et l’interviewé étaient réglés comme du papier à musique.
De prime abord, cette initiative semble se limiter à un bilan dressant un constat d’échec ou du moins pointant l’insuffisance de l’équipe gouvernementale actuelle, mais en réalité, elle constitue une mesure préventive. En fin stratège, le Président voit s’approcher la crise qui se profile depuis l’éclatement de NidaaTounès et dont la contestation de certains ministres est un signe avant-coureur. Au lieu d’attendre, il a décidé de devancer la crise et d’aborder le problème de l’équilibre des forces auquel le parti qu’il a fondé doit faire face tôt ou tard. En ce sens, le retour à Nidaa de l’un ou de l’autre de certains députés «égarés» n’est peut-être pas étranger à cette stratégie. Equilibrer le rapport de forces tout en limitant les dégâts dans les rangs de Nida, tel semble être un des objectifs de cet habile souhait présidentiel dans cette interview scénarisée comme une téléréalité tellement les rôles et les réparties entre l’interviewer et l’interviewé étaient réglés comme du papier à musique.
Pour l’instant, hormis le Front Populaire, toutes les parties ont salué cette initiative même si l’UGTT semble décliner l’invitation à participer à un tel gouvernement. Initiative qui, même si elle réussissait et qu’elle était adoptée, ne serait pas sans créer de problèmes.
Et d’abord celui du leadership. En effet, qui pour présider un tel gouvernement? Qui disposerait à la fois de la compétence, de l’expérience, du charisme et d’un capital de confiance pour s’imposer à toutes les parties prenantes. Ensuite se pose le casse-tête de la composition d’une équipe qui puisse satisfaire tous les partis et organisations partenaires. Cela ne risque-t-il pas d’aboutir à un gouvernement patchwork qu’il serait difficile de manager et dont il serait malaisé d’harmoniser l’action? Et puis comment prévenir les conflits d’intérêts lorsque des personnes sont à la fois ministres et représentants d’organisations syndicales ou professionnelles par exemple? Comment être juge et parti?
A moins de faire marche arrière et de reproduire l’expérience transitoire d’avant les élections de 2014, en ayant recours aux «experts apolitiques et indépendants», aux «compétences nationales», la formation d’un tel gouvernement s’avère un véritable casse-tête et pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.
La passion du consensus
Cette initiative qui semble relever de l’esprit qui a présidé au dialogue national, n’est en fait que la continuation de l’existant. Après tout, le souhait de BCE, c’est l’amplification du consensus actuel et son élargissement aux organisations professionnelles et syndicales et à d’éventuels autres partis. Espérant ainsi obtenir une paix sociale durable qui permettrait de redresser la situation économique et d’entreprendre les réformes nécessaires. Cependant, rien ne garantit que le consensus ainsi amplifié et transformé en unanimisme ne risque pas d’amplifier à son tour la lenteur, l’inertie et l’impéritie relevées et dénoncées par le Chef de l’Etat.
Ce souhait de n’exclure personne part d’un bon sentiment mais, outre le fait qu’on ne gouverne pas avec de bons sentiments, il dénote une phobie de tout conflit et de toute opposition et du coup il révèle un manque de confiance dans la lutte et le débat démocratiques pour ne pas dire un déni de démocratie. Et d’une certaine mesure, il pourrait être perçu comme une «nostalgie» du Parti unique.
Cette recherche effrénée du consensus depuis 2014 trouve peut-être son origine et son explication dans le supposé accord de Paris que l’on prête aux deux vieux leaders: BCE et Ghannouchi. En effet, il est aisé de reconnaître là une illustration de la fameuse «Al wasatya» de Qaradawi, notion que le Président d’Ennahdha a adoptée et largement popularisée sous la forme de «consensus au centre». On peut aussi reconnaitre dans le consensus une forme particulière et dérivée de la notion juridique de «Al-Ijmaa», cette unanimité supposée prémunir la communauté musulmane de la discorde, «al-fitna».
La postpolitique en postdémocratie
A ces raisons endogènes, il faudrait ajouter d’autres, exogènes. En fait, on constate que cette recherche du consensus a gagné la plupart des démocraties et notamment européennes, au fur et à mesure que la pensée néolibérale et conservatrice étendait son hégémonie. Cette pensée a imposé la primauté du marché et malgré les crises à répétition, à force de ressasser à satiété qu’il n’existe pas d’alternative à sa politique, elle semble avoir persuadé les élites et notamment dirigeantes. En effet, ces dernières, qu’elles soient de gauche ou de droite, se succèdent alternativement au pouvoir pour appliquer le même programme, ce qui rend vaine toute tentative de changement par la voie démocratique traditionnelle. A ce titre, le tout nouveau courant créé par le ministre français M. Macron est révélateur. En effet, «En Marche» se veut un parti ni de gauche, ni de droite!
Cette démocratie consensuelle et néolibérale explique le désintérêt des citoyens pour la chose politique et notamment pour les élections qu’ils boycottent allégrement et auxquelles ils ne participent que pour protester et pour porter leurs voix aux partis populistes et/ou d’extrême droite comme on le constate en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie et dans une moindre mesure en Autriche et en France… Ce qui est confirmé par l’analyse faite par la philosophe et politologue belge, Chantal Mouffe: «La France, comme tous les pays européens, vit une crise de représentation. Celle-ci est due à une vision postpolitique désormais dominante : les frontières entre gauche et droite se sont effacées et on nous présente cela comme un progrès parce que cela permettrait une forme consensuelle de démocratie» (Libération, 15 avr. 2016).
Eloge du conflit
Tous les citoyens, heureusement, ne se portent pas sur les partis d’extrême droite. Une partie d’entre eux, dans le sillage, d’ailleurs, de la révolution tunisienne et des autres insurrections arabes, inventent et expérimentent d’autres formes d’organisation, de protestations et de pratiques démocratiques. Ainsi en est-il d’Occupy Wall Street à New-York en septembre 2011, des Indignados espagnols sur la place Puerta del Sol à Madrid en mai 2011 et ainsi en est-il aujourd’hui du Mouvement Nuit Debout sur la place de la République à Paris entre autres…toutes ces places rappellent, la Place Et-Tahrir au Caire, La Kasbah et l’avenue Bourguiba à Tunis, la Place de la Perle à Manama…
Ces mouvements rapidement évoqués ici revendiquent une vraie démocratie où le conflit, le clivage et l’antagonisme politique feraient émerger un véritable débat entre les citoyens qui auraient un véritable choix entre différents projets politiques car sans différences, sans conflit, bref sans dissensus, il n’y a point de vie démocratique, comme le démontre la nouvelle coqueluche des sciences politiques, Chantal Mouffe, dans ses deux ouvrages sortis cette année* où elle défend la confrontation qu’elle appelle «agonistique», c’est-à-dire une confrontation entre adversaires et non entre ennemis.
C’est peut-être là un moyen de réenchanter la politique, de remobiliser les citoyens et d’impulser de l’espoir, ce qui peut être éloignerait les jeunes Tunisiens des voies suicidaires habituels: l’immolation (yehrigrouha); l’émigration clandestine (yehrig el kouaghitwelhdoud) et le terrorisme (yehrig el bladwelcbad).
Slaheddine Dchicha
*L'illusion du consensus, Albin Michel, 2016, 200p., 17,50€
*Le paradoxe démocratique, Beaux-Arts de Paris éditions, 2016, 152 p., 20 €.
- Ecrire un commentaire
- Commenter