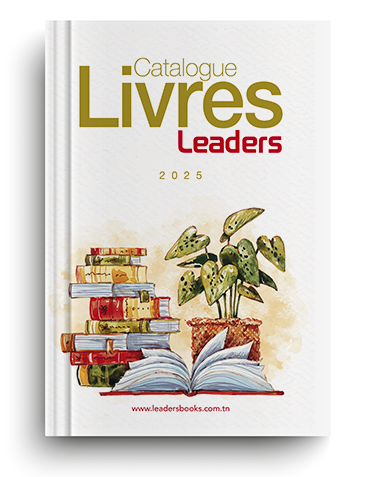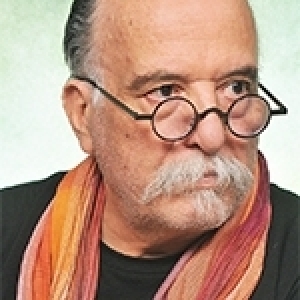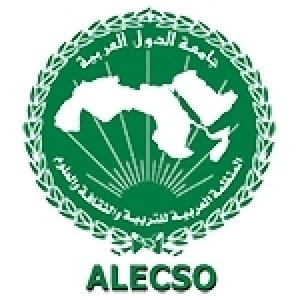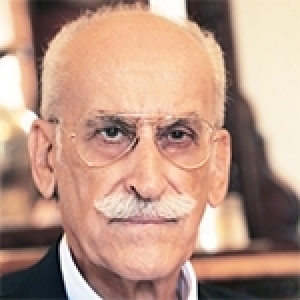« La finalité démocratique du Printemps Arabe est enfin réaffirmée dans le cas syrien, souligne l’ambassadeur Ahmed Ounaïes. Dans une Communication présentée à la tribune du Cercle Kheireddine, à Tunis, le samedi 10 octobre 2015, il rappelle que Poutine et Rohani déclarent qu’il faut faire évoluer le régime syrien. L’élimination des groupes jihadistes ouvre la voie à l’islam modéré, apte à la conciliation avec les principes démocratiques. Le précédent tunisien établit que la percée démocratique est compatible avec l’islam modéré, non jihadiste ».
« Dans son fond, ajoute-t-il, la stratégie américaine nous éclaire sur une lacune que nous n’avions pas assumée en conscience claire : le préalable opposé aux islamistes et que nous formulions en tant que rejet de l’amalgame entre islam et politique, dissimulait un problème de forme qu’il fallait affronter et qui n’était en fait qu’une exclusion masquée. Le principe démocratique dicte d’admettre la légitimité électorale des islamistes en vertu de leurs scores numériques même si les scores n’établissent pas leur foi démocratique. Les élections réalisées entre 2011 et 2014 lèvent le préalable de facto. Les partis islamiques, ainsi légitimés, sont alors tenus d’établir sans équivoque leur crédit démocratique : c’est alors que commence le processus endogène d’édification de l’ordre démocratique et que se posent les problèmes de fond. A ce titre, l’expérience tunisienne est fondamentale.
Ce déclic, réalisé entre le 1er mars et le 23 octobre 2011, n’est pas sans rapport avec les niveaux d’exclusion qui qualifient la scène arabe et qui trahissent la rigidité de la société politique arabe. Cette rigidité est à la base d’une régression typique qui génère l’immobilisme, l’exil, la violence… et qui fournit un alibi à la dictature. Ce sont des niveaux d’exclusion plus ou moins amples, plus ou moins violents, mais également illégitimes. Ce déclic était porté par la Révolution de janvier 2011, c’est l’un de ses mérites historiques ».
« Est-il vrai que l’enjeu démocratique soit aujourd’hui marginal, s’interroge l’ambassadeur Ounaïes ? Il est vrai qu’avant la conquête de l’Etat indépendant, l’enjeu primordial est l’indépendance et la souveraineté. Telle est la logique de la lutte existentielle. Après la conquête de l’indépendance et de la souveraineté, les valeurs de liberté, de justice et d’égalité, inhérentes aux droits de l’homme, sont inséparables de la compétition politique légitime. La mission essentielle de l’Etat est de promouvoir et de préserver ces valeurs garantes de l’ordre démocratique. La négation de ces valeurs substitue la violence à la compétition politique : ainsi se constitue l’ordre despotique. L’Etat est fort quand il s’acquitte de cette mission, il s’affaiblit en manquant à cette mission. Il n’y a pas de contradiction entre démocratie et Etat fort.
Au Machrek, l’état de guerre larvée induit par l’effraction israélienne peut justifier, pour les Etats voisins d’Israël, la prorogation de la lutte existentielle au-delà de l’indépendance. Ce dilemme ne se justifie pas au Maghreb. Bien au contraire, il pose la légitimité de la révolution démocratique.
« La Tunisie, isolée dans sa région, n’est pas isolée dans le monde, conclut-il. La communauté des Etats démocratiques se reconnaît dans le choix de la Tunisie. La Tunisie sert la cause du Maghreb et du monde arabe plus sûrement au moyen de valeurs partagées qu’au moyen de valeurs militaires ou de moyens financiers qui, à eux seuls, ont révélé leurs limites. Le prix Nobel proclamé le 9 octobre valide le rattachement de la Tunisie aux valeurs qui font la civilisation de notre temps. Isolée dans sa région, la Tunisie n’est pas isolée dans le monde, elle n’a pas manqué sa Révolution ».
Texte intégral
2011. Un nouveau cycle s’ouvre pour le monde arabe. La région connaît une fluidité historique exceptionnelle. Une offensive intérieure puissante s’attaque aux régimes établis depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans… Républiques, Monarchies, Emirats et régimes indécis, telle que la Libye, se cherchent de nouveaux équilibres intérieurs. Des problèmes de fond sont posés : l’institution des libertés, la place de la femme, l’éducation. Des symboles s’attachent à ce moment de la Umma : le cri ‘‘ach-chaab yurid !’’ résonne dans toutes les capitales ; le Président de l’Egypte est traîné dans un procès télévisé et ses biens confisqués ; au saint des saints du Wahabisme, la femme devient électrice et éligible ; l’Etat de Palestine devient membre à part entière de l’UNESCO. Qui l’eût cru, cinq ans auparavant ? Cependant, si un aggiornamento arabe est en cours, il sera sans doute très inégal tout comme, 50 ans après les indépendances, l’essor et le développement des pays arabes sont inégaux, sans rapport avec le potentiel des pays.
En Tunisie, l’année 2014 clôt la première phase de la transition avec l’adoption de la Constitution en janvier, à une très large majorité, et la conclusion des élections présidentielle et législatives non contestées d’octobre et décembre. L’année 2015 ouvre une nouvelle phase appelée à compléter les institutions du nouveau régime et à réaliser les objectifs stratégiques de la Révolution.
Dans le monde, le bilan de la transition tunisienne est jugé positif. La légitimité du nouveau régime est incontestable. La Tunisie réalise en quatre ans le consensus national sur l’édification d’un ordre politique inclusif, démocratique et fondé sur le dialogue et le compromis. Trois facteurs distinguent cette transition : l’admission des principes universels posés comme étant conciliables avec les bases de la foi islamique ; l’admission des élections comme l’arbitre ultime de la compétition politique ; la participation du parti islamique Nahdha dans toutes les coalitions gouvernementales depuis 2011. La Tunisie est créditée comme étant à la fois attachée aux principes et mûre pour le dialogue. Les compromis jugés sévèrement dans l’opinion intérieure sont salués dans le monde comme le trait d’un génie politique qui hisse la Tunisie à l’avant-garde des pays de la région.
Avec l’année 2015 commence l’épreuve de vérité, dans un contexte dominé par l’aggravation des facteurs de risque et de rares facteurs favorables.
Les points négatifs (huit)
- La persistance de la menace terroriste intérieure ;
- Un climat social menaçant, en raison des grèves et des mauvaises performances en matière touristique et agricole ; ce climat risque d’aggraver les fissures du socle d’unité nationale, reflétées dans les résultats des élections présidentielles ;
- Résurgence de la toute puissance de la police : ce phénomène, attribué aux syndicats des services de sécurité, laisse craindre une faiblesse profonde de l’Etat ;
- Les relations de voisinage avec l’Algérie et la Libye sont secouées par des crises intermittentes qui ne sont pas surmontées ;
- Le chaos libyen amplifie les menaces internes et projette des menaces spécifiques : camps de formation de jihadistes (le chiffre flottant est de 1.500 tunisiens), foyer de trafic qui, au-delà des armes et de la drogue, alimente l’économie informelle ;
- Les crises régionales dans le théâtre Maghreb-Sahel ne sont pas résolues ;
- La réserve persistante des pays du Golfe ;
- Les soutiens internationaux, notamment des puissances mondiales, ne traduisent pas un engagement de solidarité ; la Grèce et l’Ukraine, en comparaison, suscitent une mobilisation politique et des réponses économiques et financières concrètes.
Les points positifs (quatre)
- La lutte contre le terrorisme est mieux organisée et plus efficace ;
- La diversification de la coopération sécuritaire ;
- L’engagement renouvelé du G-7 dans son soutien à l’effort de redressement économique et de lutte contre le terrorisme ;
- Le soutien politique très ferme des Etats Unis.
L’évolution de la scène arabe
La portée du Printemps Arabe est double : la fin des dictatures et l’avènement de régimes démocratiques portés par la volonté populaire. Or, la finalité démocratique est aussitôt concurrencée par la montée d’un ordre islamique imposé par la force. Dès lors, le processus de transition succombe à l’alternative : régime islamique ou guerre civile.
A ce jour, seule la Tunisie a sauvé la finalité démocratique moyennant un compromis avec le parti Nahdha. Cependant, les forces régressives en acte dans le Maghreb et dans le Machrek constituent la menace la plus sérieuse pour le nouveau régime qui reste isolé dans la région. Pour la Tunisie, la menace tient à la conjonction des forces islamiques extérieures avec les radicaux du parti Nahdha qui, pour leur part, n’endossent pas l’alliance de leurs dirigeants avec les partis d’inspiration bourguibienne et laïque qui, à leurs yeux, ont arraché la Tunisie à son destin islamique et qui risquent de la perdre à jamais pour la Umma. Cette lutte mine la phase présente de la transition. La légitimité du nouveau régime n’est pas de nature à le prémunir contre une telle menace. Le dilemme tient à l’identité du parti Nahdha. Cette identité reste obscure. De ce fait, la menace de guerre civile n’est pas totalement écartée.
Dans ce contexte, l’analyse algérienne est tranchante. Pour l’Algérie, les jeux sont loin d’être faits. Le compromis réalisé en Tunisie est précaire : la Tunisie croit avoir gagné la cause démocratique. Or, en offrant au parti islamique une place dans l’Etat, la Tunisie tombe dans un piège qui aboutira inéluctablement à l’évincement des partis bourgeois, effrités et discrédités, et qui sont loin de tenir la gageure devant la détermination et la volonté de puissance des islamistes qui n’attachent aucun crédit à la logomachie démocratique ni à la légitimité du système électoral. Tandis que la Tunisie se berce d’illusion, les forces réelles à l’œuvre s’attachent par le terrorisme, par le harcèlement social et par la manne d’argent qu’elles détiennent, à paralyser le système, à acheter l’électorat et à phagocyter l’Etat une fois pour toutes. L’Algérie s’attend à l’affrontement crucial inévitable : à l’heure de vérité, les progressistes tunisiens en appelleront à l’Algérie et réaliseront alors le sens de son intransigeance salutaire.
Pour l’Algérie, l’enjeu n’est pas la démocratie. La lutte réelle oppose les pays arabes à deux forces : d’une part, les islamistes rétrogrades solidement implantés, qui disposent de moyens incommensurables et qui ne cherchent qu’à s’emparer de l’Etat et, d’autre part, les forces occidentales qui visent à briser les Etats parce qu’ils convoitent nos ressources : les Occidentaux ébranlés dans leurs bases économiques et dans leur immunité stratégique du fait des guerres perdues contre l’islam et de la montée en puissance de nouveaux concurrents, tel que le bloc sino-russe, utilisent l’islamisme pour provoquer le chaos, détruire les Etats et détourner les ressources à bon compte. Dans cette logique, sauver l’intégrité et la puissance de l’Etat est la priorité absolue. Le sursaut salutaire de l’Egypte et la résistance de la Syrie sont des points forts parce que, précisément, ils préservent l’Etat.
Pour les pays du Golfe, la priorité est de briser l’arc shia qui menace de rompre l’équilibre régional du fait de la nouvelle gouvernance irakienne et des ambitions nucléaires de l’Iran. A cette fin, tous les moyens sont bons. Ils s’attachent aussi à écarter la contagion démocratique, porteuse d’anarchie et destructrice de l’ordre régional. Les pays du Golfe seront donc prémunis d’autorité contre une telle contagion : exemple, la répression radicale de la révolte égalitariste à Bahrein. Quant à l’alternative islamique, qu’elle soit sunna – portée par le réseau des Frères Musulmans – ou shia – portée par l’Iran, l’Irak, Hizbullah ou la Syrie Alaouite – elle est aussi néfaste. Telle est la thèse de l’aile conservatrice.
Dans ce champ, Qatar se distingue par la volonté de faire prévaloir, à la faveur du printemps arabe, l’avènement de régimes islamiques mais qui illustrent, à l’image de la Turquie, le modèle de l’islam ouvert sur la modernité. Telle est la thèse de l’aile moderniste, portée par la Turquie et Qatar. Le rôle de Qatar, avant et après la Révolution de 2011, est indissociable de l’activisme des émirs Al Thani qui ont placé leur pays dans l’orbite occidentale.
Le tournant géopolitique américain
La stratégie occidentale est de s’attaquer à l’extrémisme islamique à la racine et, à cette fin, de provoquer une réforme fondamentale des sociétés arabes. Les Etats-Unis, en guerre totale contre l’islam extrémiste depuis des décennies, n’a remporté aucune victoire décisive contre l’ennemi. Nulle part en pays d’islam – Somalie, Afghanistan, Irak et déjà au Liban (Beyrouth, 23 oct 1983) – nulle part les troupes n’ont achevé la mission : les forces occidentales se sont partout repliées sur un compromis de façade. A son tour, l’islam extrémiste se pose en ennemi des puissances occidentales et des régimes arabes, tous ennemis de l’islam. La désarticulation est intenable : les sociétés arabes produisent des islamistes qu’ils rejettent et qu’ils forcent à l’exil, précisément dans les sociétés occidentales où ces exilés vivent dans la haine de l’Occident. Cet état de tension n’est surmontable qu’au prix de la conciliation des pays arabes avec les partis islamistes, pourvu que ces partis admettent la voie électorale, non la violence, pour prendre part aux responsabilités politiques dans leurs pays. Pour leur part, les dirigeants islamistes, sûrs d’eux-mêmes et de leurs bases nationales, acceptent la solution et jouent le jeu.
En vertu du compromis, les islamistes cesseraient d’être parias ; ils seraient admis comme acteurs et producteurs de la vie politique à l’égal des autres. Le dilemme est d’élaborer, dans chaque pays, le cadre national acceptable par l’ensemble des forces politiques et de souscrire notamment à l’arbitrage électoral.
Quant au fond, l’islam politique est appelé à sacrifier la légitimité transcendantale du message dont il s’estime porteur, et admettre de passer par l’épreuve de la compétition électorale et du mérite comparatif. La légitimité politique est à ce prix. En contrepartie, il n’est pas nécessaire d’accéder d’emblée au pouvoir, il suffit de la simple normalisation, de devenir acteur de la scène politique nationale, et de prendre pied au Parlement et dans les municipalités.
Ce compromis a le mérite de surmonter la fracture politique typique des sociétés arabes et qui génère indéfiniment l’extrémisme, la violence et la rigidité. Il ouvre la voie à une dialectique capable de générer des vertus d’intégration et des modèles communautaires souples. La société arabe démocratique se construira empiriquement. Pour n’avoir pas tenté une telle expérience, les sociétés arabes se sont privées de la faculté de créer des valeurs politiques modernes et des progrès politiques propres à la civilisation de l’islam.
Tel est le compromis posé par les Etats-Unis avec l’islam politique. Sans renoncer à la lutte contre l’extrémisme, ils ménagent pour les partis islamistes la voie de l’action politique responsable, dans un cadre démocratique, moyennant l’admission du pluralisme, l’interaction avec les autres forces politiques, la quête de la légitimité par le suffrage populaire et le renoncement à la violence. La responsabilisation induit par elle-même le sens de la mesure et de l’auto régulation.
Reste la démarche : quand et comment ?
Il est clair que l’épreuve de la conciliation incombe aux sociétés arabes elles-mêmes, dans une relation directe avec les islamistes, fruits de leur politique et de leur culture. Les dictatures arabes en place ne l’admettraient pas car elles fondent une part de leur légitimité précisément sur la lutte contre l’islam politique. Ces dictatures opposent un mur à la fois aux islamistes et aux démocrates ; elles bloquent toute ouverture, toute chance d’une dialectique constructive permettant de faire évoluer les peuples et les élites figées dans l’immobilisme. Les dictatures font obstacle à toute évolution politique. Il est temps d’éliminer les dictatures.
La brèche ouverte en janvier 2011 – spontanée ou provoquée, peu importe – est le point de départ de la mise en œuvre de la stratégie. A l’avance, entre les Etats Unis et le Royaume Uni d’une part, la Turquie et Qatar d’autre part, l’entente était scellée : promouvoir dans le monde arabe le modèle d’un islam ouvert, moderne et démocratique. Une convergence tactique unit ainsi trois pôles : Etats Unis/ Angleterre, leurs deux alliés et les partis islamistes. Ils foncent dans la brèche…
Le front de l’Afrique du Nord
Les expériences réalisées à partir de 2011 au Maroc, en Egypte et en Tunisie sont autant de variables encourageantes. Les premières élections offrent aux islamistes la conquête de la légitimité. Portés ensuite au pouvoir, les islamistes découvrent la démocratie : lutte perpétuelle, épreuve de gestion, de compétence, de talent. L’arène intérieure est implacable : ils réalisent le poids de la responsabilité et font des concessions en réponse au harcèlement des partis, à la réactivité des médias, aux impatiences populaires, à la défiance des femmes. La dialectique est en marche.
La valeur de ce tournant inaugural ne tient pas à l’esthétique du compromis mais à l’évaluation de la performance. La stratégie a entraîné en Afrique du Nord des changements radicaux. La Révolution s’est matérialisée dans quatre pays : au Maroc où la transition est le fait de la loi, en Tunisie, en Egypte et en Libye où la révolution est le fait de la rue. Dans ces pays, l’engrenage a porté les partis islamiques au cœur de l’échiquier politique. Six facteurs illustrent le tournant géopolitique :
- Le préalable anti-islamique est levé ; le pluralisme effectif consacre la légitimation des partis islamiques ;
- Les partis islamiques entrent aux Parlements et participent au pouvoir ;
- L’exigence démocratique occupe une place centrale dans cette phase de la transition ;
- La société civile s’organise et revendique un rôle prépondérant ;
- Le recul de l’Etat et la montée consécutive des revendications sociales ;
- L’adoption de nouvelles Constitutions.
Au terme de l’année 2011, le paysage régional est totalement changé, même si l’issue finale reste incertaine. L’année 2012 constituera l’épreuve-test.
Les Etats-Unis réalisent les premiers échecs à la mesure des assauts haineux contre leurs missions diplomatiques à Benghazi et à Tunis, et à la montée de l’insécurité intérieure qui s’élève jusqu’à l’assassinat politique. Cependant, ils relancent le jeu : la faculté de l’échec est inhérente à l’action politique, il est donc nécessaire de donner au compromis historique le temps de l’ajustement et de la formation de ses propres assises.
Les premiers revers en Libye et en Tunisie ne doivent pas compromettre la stratégie globale. Les Etats Unis payent le prix politique. Ils se font toutefois vigilants quant à l’amélioration de la sécurité, au respect des libertés et à la gestion électorale rigoureuse. Ces priorités commandent la poursuite crédible du processus.
Deux voies s’esquissent alors : la voie civile qui laisse toutes ses chances au processus démocratique ; et la voie militaire, quand interviennent les armées ou les milices : c’est alors le retour à la main de fer ou l’éclatement de la guerre civile.
En Egypte, les élections législatives du 10 janvier 2012 donnent la majorité aux Frères Musulmans puis les élections présidentielles du 24 juin portent à la présidence Mohamed Morsi, encore une figure des Frères Musulmans. Mais au bout d’un an, le 3 juillet 2013, l’armée, soutenue par le Mouvement Tamarrud, revient en force et destitue le Président élu qui avait accumulé les provocations au point d’unir miraculeusement l’armée et la rue contre le pouvoir des Frères. De juillet 2013 à juin 2014, le Général Sissi provoque alors, non pas une contre-révolution, mais une seconde révolution qui relance la transition sur de nouvelles bases. Dans cette récupération, la restauration de l’Etat supplante toute autre considération.
La Libye, dotée le 7 juillet 2012 d’un Congrès National élu où la coalition des libéraux détient la majorité, subit le harcèlement croissant des milices islamiques irrédentistes qui, d’étape en étape, paralysent le gouvernement et jettent le pays dans la guerre civile. Quel espoir subsiste pour le choix démocratique ? Nul n’en répond.
Le front du Machrek
Le Machrek semble voué à la loi de la jungle. Dans ce champ, la légitimité des régimes tient certes au respect des règles démocratiques, mais ce fondement est éclipsé par la priorité de la lutte existentielle face à l’ennemi, c’est-à-dire face à Israël dont la suprématie militaire bénéficie du soutien total du bloc occidental ; face au déni des droits les plus élémentaires des peuples de la région ; face à la politique de discrimination fondamentale imposée aux peuples voisins d’Israël ; face au cynisme des politiques de veto qui prémunissent Israël contre les sanctions induites par ses violations répétées de la légalité internationale.
Dans le Machrek, le principe de légitimité, loin d’obéir aux impératifs de la démocratie, est aliéné par le diktat occidental qui tient l’ensemble de la région sous l’empire de la politique de puissance. Précisément, la politique syrienne oppose une résistance absolue face à la politique de puissance et au cynisme qui dominent le Machrek.
En toute cohérence, les puissances occidentales décident, à la faveur du Printemps Arabe, d’abattre le régime Assad.
Pour la Russie et la Chine – évincées déjà de Libye par l’offensive de l’OTAN en 2011– le conflit syrien est provoqué par les Etats Unis dans le but d’installer un régime docile. La Russie est instruite par les révolutions déclenchées en Europe et au Caucase, sous l’argument démocratique, mais dont la finalité évidente était de l’évincer et d’installer des régimes dociles. Le cas syrien reproduit la manœuvre. Quant à la Chine, elle s’oppose par principe à la stratégie de changement de régime initiée par les Occidentaux sous quelque prétexte que ce soit. Pour la Russie et la Chine, il fallait donc mettre un terme à l’offensive occidentale qui illustre une volonté d’hégémonie inacceptable.
Sur le théâtre du Machrek, les implications de la guerre d’Irak n’avaient pas fini, en 2011, de produire des réactions en chaîne. Aux stratégies occidentales, se conjuguent les priorités des pays du Golfe, les ambitions de la nation kurde, le dynamisme des formations jihadistes issues d’al-Qaïda, le jeu israélien qui attise les guerres interarabes, les projections des lobbies néo-conservateurs et les stratégies défensives de l’arc shia. Ainsi se superpose une stratégie seconde qui, de proche en proche, étend la guerre sur plusieurs fronts, et qui fixe le duel entre le bloc occidental et l’alliance de la Russie et de la Chine. Le conflit syrien devient le point de fixation des forces régionales et le point focal de l’ordre mondial.
Sur le théâtre syrien, la révolution déclenchée le 18 mars 2011 n’a pu venir à bout du régime Assad. Le 15 septembre 2011, l’opposition forme un Conseil National Syrien dirigé par des personnalités démocratiques (Borhane Ghalioune et Basma Kodmani) ; parallèlement, les défections de l’armée permettent de former le noyau d’une Armée Syrienne Libre, proclamée le 29 juillet 2011. L’un et l’autre refusent l’intervention étrangère et se fixent pour objectifs la fin de la dictature et l’avènement d’une Syrie démocratique. Aussitôt, les éléments islamistes, en majorité affiliés aux Frères Musulmans, submergent les deux formations, s’empressent d’internationaliser le conflit et déchaînent une vaste campagne armée, d’une violence extrême. Le parti Nahdha contribue activement à cette campagne.
Avant même la session de Doha du Conseil National Syrien le 5 novembre 2012, les démocrates au sein du CNS et les officiers au sein de l’Armée Syrienne Libre réalisent que l’agenda régional, loin de servir l’alternative démocratique, n’a d’autre but que d’assurer la mainmise des groupes islamiques et de détruire l’Etat. Borhane Ghalioun démissionne le 24 mai et Bassma Kodmani, le 28 août.
Quatre formations principales, séparément, forment l’offensive :
- Le Front Nosra affilié à al-Qaïda ;
- L’Etat Islamique, futur Daech ;
- Le Front Islamique qui fédère sept groupes syriens islamiques enracinés dans toutes les provinces du pays, dont un groupe kurde ;
- L’Armée Syrienne Libre qui s’efforce de garder son autonomie politique et son credo nationaliste.
Ces formations sont armées et financées par les pays du Golfe, par la Turquie et par les principaux pays occidentaux, avec le soutien d’Israël. L’Iran et Hizbullah, ainsi que la Russie et la Chine, soutiennent militairement et politiquement le régime Assad. Le champ est éclaté. Commençons par la Ligue arabe.
En 2011, la Ligue Arabe est prise en main par le Premier ministre de Qatar, Hamad Ibn Jassem Al-Thani, qui assurait alors la présidence du Conseil des ministres des Affaires Etrangères alors que l’onde de choc du Printemps Arabe frappait l’ensemble de la région. Il détermine la Ligue à cautionner l’intervention franco-britannique en Libye et à suspendre la participation de la Syrie. En outre, il prête main forte aux partis islamiques sur tous les fronts.
Pour la première fois, la Ligue Arabe et les NU chargent un même diplomate (Kofi Annan puis Lakhdhar Brahimi) d’une mission commune : la médiation entre le gouvernement syrien et l’opposition ; la démarche aboutit à la formation d’un Groupe d’action de 12 membres qui tient une Conférence à Genève le 30 juin 2012 (Genève I) et qui adopte un plan de règlement politique. Le 22 janvier 2014, une nouvelle session (Genève II) associe pour la première fois des représentants du gouvernement et de l’opposition. Cependant, le dialogue ouvert alors sous le parrainage de Lakhdhar Brahimi (janvier et février) échoue à mettre en œuvre le plan de Genève : pour former un gouvernement mixte de transition, l’opposition exige d’emblée l’élimination du Président Assad, tandis que le régime en place revendique l’arbitrage électoral. Or, le 17 août 2015, le Conseil de Sécurité, à l’unanimité, valide à nouveau le Plan de Genève. Cette décision signifie qu’aucun progrès militaire n’était enregistré au cours des trois dernières années et qu’aucun des principaux acteurs ne croit plus à la perspective d’une victoire totale.
D’autres foyers de crise embrasent la région : en Irak, la communauté sunna entre en guerre contre les shia, contre la Syrie et contre l’Iran ; la minorité kurde récupère par les armes ses ressources et ses territoires; l’arc shia riposte à l’offensive sunna ouvertement soutenue par Israël et par les pays occidentaux.
Le Machrek en feu jette de nouveaux flux de réfugiés dans les pays voisins et au-delà, jusqu’au cœur de l’Europe. L’instabilité prolongée de la zone, aggravée par les sanctions contre l’Iran, entraîne une chute durable du prix du pétrole qui ajoute à la fragilisation des pays. Curieusement, les témoignages de solidarité à l’endroit du peuple syrien n’éveillent chez aucun des parrains occidentaux la question du Golan dont l’occupation remonte, à cette date, à 45 ans ; le règlement de la question palestinienne est éclipsé dans l’échelle des priorités régionales. Le Machrek s’auto-détruit : des actes barbares, décadents, souillent les lieux mêmes qui avaient fait sa grandeur. Le 26 mars 2015, une nouvelle guerre éclate au Yémen entre sunna et shia. Dans ce tableau, nul ne perçoit la moindre perspective de paix. Le chaos qui s’abat sur la région est la négation de la culture arabe et une offense à la civilisation de l’islam.
La théorie du chaos constructif
La théorie du chaos s’inspire du principe qu’un ordre politique obsolète ne change pas par les moyens pacifiques ; il résistera à toute coercition légale ou populaire. Pour le changer, il faut user de violence extrême, il faut le chaos. C’est à ce prix qu’un ordre adapté à la nature profonde du terrain pourra émerger, correspondant à la culture et aux intérêts des peuples concernés. Plus que le terrorisme – violence ciblée – le chaos est la violence généralisée. Il sera nécessairement destructif avant de pouvoir réaliser sa finalité constructive. Cette théorie, attribuée à Léo Strauss, a inspiré le think tank Néo Conservateur qui a dominé la Maison Blanche sous la présidence G. W. Bush. Les initiatives guerrières et le projet du Grand Moyen Orient dérivent de cette vision.
Pendant la guerre du Liban de juillet 2006, Condoleezza Rice, interrogée sur les initiatives qu’elle comptait prendre pour ramener la paix, avait alors répondu (21 juillet 2006) : « Je ne vois pas l’intérêt de la diplomatie si c’est pour revenir au statu quo ante entre Israël et le Liban. Ce serait une erreur. Ce que nous voyons ici, d’une certaine manière, c’est le commencement, les contractions de la naissance d’un nouveau Moyen-Orient et, quoique nous fassions, nous devons être certains que nous poussons vers le nouveau Moyen-Orient et que nous ne retournons pas à l’ancien. »
A l’attaque du 11 septembre, le Président Bush répondait déjà par la violence disproportionnée, celle-là même qu’Israël poursuivait constamment au Machrek. Les guerres américaines dans la région ont fait évoluer la stratégie à l’échelle du Grand Moyen Orient avec pour objectif, non plus la réponse à un conflit défini, mais le remodelage de la région dans son ensemble. Barack Obama, dès son investiture en janvier 2009, avait démantelé la stratégie de son prédécesseur en accélérant le retrait des troupes dans toute la zone et en incitant les dirigeants arabes et israéliens à engager volontairement un processus de paix négociée et de réforme intérieure. Mais les piliers de la stratégie Bush veillaient au contraire à relancer la théorie du chaos. La Révolution de janvier 2011 en offrait l’occasion. Les forces complices, au sein de la région, conspirent à ouvrir devant cette stratégie un champ infini, tandis qu’à Washington les rapports secrets sont judicieusement manipulés à cette fin. Au service du chaos, l’argent et les armes n’ont jamais manqué. Telle est la stratégie seconde.
Quelle finalité se fixent les acteurs ? Les calculs de Netanyahu correspondent aux conclusions des Néo Conservateurs repliés dans le Parti Républicain ; ces calculs coïncident en partie avec ceux des puissances européennes ; de l’autre côté, les calculs varient selon les acteurs : turc ou kurde, sunna ou shia, Iran ou CCG, bloc occidental ou Russie-Chine. Au départ, les calculs de court terme et les alliances contre-nature l’emportent : le chaos enfle. On peut craindre que les réactions à l’Accord iranien du 14 juillet 2015 ne le portent à un palier supérieur.
Les prémisses du remodelage indiquent d’ores et déjà un éclatement de l’Irak, de la Syrie et de la Libye : un probable Etat Kurde revendique les provinces irako-syriennes, entité mono-ethnique qui fera des émules dans la région. D’autres entités basées sur la religion, la nation ou la secte alimentent les projections : Israël absorbant les territoires occupés ; Etat chrétien au Liban ; Etat palestinien congru. Le chaos, comme la guerre, crée des faits accomplis que la diplomatie se charge de valider, d’ajuster ou d’annuler. L’avenir du Machrek est sombre.
L’Etat Islamique, autre facteur de chaos
L’Etat Islamique naît dans la mouvance de la résistance sunnite à l'invasion de l’Irak en 2003. Au départ, le jordanien Abou Moussab Zarqaoui, vétéran d’Afghanistan, fonde dès la chute de Saddam Hussein en 2003, à partir d’un groupe jihadiste préexistant, Ansar al-Islam, la branche "Al-Qaida au Pays des deux rives " qui attire aussitôt les officiers libérés de l’armée irakienne. Après la mort de Zarqaoui en juin 2006, cette formation s’appuie sur cinq autres groupes jihadistes pour créer le 13 octobre 2006 le Conseil Consultatif des Moujahidines en Irak. Puis, avec l’appui des tribus sunnites de la province d'al-Anbar, ce Conseil proclame l'Etat Islamique d'Irak. L’EII se donne un Emir, Abou Omar Baghdadi et s’affirme comme le véritable État, destituant l’Etat shia qui contrôle Bagdad. Les services saoudiens le soutiennent dans sa lutte contre la mainmise des chiites sur le pouvoir irakien et contre la connivence de plus en plus nette entre l’Irak et l’Iran.
Quand éclate la révolution en Syrie le 18 mars, le régime syrien répond en décrétant aussitôt une amnistie des jihadistes. Une centaine de combattants sont ainsi libérés et récupérés par l’EII. Dès la libération d’un second groupe en novembre, des chefs jihadistes syriens décident, avec le concours saoudien, de rassembler les combattants et les vétérans ramenés d’Irak pour former le Front Nosra, dont la proclamation est saluée également par Al-Qaïda et par l’EII. Nosra revendique son premier attentat à Damas le 11 décembre 2011. A la même date, le 18 décembre, les dernières forces américaines quittent l’Irak. Baghdadi, avec le soutien des Saoudiens et de Qatar, accentue son combat contre les institutions shia et contre le gouvernement Nouri Maliki et élargit son action vers la Syrie, suscitant ainsi une rivalité croissante avec le Front Nosra.
Fort de son extension en Syrie, Baghdadi déclare le 9 avril 2013 la fusion de l'EII et du Front Nosra pour former l'État Islamique en Irak et au Levant (Daech). Cependant, le chef de Nosra, Abou Mohammad Jawlani, défend son indépendance. Le fossé se creuse alors entre les deux groupes jihadistes au point qu’ils s’entretuent pour l’occupation des provinces syriennes de l’Ouest. L’année suivante, le 29 juin 2014, Baghdadi pousse plus loin la provocation, proclame la restauration du Califat dans les territoires sunna de Syrie et d’Irak et se proclame Calife. L'organisation prend le nom d'État Islamique et reçoit aussitôt des allégeances de part en part du monde musulman.
Sauvagerie et chaos
Pour l’Etat Islamique, la Umma doit franchir l’étape nécessaire de la destruction des structures étatiques dans les pays musulmans en instaurant une situation de sauvagerie (tawahuch). La stratégie comprend trois étapes : la première, harceler l'ennemi par des attentats spectaculaires afin de l'affaiblir ; la deuxième, administrer la sauvagerie, l’étape la plus délicate ; la dernière étape est la proclamation du califat.
Dans la littérature de Daech, l’administration de la sauvagerie repose sur la violence extrême et sur la gestion rigoureuse des provinces soumises. Terroriser les ennemis et les populations permet de conquérir les territoires et de les conserver. En provoquant un déchaînement de violence dans les pays musulmans, les jihadistes entraînent les gouvernants à répondre par une violence supérieure et à perdre ainsi la confiance des populations. A cette fin, les techniques les plus terrifiantes sont déclarées licites : décapitation, massacre, enlèvement, lapidation, flagellation, amputation, bûcher. Tout doit être fait pour frapper les esprits. Dès que le territoire est sécurisé, il faudra gagner le soutien populaire : assurer la sécurité, la nourriture, la santé, la justice et l’enseignement. Les jihadistes, en se prévalant de la charia, sont préparés à administrer le chaos provoqué dans toutes ses étapes, La thèse est simpliste, mais le fait est qu’elle est pratiquée : elle est dévastatrice.
En 2014, surviennent deux faits nouveaux : le 17 avril, le remaniement de la Cour Saoudienne et, le 15 septembre, la formation de la Coalition militaire contre l’Etat Islamique, associant 22 pays occidentaux et arabes autour des Etats Unis. Les deux faits sont liés. Le roi Abdallah, à l’époque, était exaspéré par les prétentions de l’Etat Islamique autoproclamé et de ses excès, en particulier les luttes contre les autres groupes qui combattent en Syrie. En janvier 2014, Daech exécutait à Raqqah 99 combattants, faits prisonniers dans les rangs du Front Nosra et d'Ahrar al-Sham, l’un des groupes composant le Front Islamique.
Le prince Bandar qui avait la haute main sur le front syrien est écarté et les subventions à Daech sont suspendues. A la recherche de fonds, Daech réagit par une fuite en avant qui lui fait commettre des débordements totalement étrangers à la cause anti Assad et anti Shia. Les exactions commises contre les Kurdes (Kobane) déclenchent une réaction occidentale générale qui conduit à la formation de la Coalition.
La Coalition, de son côté, intervient militairement : dès le 8 août, les États-Unis engagent des forces aériennes contre l'EI dans le Kurdistan irakien. À partir de septembre, 8 pays occidentaux (France, Royaume-Uni, Canada, Australie, Pays-Bas, Danemark, Belgique, Italie) et le Maroc engagent leurs aviations et des forces spéciales en Irak. La nuit du 22 au 23 septembre, les forces aériennes des Etats Unis, de Jordanie, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et de Qatar lancent une campagne de bombardements contre l'État islamique en Syrie.
La Turquie, qui avait au départ encouragé Daech à s’attaquer aux Kurdes d’Irak et de Syrie, est à son tour attaquée : elle n’est plus à l’abri du feu qu’elle avait contribué à attiser ; elle doit à son tour réviser sa stratégie.
Ces évolutions contribuent à clarifier la scène. Les négociations en cours sur le nucléaire iranien aboutissent le 14 juillet 2015 à un accord majeur. Cette percée est le signal d’un basculement stratégique global. Elle est suivie, le 17 août, de la déclaration unanime du Conseil de Sécurité pour faire prévaloir en Syrie un règlement politique. Les grands acteurs conviennent qu’une plus grande maîtrise du théâtre s’impose, de crainte que l’aventurisme israélien et la nervosité saoudienne ne créent l’irréparable. La remobilisation consécutive de la Coalition contre l’Etat Islamique et le recentrage du régime Assad signifient le retour de la légalité et la fin du chaos.
Le gouvernement de transition en Syrie s’appuiera sur le régime légal et sur l’opposition modérée parmi les islamistes et les démocrates. Le Roi Salmane apprend le revirement le 4 septembre à Washington et Netanyahu l’apprend le 21 septembre à Moscou.
La portée du basculement stratégique
Trois facteurs déterminent le basculement stratégique
- D’une part, le Président Poutine exige la fin du terrorisme international armé et financé par les occidentaux et leurs alliés : il justifie l’engagement de la Russie dans cette lutte en se fondant sur la légitime défense, car le terrorisme se retournera immanquablement contre la Russie elle-même, et sur la demande formelle du régime légal syrien, victime du terrorisme international.
- D’autre part, les Etats Unis reconnaissent que l’extension du chaos favorise le terrorisme international. Tous deux redoutent une situation d’instabilité prolongée avec la destruction des structures de l’Etat, à l’instar de l’Afghanistan, de l’Irak et de la Libye ; la sécurité dans la région risque d’échapper à tout contrôle.
- Enfin, les groupes jihadistes ne manqueront pas de s’en prendre à l’Europe, à la Russie et à Israël ; les milliers de combattants, dont le retour a déjà commencé, constituent une menace majeure contre les pays d’origine : Poutine rappelle précisément le précédent afghan.
Sur cette base, le basculement stratégique prend deux formes
A l’échelle globale, un Groupe de contact de six pays définira le règlement politique conformément à la Déclaration de Genève. Il comprend : Etats Unis, Russie, Iran, Turquie, Arabie Saoudite et Egypte. Quatre Groupes de travail thématiques, formés en septembre par l’Envoyé Spécial de l’ONU pour la Syrie, doivent élaborer les réformes. Présidés par des européens et composés de syriens de tous bords, ils examineront :
- le dossier sécuritaire : Jan Egeland (Norvège) ;
- l’aspect militaire et la lutte contre le terrorisme, Volker Perthes (RFA) ;
- les questions politiques et juridiques, Nicolas Michel (Suisse) ;
- la reconstruction de la Syrie, Birgitta Holst Alani (Suède) ;
La portée de cette évolution est considérable. Elle signifie une gouvernance collégiale basée sur la non exclusion et sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Le Groupe de Contact tiendra sa première réunion en octobre, probablement au niveau des Ministres. L’esprit des discours prononcés le 28 septembre à la tribune des NU par Obama, Poutine et Rohani est très clair. Les décisions attendues sont l’élimination de Daech et le retour des réfugiés ; la formation du gouvernement intérimaire ; la fixation du calendrier de transition et de la date des élections générales. Nous en concluons le démantèlement de la stratégie du chaos.
La participation formelle de l’Iran dans le plan de règlement signifie d’abord l’apaisement du conflit général entre sunna et shia, sur tous les fronts ; d’autre part, l’échec de la campagne virulente de Netanyahu contre la politique d’Obama, auprès de la communauté juive aux Etats Unis et auprès du parti Républicain ; enfin, la majorité d’extrême droite à la Knesset réalisera la signification de cette nouvelle structure collégiale appelée à trancher le problème de la paix dans le voisinage d’Israël. Dans notre voisinage, l’élimination du réseau jihadiste débarrassera la région de l’emprise de Daech, implanté à Syrte, et remettra le règlement du conflit libyen sur la voie de la seule logique nationale libyenne.
A l’échelle régionale, une nouvelle alliance émerge incluant la Russie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. La genèse de cette alliance remonte à juillet, quand le Président Rohani se rend à l’invitation du Président Poutine à Oufa (Bachkirie) pour participer aux sommets des BRICS et de l’OCS (Organisation de Coopération de Shanghai) du 8 au 10 juillet 2015. Rohani estime que l’effondrement du régime syrien aurait des conséquences incalculables dans la région : avec la participation de la Russie, le redressement militaire et politique serait possible.
Quatre étapes suivent ce sommet. D’abord, le Général Qacim Suleimani, Commandant du Front du Machrek, se rend à Moscou fin juillet et expose les plans de la contre offensive suivant les analyses iraniennes ; il obtient l’accord officiel pour la participation russe à la contre offensive ; puis la visite du Général Manouchehr Manteghi, responsable de l’aviation au Ministère de la Défense, au salon de l’Aéronautique de Moscou en août : il signe un contrat d’acquisition d’un système de défense aérienne pour $21 milliards ; ensuite, la montée en puissance de la base maritime de Tartous et de la base aérienne Bassel à Lattaquié par les forces russes ; enfin, l’institution d’une coordination militaire à quatre (Irak, Syrie, Iran et Russie) à Bagdad le 26 septembre. Le 28 septembre, Poutine déclare aux NU l’engagement militaire en Syrie, en réponse à la demande du gouvernement légitime, dans le but de combattre les groupes terroristes. Les bombardements commencent le 30 septembre et l’offensive terrestre syrienne est déclenchée le 7 octobre avec l’appui déclaré de Hizbullah.
L’alliance, forte d’une légitimité incontestable, change le tableau stratégique régional : elle met fin à la suprématie de l’OTAN au Machrek. La réaction furieuse de l’OTAN s’explique. Netanyahu, par ailleurs, perd sur les deux tableaux.
CONCLUSION
1-La finalité démocratique du Printemps Arabe est enfin réaffirmée dans le cas syrien. Poutine et Rohani déclarent qu’il faut faire évoluer le régime syrien. L’élimination des groupes jihadistes ouvre la voie à l’islam modéré, apte à la conciliation avec les principes démocratiques. Le précédent tunisien établit que la percée démocratique est compatible avec l’islam modéré, non jihadiste.
Dans son fond, la stratégie américaine nous éclaire sur une lacune que nous n’avions pas assumée en conscience claire : le préalable opposé aux islamistes et que nous formulions en tant que rejet de l’amalgame entre islam et politique, dissimulait un problème de forme qu’il fallait affronter et qui n’était en fait qu’une exclusion masquée. Le principe démocratique dicte d’admettre la légitimité électorale des islamistes en vertu de leurs scores numériques même si les scores n’établissent pas leur foi démocratique. Les élections réalisées entre 2011 et 2014 lèvent le préalable de facto. Les partis islamiques, ainsi légitimés, sont alors tenus d’établir sans équivoque leur crédit démocratique : c’est alors que commence le processus endogène d’édification de l’ordre démocratique et que se posent les problèmes de fond. A ce titre, l’expérience tunisienne est fondamentale.
Ce déclic, réalisé entre le 1er mars et le 23 octobre 2011, n’est pas sans rapport avec les niveaux d’exclusion qui qualifient la scène arabe et qui trahissent la rigidité de la société politique arabe. Cette rigidité est à la base d’une régression typique qui génère l’immobilisme, l’exil, la violence… et qui fournit un alibi à la dictature. Ce sont des niveaux d’exclusion plus ou moins amples, plus ou moins violents, mais également illégitimes. Ce déclic était porté par la Révolution de janvier 2011, c’est l’un de ses mérites historiques.
2- Est-il vrai que l’enjeu démocratique soit aujourd’hui marginal ? Il est vrai qu’avant la conquête de l’Etat indépendant, l’enjeu primordial est l’indépendance et la souveraineté. Telle est la logique de la lutte existentielle. Après la conquête de l’indépendance et de la souveraineté, les valeurs de liberté, de justice et d’égalité, inhérentes aux droits de l’homme, sont inséparables de la compétition politique légitime. La mission essentielle de l’Etat est de promouvoir et de préserver ces valeurs garantes de l’ordre démocratique. La négation de ces valeurs substitue la violence à la compétition politique : ainsi se constitue l’ordre despotique. L’Etat est fort quand il s’acquitte de cette mission, il s’affaiblit en manquant à cette mission. Il n’y a pas de contradiction entre démocratie et Etat fort.
Au Machrek, l’état de guerre larvée induit par l’effraction israélienne peut justifier, pour les Etats voisins d’Israël, la prorogation de la lutte existentielle au-delà de l’indépendance. Ce dilemme ne se justifie pas au Maghreb. Bien au contraire, il pose la légitimité de la révolution démocratique.
3- La Tunisie, isolée dans sa région, n’est pas isolée dans le monde. La communauté des Etats démocratiques se reconnaît dans le choix de la Tunisie. La Tunisie sert la cause du Maghreb et du monde arabe plus sûrement au moyen de valeurs partagées qu’au moyen de valeurs militaires ou de moyens financiers qui, à eux seuls, ont révélé leurs limites. Le prix Nobel proclamé le 9 octobre valide le rattachement de la Tunisie aux valeurs qui font la civilisation de notre temps. Isolée dans sa région, la Tunisie n’est pas isolée dans le monde, elle n’a pas manqué sa Révolution.
Ahmed Ounaïes
Communication présentée à la tribune du Cercle Kheireddine, à Tunis, le samedi 10 octobre 2015