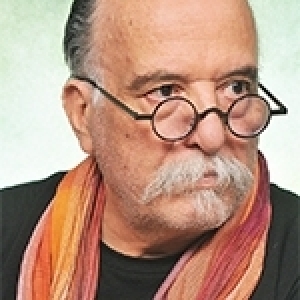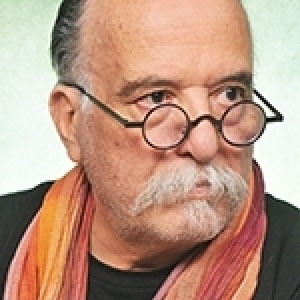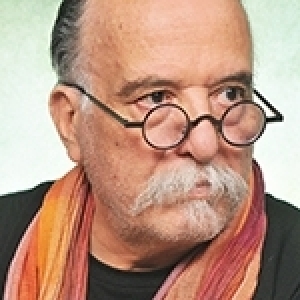La politique extérieure tunisienne sous l'emprise de la dualité
La Révolution tunisienne pose la centralité de la question démocratique dans le monde arabe. Sa portée géopolitique inquiète l’establishment tandis qu’elle recentre les stratégies du voisinage et des puissances mondiales. La lutte est vive pour faire du processus démocratique une force irréversible sur ce théâtre.
Au tournant du siècle, l’aspiration démocratique est aussi prégnante au Maghreb qu’au Machrek ou dans le Golfe. Mais la poussée et l’enracinement de l’exigence démocratique sont variables. En Tunisie, la dynamique est lancée en décembre 2010. D’essence populaire, sans leadership et sans hiérarchie, elle a pu s’étendre et gagner en force au point de submerger le pouvoir en place. La transition, aussitôt relayée par des dirigeants acquis à la démocratie, franchit une étape cruciale en organisant des élections et en instaurant une Assemblée élue. L’émergence tardive du parti islamiste a brisé cet élan et tenté d’insérer une axiologie religieuse et régressive étrangère à l’inspiration de la révolution, sans réussir pour autant à supplanter l’exigence démocratique qui s’affirme toujours au sein de l’Assemblée et dans la sphère très large et très vigilante de la société civile. Le choc est de plus en plus violent entre les forces démocratiques et les forces soumises à la sphère islamiste.
En Egypte, les partis islamistes ont tôt fait de relayer la transition dès la chute du régime Moubarak. Le processus n’a pas tardé à dévier. En Libye, la transition est submergée par des forces fractionnistes : dès lors, la recherche de nouveaux équilibres dans l’Etat transcende la finalité démocratique. En Syrie, l’élan populaire né à Deraa en mars 2011 a pu s’étendre et défier peu à peu le pouvoir dans l’ensemble du pays sans revendiquer un leadership ni un appareil politique central. Le Conseil National formé à Istanbul en octobre 2011 et présidé par Borhane Ghalioun s’est empressé de poser l’objectif stratégique de la démocratisation. Or, la session du Conseil à Doha en novembre 2012 scelle la montée en puissance des forces islamistes et s’en tient à l’objectif d’éliminer le régime en place sans autre engagement substantiel. L’exigence démocratique est éclipsée.
Dans le champ arabe, l’alternative islamiste est en course pour supplanter l’exigence démocratique. A cette fin, la contre révolution use de l’influence directe, d’une manne financière incommensurable et de l’hégémonie nouvelle exercée sur la Ligue Arabe. Deux projets de société se disputent l’avenir de la Révolution. Cette dualité commande le destin de la région. Les deux flexions de la politique étrangère tunisienne en développent les portées respectives.
La Tunisie est entrée en 2011 dans la phase de transition démocratique. Au cours des deux premières années, la politique étrangère s’est distinguée par un contraste saisissant entre 2011 et 2012. Trois facteurs illustrent le contraste.
1. Au lendemain de la Révolution, notre politique extérieure se fonde essentiellement sur l’accession à la communauté des Etats démocratiques, ce fait nouveau étant l’élément distinctif de la percée tunisienne. Le gouvernement de transition donne acte de la mutation démocratique par le fait des mesures prises aussitôt sur le plan intérieur. Il libère les prisonniers politiques, ouvre la voie aux tunisiens en exil pour retourner librement dans le pays, lève la censure, garantit l’indépendance et le pluralisme des médias, libère la formation des partis politiques, élimine toute restriction contre la société civile et les institutions vouées à la défense des droits de l’homme, invite officiellement les Institutions internationales à suivre et observer les phases d’organisation et de déroulement des élections et adhère à plusieurs Conventions et Traités de portée humanitaire, notamment le Statut de Rome relatif à la Cour Pénale Internationale.
Le gouvernement organise l’échéance électorale dans un esprit de consensus. Il installe une Instance Supérieure indépendante pour veiller au déroulement des élections, promulgue une loi électorale consensuelle et entoure la campagne électorale des garanties de liberté et de sécurité permettant l’authentique compétition, sans harcèlement, sans risque, sans restriction.
Sur cette base, l’année 2011 a hissé le crédit de la Tunisie aux sommets de la politique mondiale. En revanche, le gouvernement entré en fonction en janvier 2012 met un frein à cette dynamique : il se montre fuyant sur le fond de l’engagement démocratique et se dérobe aux impératifs de la transition : la fixation du calendrier électoral, l’adoption de la Constitution, la loi électorale, les garanties de liberté et de sécurité, la libre activité des partis politiques. Les médias, les universités, les syndicats et les institutions de la société civile sont ouvertement harcelés. Le contraste est net.
2. Au cours de l’année 2011, le gouvernement de transition expose en toute clarté son projet politique : instaurer un ordre pluraliste fondé sur le respect des libertés ; développer les acquis relatifs au statut de la femme, notamment l’égalité en droit et la parité dans les élections ; responsabiliser la société civile ; assurer la culture de la tolérance, l’esprit d’ouverture, l’admission des droits de l’homme sans réserve et sans restriction. L’Etat communique la certitude de franchir le seuil démocratique. L’engagement, absolument souverain, est compris et soutenu par nos principaux partenaires et par les puissances mondiales acquises à nos idéaux. De ce fait, le projet tunisien prend une signification plus large dans la géopolitique arabe. L’issue de la transition tunisienne acquiert une portée stratégique.
Le gouvernement de coalition jette le doute sur ce projet, non pas tant en paroles car son discours politique est équivoque, mais en acte. Les initiatives de la Troïka mettent en cause l’engagement fondamental et contestent le référentiel philosophique et juridique qui fonde le projet politique. D’autres faits s’ajoutent qui noircissent le tableau : l’attaque calculée de l’Ambassade des Etats-Unis, la violence politique qui franchit la limite de l’assassinat. Où va la Tunisie ? Est-ce un procès de rupture ? Tient-elle le cap vers la finalité démocratique ? Nul ne voit clair. La confusion altère l’élan de confiance de nos partenaires. La Troïka manque d’établir le lien entre la clarté du projet politique et l’engagement international.
3. Le troisième facteur tient à l’emprise des politiques partisanes dans les plus hautes sphères de l’Etat. En 2011, le gouvernement soutenait fermement que la phase de transition n’admettait pas d’interférence partisane. Il s’astreignait par principe à la logique consensuelle et veillait à tenir la politique de transition au-dessus des partis. Le gouvernement de la Troïka réduit d’emblée les institutions de l’Etat à des lots assignés aux partis. Des politiques cloisonnées conduisent à des contradictions étalées devant l’opinion. Le choix partisan prévaut sur le principe d’unité du gouvernement et sur le consensus national. Les explications fournies douze mois plus tard par le Premier Ministre sortant, M. Hamadi Jebali, lors de l’effort tardif du remaniement, lèvent une part du voile sur les interférences partisanes qui ont brouillé la politique de transition et freiné sa progression. Ces incohérences jettent le doute sur les objectifs de la diplomatie tunisienne.
De surcroît, des lacunes structurelles et des défaillances de méthode aggravent les contradictions et aboutissent à des échecs et des reculs pourtant évitables. En outre, des déclarations malencontreuses, des comportements individuels et opportunistes, commis par tel ou tel dignitaire, frappent le crédit du gouvernement et ternissent l’image de l’Etat.
Lorsqu’en janvier 2012 le gouvernement de la Troïka entrait en fonction, notre politique étrangère jouissait de la confiance des puissances mondiales et d’un crédit élevé auprès de nos partenaires. Tandis que la scène arabe entrait en ébullition et entraînait le sahel africain, la Tunisie se dotait d’une Assemblée démocratiquement élue et d’un gouvernement appelé à achever en douze mois l’agenda de la transition. A cette date, l’image de la Tunisie, hissée par la Révolution, remontait du fond du gouffre. L’action du Premier Ministre Caïd Essebsi la portait à son zénith.
Plus au fond, la Tunisie représentait une démocratie en gestation, portée par sa volonté intrinsèque, par son dynamisme historique, par son génie propre. L’émergence en Tunisie de la première société arabe démocratique allait constituer un Etat pivot dans la géopolitique du Maghreb et du monde arabe. Les plus hautes autorités politiques d’Europe et d’Amérique défilaient dans notre capitale et prenaient la mesure de la mutation qui semblait s’inscrire dans le nouvel ordre régional qui prenait corps depuis vingt ans. La politique étrangère portait cette haute mission.
La question se pose : en prenant en charge ce portefeuille, le gouvernement de la Troïka réalisait-il la portée de la mission ? De toute évidence, il n’en avait pas pris la mesure. Les membres de la Troïka ont manqué d’assumer une vision de la Tunisie à ce moment critique de son évolution, à ce tournant de la géopolitique régionale, à cette phase de fluidité générale de l’ordre global. Ils n’ont guère formé une politique unifiée, ni posé des objectifs communs, ni manifesté une démarche cohérente. Les dossiers majeurs de politique étrangère trahissent le poids des contradictions.
Le Grand Maghreb
C’est au sein du Grand Maghreb que la Tunisie ambitionne de situer son action politique et d’illustrer sa vision de l’avenir. Trois moments ont marqué notre action sur ce théâtre. S’il est vrai que Kadhafi et les services libyens avaient menacé la Tunisie dès janvier 2011, le gouvernement de transition s’était abstenu de tout esprit de représailles. L’épreuve imposée au peuple libyen dès le mois de mars était partagée fraternellement par la Tunisie. L’accueil, les soins et l’assistance aux réfugiés de tous bords étaient assurés sans réserve. C’est en Tunisie que les adversaires libyens pouvaient dialoguer en confiance, étant assurés que le gouvernement favorisait toute formule de règlement qui évite l’affrontement armé et qui écarte les interférences extérieures. Cette position de principe a prévalu jusqu’au bout.
La controverse soulevée par la demande d’exil politique de Baghdadi Mahmoudi, dernier Premier Ministre du régime Kadhafi, était une épreuve pour le gouvernement de la Troïka. Le 24 juin 2012, le chef du gouvernement livre subrepticement le réfugié politique contre l’avis formel du Président de la République. Décision politique ? A notre sens, l’acte est d’essence morale. A cette date, les circonstances ignominieuses de l’élimination de Kadhafi étaient connues. Un tel forfait n’autorisait aucune faiblesse, a fortiori pour un gouvernement né au berceau de la Révolution et qui sait le prix de la dignité humaine.
Le précédent était créé en 1971 par Kadhafi lui même qui croyait alors servir le Président du Soudan, Jaafar Nimeiry, parvenu au pouvoir comme lui par un coup d’Etat en 1969. Le général Nimeiry venait d’être ébranlé par un nouveau coup d’Etat le 19 juillet 1971. Le Colonel Kadhafi fait détourner l’avion britannique qui transportait vers Londres les deux auteurs du coup, Abdel Khaleq Mahjoub, Secrétaire Général du Parti Communiste Soudanais et le Colonel Major Hachem Atta. Ils sont saisis dans l’avion et livrés à Nimeiry qui les fait pendre. Le précédent était resté isolé jusqu’en juin 2012 quand le chef du gouvernement tunisien, Hamadi Jebali, prend la responsabilité de renouveler un tel acte en dépit des oppositions très fermes au sein même de la coalition au pouvoir.
Rappelons qu’en décembre 1967, la Tunisie avait accueilli Tahar Zbiri, chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne, puis en août 1975 Omar Mehichi, membre du Conseil de la Révolution libyenne. Tous deux avaient fui leur pays pour des raisons politiques. Ils n’avaient jamais été inquiétés jusqu’à leur départ volontaire pour des destinations de leur choix. L’Algérie à son tour avait accueilli des réfugiés politiques tunisiens, Ahmed Ben Salah et Mohamed Mzali, qui y étaient en sûreté jusqu’à leur départ pour des destinations en Europe. Le Maroc avait aussi accueilli en mars 2012 Abdallah Senoussi, ancien chef des Services de sécurité de Kadhafi et lui avait garanti la sécurité jusqu’à son départ le 17 mars pour la Mauritanie.
De juin 2012 à mars 2013, la Tunisie, la Mauritanie et l’Egypte ont livré tour à tour des réfugiés politiques libyens . Ni le droit ni la loi de l’honneur ne justifiaient une telle faiblesse. La vive polémique qui, à Tunis, opposa le Président provisoire au Chef du gouvernement provisoire sur le principe de la livraison frappe certes le crédit de la Troïka, mais du moins marque-t-elle le sursaut moral qui, du fond de la nation, traduit l’attachement aux valeurs.
L’initiative avortée de relancer l’Union du Maghreb Arabe trahit un échec d’un autre ordre. L’initiative du Président Marzouki relative au Grand Maghreb est double : d’une part, l’organisation d’un sommet de l’UMA au cours de l’année 2012 et, d’autre part, l’institution des cinq libertés dans les rapports entre les Etats membres, s’agissant des libertés de circulation, de résidence, de travail, d’investissement et de vote aux élections municipales. A tous égards, l’initiative doit être saluée dans son inspiration, sa pertinence et sa force. Dans de tels cas, cependant, les consultations préalables font partie intégrante de la démarche ; elles permettent de cerner les réserves des partenaires et la marge d’action indispensable pour les surmonter. Révéler la date du Sommet avant même l’accord des participants, décider unilatéralement la mise en œuvre des mesures souhaitées, aussi généreuses soient-elles, compliquent l’action diplomatique. La surconfiance trahit la méconnaissance du dossier. Du reste, le souci de méthode est une garantie de responsabilité, de respect des partenaires et de maturité. En définitive, la précipitation et l’improvisation achèvent de vider l’initiative de sa substance. Son échec n’a fait qu’exacerber la contradiction au sein de la Troïka sans faire avancer la cause du Grand Maghreb.
Le Moyen-Orient
Le brusque recentrage de notre politique extérieure sur les crises du Moyen-Orient a jeté la Tunisie dans un champ miné. L’interférence dans les conflits inter palestiniens et inter syriens ne saurait servir l’intérêt supérieur des peuples concernés. Ces conflits doivent être surmontés par le dialogue national et par la médiation mûrement élaborée. Les pays du front portent une responsabilité supérieure, ayant des leviers d’action directe sur les acteurs. C’est dans l’effort de conciliation et dans la recherche d’un règlement politique que la Tunisie peut soutenir un engagement substantiel au Moyen-Orient. Telle est la ligne classique de la diplomatie tunisienne. Dans le passé, l’Egypte nassérienne et la Jamahirya libyenne s’étaient impliquées dans les conflits internes du Yémen et du Liban en prenant parti au profit des uns contre les autres, au nom de convictions révolutionnaires ; elles n’ont fait qu’aggraver les drames nationaux sans jamais réussir à mûrir un règlement durable lequel, en revanche, était élaboré par des efforts de médiation associant les pays voisins.
Du reste, les campagnes occidentales hostiles ciblant sélectivement Hamas, Hezbollah, l’Iran et la Syrie ne sont pas fortuites : un jeu second s’intensifie au Machrek, en écho aux révolutions en cours au Maghreb. Peut-on, dans ce contexte, isoler l’enjeu syrien ? Le drame syrien s’inscrit dans le système de conflits qui mine la région et dont la clef est le non règlement de la question palestinienne. L’enjeu syrien tient essentiellement à l’unité de la cause fondamentale, celle de la libération des territoires et de l’indépendance de la Palestine. L’enjeu démocratique n’est pas nécessairement inconciliable mais, s’agissant du Machrek, il est loin de prévaloir sur l’enjeu fondamental. Les puissances actives sur ce théâtre y veillent.
La Tunisie ne s’est jamais dérobée aux causes justes. L’accession à la communauté des Etats démocratiques lui confère une responsabilité nouvelle pour le progrès de la démocratie dans le monde. L’engagement repose sur la solidarité des pays acquis aux valeurs démocratiques et voués à la défense des droits des peuples sans calcul et sans compromis.
Par delà les enjeux globaux du Machrek arabe, deux impératifs définissent l’intérêt national syrien : l’accession à la démocratie et la récupération du Golan. Or, au lendemain du sursaut populaire de mars 2011, l’offensive militarisée lancée contre la Syrie obéit davantage à une logique de changement de régime qu’à une stratégie de démocratisation et de libération nationale. D’une part, l’alliance hétéroclite associant des pays arabes, européens et américains et qui se définit comme les Amis du peuple syrien est divisée sur les questions essentielles, y compris la question démocratique, la question du Golan et le rôle des pays voisins. D’autre part, le Conseil National syrien à son tour est disparate, désuni sur la place de l’islam dans l’Etat, sur le statut des minorités et sur les valeurs démocratiques.
La Tunisie n’a pas à céder au jeu des factions locales, des rivalités régionales et des stratégies occidentales. Les combattants islamistes ne sont pas plus démocrates en Syrie qu’au Mali : pourquoi les puissances occidentales les soutiennent-ils contre Damas tandis qu’elles les exterminent aux confins de Tombouctou ? La solidarité apparente de ces puissances avec le peuple syrien va-t-elle jusqu’à la restitution du Golan ? Ces puissances détiennent les clefs du règlement fondamental au Moyen-Orient : pourquoi tiennent-elles à bloquer indéfiniment le règlement ? Le jeu des puissances occidentales ne fait que brouiller les cartes, relancer et perpétuer le chaos et ruiner militairement le Machrek sous tous les prétextes.
Quand les nouveaux dirigeants tunisiens ont déclaré le 4 février 2012 avoir chassé l’Ambassadeur de Syrie, ils n’ont pas seulement heurté un principe constant de la pratique diplomatique tunisienne, ils ont précipité le pays dans un grand jeu dont les fils leur échappent. Sans doute font-ils crédit à des alliés arabes de conjoncture d’exercer une certaine emprise sur le conflit syrien justifiant ainsi non seulement leur zèle diplomatique, mais le service nouveau qu’ils leur prêtent de jeter la jeunesse tunisienne dans les guerres islamistes en Syrie et au Mali. Si ces alliés étaient acquis à l’enjeu démocratique, la transition démocratique tunisienne n’est pas moins pressante. L’engagement sélectif de ces alliés de conjoncture au profit des factions islamistes indique assez la stratégie subtile de détournement tentée en Tunisie et en Egypte, tandis qu’elle se matérialise brutalement sur le front syrien.
C’est sous les mêmes influences que notre diplomatie s’était impliquée en 2012, pour la première fois, dans le jeu des factions palestiniennes. Jamais auparavant la politique tunisienne n’avait trempé dans des manœuvres fractionnistes. La netteté de notre politique palestinienne est aujourd’hui entachée à son tour.
C’est dans un élan d’ivresse révolutionnaire que les dirigeants tunisiens s’étaient impliqués en 2012 dans la cause syrienne. Si aujourd’hui une fuite en avant les emporte dans un jeu de factions, il faut prendre garde que la superposition de deux stratégies insidieuses ne les entraîne dans une aventure de détournement de la révolution arabe et de noyautage catastrophique de la cause syrienne. Avec les factions islamiques aux commandes, l’avenir des peuples syrien et égyptien n’est pas plus à l’abri que la révolution démocratique tunisienne.
L’Europe
Pour la Tunisie, le lien à l’Europe se fonde sur trois facteurs. D’une part, le soutien ferme et profond à la révolution démocratique tunisienne et qui se maintient en dépit des fluctuations politiques. D’autre part, le poids des intérêts réciproques qui dépasse les engagements avec d’autres partenaires proches ou lointains, y compris sur le plan de la sécurité. Enfin, le poids de l’Europe dans l’avenir de la région. Autant pour les valeurs de civilisation que pour le développement, la sécurité et la paix, le lien à l’Europe est stratégique.
L’Europe mesure la portée du péril islamiste. Le précédent algérien tout au long des années 1990, les prises d’otages ciblant les européens et la présente crise du Mali forment une conscience politique commune en parfaite convergence avec nos intérêts. Les déclarations relatives à la transition démocratique tunisienne font la part des engagements positifs pris par notre diplomatie en 2011 et des atermoiements qui freinent nos progrès en 2012.
Deux réserves entachent cependant la netteté de la politique de l’Europe. Elles tiennent à sa dualité relativement à la scène arabe.
L’alliance bridée avec les islamistes n’est pas claire. Que cache le scrupule de non livraison des armes à la résistance syrienne ? L’entente ne répond guère à un souci de construction démocratique ou de libération nationale, mais à briser de l’intérieur le pilier syrien et à atteindre la capacité stratégique du pays. L’engagement aux côtés de la résistance participe davantage de la stratégie de démantèlement du front radical anti israélien qu’il ne vise la finalité démocratique. L’Europe saisit l’occasion de la Révolution pour pousser en Syrie la logique des guerres israéliennes de 2006 contre le Liban et de 2009-2010 contre Gaza, et de la politique de barrage contre l’accession de l’Iran à la technologie avancée en matière nucléaire ou balistique. Après l’Irak, l’effondrement de la Syrie ferait place nette au Machrek. Par ailleurs, l’alliance avec les pays arabes du Golfe est strictement ponctuelle : au-delà du chaos en Syrie, chacun poursuivra ses calculs.
Quelle vision guide l’Europe dans la région ?
S’il est vrai qu’entre octobre 2011 à l’UNESCO et novembre 2012 à l’Assemblée Générale des NU, l’Europe abonde décisivement en faveur de l’Etat palestinien , elle s’en tient pour autant à une dualité qui fait toujours du Moyen-Orient une zone de non droit, de non égalité et de non démocratie. La même politique qualifie Israël de pays démocratique en omettant qu’Israël pratique la discrimination contre les non juifs non seulement dans les territoires occupés mais en Israël même. Une telle politique, impensable en Europe, n’est jamais dénoncée : déni démocratique ! Négation des droits de l’homme ! Pour le peuple palestinien, l’acquis théorique du statut d’Etat ne compense pas la spoliation des droits politiques et territoriaux.
Que cache le stratagème européen ? L’effondrement arabe au Moyen-Orient, éventuellement complété par des frappes létales contre l’Iran, ménage-t-il le choc d’un fait accompli qui trancherait d’un coup le drame palestinien? L’Europe serait-elle complice pour imposer, à la faveur du chaos, une entité résiduelle, qualifiée d’Etat palestinien et spoliée de tels territoires qu’Israël choisit de s’approprier ? L’engagement de l’Europe au Moyen-Orient est équivoque. Son entente avec les groupes islamistes est paradoxale. Son alliance avec les pays arabes du Golfe est obscure. Dans le sillage d’une alliance indécise, le gouvernement de coalition tunisien souscrit, sur ce théâtre, à une aventure périlleuse.
Les Etats-Unis
Le rôle des Etats-Unis éclaire la démarche générale des puissances occidentales. Les Etats-Unis, en ‘‘guerre totale’’ contre l’islam extrémiste depuis plus de dix ans, n’a remporté aucune victoire décisive contre l’ennemi. Les ouvertures tardives au Mouvement Taliban étaient rejetées avec dédain. Nulle part en pays d’islam, Somalie, Afghanistan ou Irak, les troupes n’ont achevé la mission : elles se sont repliées sur un compromis de façade.
A son tour, l’islam extrémiste se pose en ennemi des régimes arabes et des puissances occidentales complices de ces régimes. Le dilemme n’est surmontable qu’au prix de la conciliation de l’islam politique avec la terre d’islam. Un tel compromis est concevable entre les sociétés mères elles mêmes, notamment les pays arabes, et les partis islamistes qui se prévaudraient d’une stratégie positive de réappropriation. Les partis islamistes qui acceptent les règles démocratiques, la politique de modération et la légitimité électorale devraient être habilités à prendre part aux responsabilités politiques dans leurs pays sans restriction, sans exclusive. Pour leur part, les dirigeants islamistes, dans l’exil qui les a tenus longtemps tributaires des pays occidentaux, ont saisi les mécanismes de l’ordre démocratique et assimilé sa rhétorique. Ils jouent le jeu.
Dans ce compromis, le rôle des puissances extérieures est tout juste facilitateur. L’Occident en particulier ne saurait être partie prenante dans l’épreuve de conciliation des sociétés arabes avec les islamistes fruits de leur politique, de leur culture et de la conceptualisation erratique du lien communautaire. En vertu du compromis, les islamistes cesseraient d’être parias ; ils seraient réintégrés, admis comme acteurs et producteurs de la vie politique à l’égal des autres. Le dilemme est d’élaborer, dans chaque pays, le cadre national acceptable par l’ensemble des forces politiques, de convenir des principes communs et de souscrire aux mêmes règles d’arbitrage et d’ajustement des conflits. Les crises internes ne devraient pas déborder en Occident ni provoquer une quelconque interférence de l’Occident.
Tel est le compromis posé par les Etats-Unis avec l’islam politique. Sans renoncer à la lutte contre l’extrémisme, ils ménagent pour les partis islamistes la voie de l’action politique responsable dans un cadre démocratique, moyennant l’admission du pluralisme, l’interaction avec les autres forces politiques, la quête de la légitimité par le suffrage populaire et le renoncement à la violence. La responsabilisation induit par elle-même le sens de la mesure et de l’auto régulation. Certes, l’islam politique doit sacrifier la légitimité transcendantale qui fonde le message supérieur dont il s’estime porteur, et admettre de passer par l’épreuve de la compétition électorale et du mérite comparatif. La légitimité politique est à ce prix. Du moins, le compromis a-t-il le mérite de surmonter la fracture politique typique des sociétés arabes et qui génère indéfiniment l’extrémisme et la violence. Le compromis ouvre la voie à une dialectique capable de générer des vertus d’intégration et des modèles communautaires consensuels. La société arabe démocratique se construira empiriquement. Pour n’avoir pas tenté une telle expérience, les sociétés arabes se sont privées de la faculté de créer des valeurs politiques modernes et des progrès politiques propres à la civilisation de l’islam. Ce compromis est-il crédible ? Les expériences lancées au Maroc, en Egypte et en Tunisie sont autant de variables.
Le compromis vient à point pour les pays du Golfe qui, pour leur part, redoutent l’enracinement de la démocratie dans l’aire arabe. Ils ménagent donc l’alternative islamique en un amalgame subtil de la forme et du fond : mécanisme démocratique, contenu islamique. Une convergence tactique unit ainsi trois pôles : Etats-Unis, pays du Golfe et partis islamistes. Les premières élections offrent aux islamistes la conquête de la légitimité. Portés au pouvoir, ils découvrent la démocratie : lutte perpétuelle, épreuve de gestion, de compétence, de talent. L’arène est implacable : ils réalisent la portée de l’enjeu et font des concessions en réponse à la réactivité des partis, au harcèlement populaire et à la vigilance des médias. La dialectique est en marche.
La valeur de ce tournant historique ne tient pas à l’esthétique du compromis mais à l’évaluation de la performance. En Tunisie, l’année 2012 était l’épreuve inaugurale. Les Etats-Unis réalisent les premiers échecs à la mesure des politiques d’obstruction du parti Nahdha et de la montée de l’insécurité qui s’élève jusqu’à l’attaque de l’Ambassade et jusqu’à l’assassinat politique. Les conclusions de Hamadi Jebali, Premier Ministre sortant, en janvier et février 2013, endossent l’échec. Cependant, les Etats-Unis et l’Europe relancent le jeu, ils admettent que la faculté de l’échec est inhérente à l’action politique et qu’il convient de donner au compromis historique le temps de l’ajustement et de la formation de ses propres assises. Ils se disent toutefois vigilants sur les garanties démocratiques, notamment la sécurité, le respect des libertés et la rigueur de la gestion électorale. Le levier de la coopération économique est subordonné à ces priorités.
Il est clair que la stratégie américaine obéit au double souci de se délivrer de la charge de l’islam politique et de promouvoir au sein du monde arabe une culture démocratique inclusive, en réponse aux contradictions insurmontables des régimes obsolètes, à l’appel de l’intelligentsia arabe elle-même et à la sociologie arabe spécifique où l’islam est prégnant. Cette stratégie, conduite en tandem avec la Grande Bretagne, dicte des changements de régime radicaux au Maghreb et au Machrek. Parallèlement, la centralité israélienne dicte sa propre logique et détermine la dualité fondamentale de la politique occidentale.
Conclusion
1- La coalition qui forme le gouvernement en 2012 est dépourvue d’une vision claire de politique extérieure parce que son projet, à la base, est indécis. Le parti Nahdha a-t-il foi dans la démocratie ? Nul n’en répond.
2- Le contraste est net dans la perception internationale de la transition tunisienne : en 2011, une stratégie de conquête démocratique ; en 2012, une politique partisane de détournement de la Révolution et de prédétermination idéologique.
3- Chez nos principaux partenaires, la finalité de la transition est éclatée. Pour les Etats-Unis, elle vise la résorption de l’islam politique à n’importe quel prix ; pour les pays du Golfe, elle doit être détournée vers l’instauration de l’ordre islamique ; pour l’Europe, la finalité démocratique doit prévaloir au Maghreb au prix d’un processus nécessairement long et tourmenté, tandis que les priorités sont radicalement différentes au Machrek et dans le Golfe. Ainsi, les atermoiements et les échecs diplomatiques du gouvernement de coalition tiennent à la fois à l’indécision fondamentale de la Troïka et aux tiraillements de nos partenaires majeurs.
Ahmed Ounaïes, Tunis, 12 avril 2013
- Ecrire un commentaire
- Commenter

Cher M. Ounaïes, Excellent article, Monsieur, qui répond à mes interrogations les plus inquiètes : pourquoi avoir livré M. Mahmoudi, la suffisance des intégristes, la Tunisie devenue un bâteau ivre qui tangue, l'absence de visibilité électorale, les chausse-trappes pour éloigner les vrais républicains. Puisse votre propos réveiller les consciences, pour que notre pays connaisse la démocratie, la dignité et la croissance économique. Amicalement.

Habib Ofakhri L’auteur de l’analyse fait partie de l’école bourguibienne pragmatique et rationnelle. A son honneur et à celui de notre pays qui continue à enfanter des hommes et des femmes doués d’intelligence et de sensibilité ; qualités qui devraient –en principe-guider les pas de dirigeants ou des aspirants à la direction politique. Toutefois il semble que faute d’être bien compris par les siens ; m.ounaies s’adonne à chaque intervention à une forme « d’autopromotion diplomatique ». Par delà cette constatation qu’il me permette de faire une observation et de poser une question : a- Observation : Le projet du Maghreb a été trahi par les dirigeants post indépendance .l’initiative dite de 5 libertés du président tunisien 3m aura eu le mérite de rattraper le temps perdu et de susciter une dynamique qui aurait permis à la région de sortir de sa léthargie.il faut rêvasser ! b- Question La Tunisie -et je vous cite- « ne s’est jamais dérobée aux causes justes » et s’est engagée « à la défense des droits des peuples sans calcul et sans compromis » . Alors - estimez –vous que la cause du peuple sahraoui dominé par le maghzen alouite est une cause juste.et si tel en est le cas pourquoi ce même maghzen se dérobe t il au droit international et à l’aspiration pacifique à la liberté et à la dignité de ce peuple.pis la diplomatie tunisienne ne s’est jamais rangée à son cote...