Fous de Mathématiques?(1) Alexandre Groethendieck et quelques autres

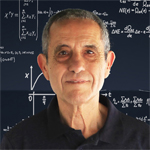 Par Mohamed Jaoua(2) - Lorsque Si Mohamed Ali Souissi – que je remercie chaleureusement pour sa confiance et son mot d’introduction qui m’a fait rougir – m’a invité à donner cette conférence devant cet impressionnant parterre, mon premier mouvement a été de décliner. Comme tout mathématicien, je connaissais évidemment le nom d’Alexandre Grothendieck et avais entendu parler du caractère excentrique du personnage. Mais je ne connaissais et ne connais encore rien de ses mathématiques, sinon qu’elles étaient exceptionnelles. Il a en effet refondé, notamment dans le cadre du groupe Bourbaki qui s’en était fait mission pour l’ensemble de « la » mathématique, la géométrie algébrique qui constituait l’aristocratie des mathématiques françaises. Laurent Schwartz, qui dirigea avec Alexandre Dieudonné sa thèse de doctorat, écrit de lui dans ses mémoires(3) que ce fut la plus belle de « ses » thèses, qui fit de Grothendieck le maître incontesté des espaces vectoriels topologiques, que lui-même y apprit quantité de choses et qu’il lui fallut six mois de travail à temps plein pour la lire et la comprendre. Il écrit également que plus tard, il ne tarda pas à changer de sujet au contact du séminaire Cartan, et qu’il « renouvela et transforma complètement – avec les outils modernes des années soixante - la géométrie algébrique (et que) pour ces travaux sensationnels, on lui décerna la médaille Fields en 1966 ».
Par Mohamed Jaoua(2) - Lorsque Si Mohamed Ali Souissi – que je remercie chaleureusement pour sa confiance et son mot d’introduction qui m’a fait rougir – m’a invité à donner cette conférence devant cet impressionnant parterre, mon premier mouvement a été de décliner. Comme tout mathématicien, je connaissais évidemment le nom d’Alexandre Grothendieck et avais entendu parler du caractère excentrique du personnage. Mais je ne connaissais et ne connais encore rien de ses mathématiques, sinon qu’elles étaient exceptionnelles. Il a en effet refondé, notamment dans le cadre du groupe Bourbaki qui s’en était fait mission pour l’ensemble de « la » mathématique, la géométrie algébrique qui constituait l’aristocratie des mathématiques françaises. Laurent Schwartz, qui dirigea avec Alexandre Dieudonné sa thèse de doctorat, écrit de lui dans ses mémoires(3) que ce fut la plus belle de « ses » thèses, qui fit de Grothendieck le maître incontesté des espaces vectoriels topologiques, que lui-même y apprit quantité de choses et qu’il lui fallut six mois de travail à temps plein pour la lire et la comprendre. Il écrit également que plus tard, il ne tarda pas à changer de sujet au contact du séminaire Cartan, et qu’il « renouvela et transforma complètement – avec les outils modernes des années soixante - la géométrie algébrique (et que) pour ces travaux sensationnels, on lui décerna la médaille Fields en 1966 ».

Depuis les Egyptiens et les Grecs, la géométrie est reconnue comme la quintessence des mathématiques. Le célèbre « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre », qui était gravé nous dit-on à l’entrée de l’Académie de Platon, en témoigne. Pour Platon, la géométrie - au même titre que les autres branches des mathématiques - n’était cependant pas une fin en soi, mais plutôt un préalable destiné à tester et développer la capacité d'abstraction de l'étudiant, c'est-à-dire son aptitude à dépasser le stade des sensations qui nous maintiennent dans l'ordre du visible et du monde matériel pour s'élever jusqu'à celui de l'intelligible pur. Les figures géométriques et au delà tous les objets mathématiques représentent à cet égard des objets désincarnés et essentialisés du réel, des figures de la pensée pure et du monde des concepts qui peuvent en rendre compte et l’expliquer. En paraphrasant Jean Jaurès(4), on pourrait affirmer en somme que « un peu de théorie éloigne de la réalité, mais que beaucoup de théorie y ramène ». Quant aux autres mathématiques - l’algèbre et l’arithmétique notamment - plus techniques, les Grecs avaient volontiers recours à la géométrie pour y caractériser les solutions d’équations algébriques comme intersections de courbes ou de surfaces. Les mathématiciens arabes, après les Babyloniens et les Egyptiens, les Indiens aussi, s’y intéressèrent davantage. Le fameux « Kitab al jabr wal muqaballa » d’El Khawarizmi formalise quant à lui ce qu’on s’efforçait de faire depuis les babyloniens, c’est à dire de résoudre des équations en éliminant successivement des variables.
La géométrie algébrique va se situer à la confluence de ces deux branches des mathématiques. Les lycéens que nous avons tous été se souviennent de son ancêtre que fut la géométrie analytique. En se rapportant à un repère, une figure géométrique est caractérisée par une ou plusieurs équations algébriques, ce qui ouvre la porte du calcul pour résoudre des problèmes de géométrie. Grothendieck a consacré l’essentiel de son énergie et de son génie, entre 1958 et 1970, à refonder cette géométrie algébrique pour créer ce qu’il a appelé la géométrie arithmétique, fusion entre arithmétique, géométrie et topologie.
On comprendra donc que le soutier des mathématiques que je suis, le numéricien issu du monde de l’analyse et du calcul, le serviteur des mathématiques utilitaires et terre à terre en somme, ait pu éprouver quelques scrupules à franchir le seuil de cet autre monde auquel nul n’est censé avoir accès s’il n’est géomètre.
.jpg)
Si Mohamed Ali m’ayant rassuré à ce sujet, en m’invitant à traiter le sujet sous un angle plus large, où la spécialité ne serait pas le sujet compte tenu du public éclectique bien que fort éclairé qui serait le mien, je me suis hasardé à accepter. Et me voilà devant vous aujourd’hui, en espérant bénéficier de votre indulgence pour les raccourcis et les à-peu-près qui seront autant de voiles pudiques de mon ignorance, que des nécessités imposées par le voyage limité dans le temps comme dans l’univers de la connaissance qui est aujourd’hui le nôtre. Devant vous pour parler d’Alexandre Grothendieck, et de quelques autres fous de mathématiques, en partant de cette interrogation qui ne traverserait pas l’esprit du commun des mortels tant l’évidence de la réponse lui paraîtrait éclatante : les mathématiques rendent-elles fou ?
Alexandre Grothendieck, sa vie, son œuvre
Alexandre Grothendieck est né le 28 mars 1928 à Berlin. Son père, Sasha (Alexandre) Shapiro, anarchiste ukrainien qui fut emprisonné par le tsar puis sous le régime soviétique, rejoint Berlin en 1922 où il s’éprend de Hanka Groethendieck, issue d’une famille protestante immigrée des Pays Bas au 18ème siècle. Alexander naît de leurs amours adultérines – Hanka est alors mariée, elle divorcera en 1929 sans pour autant épouser Sacha – et porte d’abord le nom de son père « légitime ». Bien que Sacha le reconnaisse, Alexandre portera le nom de sa mère.
En 1933, l’arrivée d’Hitler au pouvoir contraint Sacha à fuir l’Allemagne pour la France où Hanka le rejoint en 1934, puis ils partent en 1936 vers l’Espagne afin d’y soutenir le mouvement anarcho-syndicaliste dans la guerre civile qui y faisait rage. Alexander est placé par sa mère dans la famille de Wilhelm Heydorn, un pasteur protestant anti-nazi installé près de Hambourg. En 1939 les Heydorn considèrent toutefois qu’il est trop dangereux pour un enfant ayant une « apparence juive» de rester auprès d’eux et demandent à ses parents de le reprendre. Alexander rejoint ses parents à Paris en mai 1939. Les retrouvailles sont néanmoins de courte durée : son père Sacha se retrouve interné en Ariège, et il mourra à Auschwitz en 1942 sans que sa famille l’ait revu. En 1940, Hanka et son fils sont emmenés au camp de Rieucros en Lozère, que le jeune Alexander est néanmoins autorisé à quitter pour aller étudier au lycée Chaptal à Mende. De 1942 à 1944, après le franchissement de la ligne de démarcation par les troupes allemandes, Alexandre est séparé de sa mère et caché dans une maison d'enfants du Secours suisse aux enfants. Il passe son baccalauréat à la fin de la guerre.
C’est l’époque où il retrouve sa mère pour s'installer avec elle près de Montpellier, où ils vivent modestement avec la bourse d'études d'Alexandre, des travaux saisonniers comme les vendanges, ou encore avec les ménages que fait sa mère. Il s’inscrit en mathématiques à l’université de Montpellier, dont il fréquente très peu les amphithéâtres, préférant travailler seul.
A vingt ans, le voilà à Paris où Henri Cartan ne tarde pas à l’orienter vers Laurent Schwartz et Alexandre Dieudonné à Nancy. Cette ville était alors le quartier général de l’analyse fonctionnelle et du groupe Bourbaki, qui avait pour ambition de refonder les mathématiques sur une base axiomatique avec un minimum d’hypothèses. Sous le nom de N. Bourbaki a été publiée une présentation cohérente des mathématiques, appuyée sur la notion de structure, dans une dizaine d'ouvrages ayant pour titres « Eléments de mathématique ». On notera le singulier, extrêmement emblématique de leur volonté d’unification d’une science alors éclatée. Ce qu’on a appelé les « mathématiques modernes » a fait souffrir des générations de lycéens par son aspect excessivement formel, conceptuel, son absence d’exemples, son rejet de certaines disciplines n’obéissant pas à la doxa telles que les probabilités. Pour autant, on doit à la vérité de dire que les Bourbaki ont été davantage victimes du zèle de sectateurs moins éclairés qu’ils ne l’étaient eux-mêmes, comme c’est le plus souvent la règle, que de leur volonté – inexistante - de réformer l’enseignement des mathématiques dans le second degré. Ils s’adressaient bien davantage aux mathématiciens eux-mêmes, de telle manière que les liens entre les diverses branches de leur discipline leur deviennent plus clairement visibles. Ecoutons à cet égard Laurent Schwartz, éminent bourbakiste s’il en fut, parler avec sa modestie et son humilité proverbiales, de l’introduction des limites inductives dans la construction de sa théorie des distributions : « C’est ce qui se produit souvent dans la découverte mathématique. On hésite à introduire une nouvelle classe d’objets parce qu’on n’a besoin que d’un seul d’entre eux, on hésite encore plus à lui donner un nom. C’est seulement plus tard, devant la répétition du même processus, que l’on introduit une classe et un nom, faisant faire un progrès substantiel aux mathématiques ». Cette prudence des grands n’a hélas pas été partagée par les inspecteurs de l’éducation nationale, qui se sont engouffrés avec l’enthousiasme excessif des disciples dans le prosélytisme sans mesurer que la manipulation intelligente des concepts doit être précédée de l’observation du concret qui y a conduit.
Grothendieck part donc à Nancy en 1951, et il n’y arrive pas les mains vides. Dans son bagage, un papier de 50 pages sur la généralisation de l’intégrale de Lebesgue aux fonctions à valeur dans un groupe topologique, qu’il présente à Dieudonné et Schwartz. « C’était exact, mais rigoureusement sans aucun intérêt », écrira Schwartz. Dieudonné lui passa quant à lui un savon mémorable en l’invitant à ne plus généraliser pour le seul plaisir de généraliser. Il faut certes, lui dit-il, que le problème traité soit difficile, mais qu’il soit aussi susceptible d’applications dans le reste des mathématiques ou dans d’autres sciences. Tout en reconnaissant dans ce travail le génie de Grothendieck, qu’ils vont se charger de « discipliner ». Ils décident de lui soumettre quatorze questions - sur lesquelles ils avaient « séché » - concernant les limites inductives que Schwartz avait introduites pour les besoins de sa théorie des distributions, en lui proposant de réfléchir sur celles de son choix. Quelques semaines plus tard, il en avait résolu la moitié et entame la publication de ses résultats. Ses mentors l’adoubent définitivement et Schwartz lui propose de travailler sur la détermination de la « bonne topologie » pour un produit tensoriel d’espaces localement convexes avant de s’envoler au Brésil au printemps 1952.
La topologie, c’est cette branche des mathématiques qui s’intéresse d’abord à la notion de continuité, et par voie de conséquence à celle de limite. Définir une topologie, c’est dire ce que sont les ouverts et les fermés (qui sont les complémentaires des ouverts), et donc définir la notion de frontière et de voisinage, mesurer la proximité et l’éloignement en somme. Tout espace peut être muni de plusieurs topologies, mais certaines d’entre elles sont plus intéressantes que d’autres, en ce qu’elles donnent à l’espace une structure dotée d’un ensemble de propriétés qui en font un objet d’études. Ainsi, dans l’ensemble des réels, on peut travailler avec la topologie « naturelle », celle issue de la métrique que nous connaissons (où la distance entre deux nombres est la valeur absolue de leur différence), mais aussi bien avec la métrique discrète qui postule que la distance entre deux points est zéro ou un selon que les points sont confondus ou non. La première permet de développer toute l’analyse réelle que nous connaissons, tandis que la seconde, très riche en ouverts puisque tous les sous-ensembles de R le sont, est en revanche très pauvre en ce qu’elle ne discerne pas les ouverts des fermés et la proximité de l’éloignement. Elle ne classifie donc pas et ne présente qu’une utilité anecdotique. Entre les deux, il existe toute une collection de topologies plus ou moins fines, plus ou moins utiles.
Grothendieck va faire preuve de toute sa virtuosité pour résoudre le problème qui lui est posé. Il trouve d’abord non pas une mais deux topologies ne conduisant pas aux mêmes propriétés, aucune des deux ne pouvant donc se prévaloir d’être « naturelle », ce qui est est un échec. Mais un échec qu’il va le dépasser « par le haut » quelques semaines plus tard, en prouvant que ces deux topologies sont équivalentes lorsque l’un des deux espaces du produit tensoriel est « nucléaire », inventant au passage pour les besoins de la cause une nouvelle classe d’espaces vectoriels topologiques. Et l’espace D’ des distributions est précisément nucléaire, ce qui boucle la boucle de la construction sophistiquée par le retour à la question posée. En quelques mois, à l’âge de vingt cinq ans, Grothendieck vient de se poser comme le maître incontesté des produits tensoriels d’espaces vectoriels topologiques.
Il établit en un temps record tous les théorèmes fondamentaux de sa nouvelle théorie et début 1953, sa thèse – dont Schwartz dira qu’elle fut la plus belle des « siennes », et qu’elle lui demanda plus de six mois de travail à plein temps pour la lire et la comprendre, était rédigée. Car en plus de son génie, Grothendieck avait aussi une puissance de travail phénoménale, avec un rythme biologique décalé et des journées de 25 à 27 heures.
J’ai eu le privilège de croiser dans ma déjà longue vie un mathématicien – et un seul, tunisien de surcroît ! - de cette étoffe. Il s’agit de Abbas Bahri, qui nous a quittés en janvier dernier à l’issue d’un long combat contre la maladie. Lui aussi avait cette culture mathématique encyclopédique qui permet de faire fi des frontières entre les spécialités. Pour sa thèse soutenue en 1981, il a convoqué les outils de la géométrie différentielle dans le calcul des variations, définissant pour cela la théorie très fructueuse des points critiques à l’infini. Sa capacité de travail n’avait d’égale que son génie. Comme celle de Grothendieck, sa thèse d’Etat fut expédiée en quelques mois, à la fin des années 70, alors qu’il sortait d’une longue période où il s’était donné corps et âme – après le 26 janvier 1978 – à la lutte politique en faveur de la liberté, notamment syndicale. Je me souviens de ces week-ends où il me rendait visite à Palaiseau, épuisé par de longues semaines de travail et quasiment sans sommeil, épuisé mais ravi tant il vivait et aimait les Maths, qui le lui rendaient si bien. Epuisé mais pressé d’y retourner, habité par sa mission, pressé par ce qui lui restait à faire, par la multitude de résultats qui attendaient qu’il les extirpe de leur gangue, à la manière d’un accoucheur, pour qu’ils puissent enfin lancer leur premier cri à la face du monde. Olivier Rey, l’un de ses élèves à l’X où il a enseigné, écrira joliment que « ce n’est pas tant lui qui parlait de mathématiques que les mathématiques qui s’exprimaient à travers lui, qui se frayaient un chemin vers l’expression ».
De 1953 à 1956, Grothendieck - qui refusait d’introduire une demande de nationalité qui eût imposé un passage par l’armée à l’antimilitariste qu’il était - part pour le Brésil et les USA. Seuls les français - et il était apatride - avaient en effet accès aux emplois de fonctionnaires, ce qu’étaient les professeurs des universités, alors que les chercheurs étaient contractuels. Durant ce séjour, il change de sujet de recherche pour se tourner vers la géométrie algébrique. Il revient en France en 1956 où il (ré)intègre le CNRS en qualité de Maître de Recherches. En 1958, s’ouvre la période la plus féconde de sa carrière. Il est accueilli dans le tout nouveau IHES qui voulait faire pendant à l’Institute of Advanced Studies de Princeton. Il y sera en bonne compagnie, celle de Dieudonné notamment, qui acceptera avec abnégation de lui servir de « scribe », celle de Jean-Pierre Serre – médaillé Fields 1954 – qui lui servira d’intermédiaire avec André Weil – fondateur du groupe Bourbaki auquel Grothendieck ne parlait plus, celle de son élève Pierre Deligne, médaillé Fields 1978, avec lequel il se brouillera aussi. Grothendieck est le chef d’orchestre et le maître à penser de cette formidable machine à produire des mathématiques exceptionnelles, son séminaire sera un instrument refondateur de la géométrie algébrique qui lui vaudra la médaille Fields en 1966. Médaille qu’il refusera d’aller recevoir à Moscou en protestation contre Budapest, et qu’il remettra ensuite aux Vietnamiens pour contribuer à leur guerre de résistance face aux bombardements américains.
En 1970, Grothendieck plaque tout cela en prétextant les crédits militaires que l’IHES recevait, pour se consacrer à la méditation. Tout en postulant à un poste de directeur de recherche au CNRS en précisant d’emblée qu’il n’en ferait pas, que la communauté mathématique lui accordera néanmoins en reconnaissance de l’immense œuvre accomplie. Reconnaissance qui n’a pas vraiment été payée de retour, Grothendieck écrivant de ses collègues : « La plupart des mathématiciens, je l’ai dit tantôt, sont portés à se cantonner dans un cadre conceptuel, dans un "Univers" fixé une bonne fois pour toutes - celui, essentiellement, qu’ils ont trouvé "tout fait" au moment où ils ont fait leurs études. Ils sont comme les héritiers d’une grande et belle maison toute installée, avec ses salles de séjour et ses cuisines et ses ateliers, et sa batterie de cuisine et un outillage à tout venant, avec lequel il y a, ma foi, de quoi cuisiner et bricoler. Comment cette maison s’est construite progressivement, au cours des générations, et comment et pourquoi ont été conçus et façonnés tels outils (et pas d’autres. . .), pourquoi les pièces sont agencées et aménagées de telle façon ici, et de telle autre là - voilà autant de questions que ces héritiers ne songeraient pas à se demander jamais. C’est ça "l’Univers", le "donné" dans lequel il faut vivre, un point c’est tout ! Quelque chose qui paraît grand (et on est loin, le plus souvent, d’avoir fait le tour de toutes ses pièces), mais familier en même temps, et surtout : immuable. »(5)
Les mathématiques rendent-elles fou ?
Ceci nous amène à la question titre de cette conférence : les mathématiques rendent-elles fous ? Encore faut-il préciser ce qu’on entend par cet adjectif. Dans l’acception courante, le fou est un être dénué de raison, un aliéné en somme. Pourtant, ce personnage a sa place dans toutes les civilisations, tant il semble nécessaire que quelqu’un se charge de dire ce qui n’est pas communément admis. Le fou du roi est à cet égard un bouffon qui divertit, mais dont Erasme souligne dans son « Eloge de la folie » le rôle de révélateur, de miroir grotesque de la réalité. Un rôle plus adapté aux hommes d'esprit qu'aux réels crétins, et tellement indispensable au prince qu’il est arrivé à plus d’un fou d’en être conseiller. François 1er créa même une école de fous, une sorte d’ENA avant l’heure en somme.
Le fou l’est d’abord par le contenu de son discours transgressif, inacceptable s’il venait d’un être « socialement intégré », même s’il est indispensable au maintien de cet ordre social grâce au regard critique et sans concession qu’il porte sur lui. La désocialisation du fou, son maintien dans une certaine marginalité, est alors la condition sine qua non de la reconnaissance de son altérité. Qays ne peut ainsi continuer à chanter son amour pour Leïla, aussi transgressif de l’ordre établi qu’indispensable à sa survie, car quelle société survivrait sans amour, qu’à la condition de s’en isoler en devenant « Majnoun ». Là où Roméo et Juliette choisiront quant à eux la mort.
Les prophètes ont eux aussi souvent été considérés comme des fous, en ce qu’ils brisaient la doxa fondatrice de l’ordre social établi. Des fous tolérés tant que leur contre doxa reste marginale, confidentielle, dédiée au seul usage du prince et de sa cour, des éclairés. Mais mis à mort sans hésitation, à l’image de Jésus ou d’Al Hallaj, dès lors que celle-ci prend de l’ampleur au point de menacer l’ordre social. A moins qu’ils ne parviennent à renverser celui-ci, à l’image de Mohamed, qui avait lui-même redouté d’avoir perdu la raison, d’être victime d’hallucinations, lors de ses premières révélations.
Le mathématicien présente à cet égard toutes les qualités pour occuper la place du fou. Son langage est hermétique au commun des mortels, car il parle de l’essence des choses et non de leur réalité perceptible, son discours porte sur le visible, sur le sensible, tout en se situant au delà du perceptible pour ne s’intéresser qu’à la construction qui l’ordonne et le structure. Comme le philosophe, comme le mystique soufi, il ne peut donc parler utilement qu’à ses pairs, aux initiés, à ceux qui peuvent le comprendre. Il se situe de facto en marge de la société où il vit, celle-ci l’habite plus qu’il ne l’habite, parce qu’il demeure en dehors de l’écume de ses codes, parce qu’il perce ses vérités et détruit ses mythes.
Et si on a rarement vu des mathématiciens sur les bûchers, ce n’est pas que leurs écrits n’en fussent pas passibles. On prête par exemple à Grigori Perelman, qui refusa la médaille Fields en 2006 et le prix Clay en 2010, pour sa démonstration de la conjecture de Poincaré, un des « sept problèmes du millénaire » recensés par ce dernier et dotés d’un million de dollars, cette explication des raisons de son attitude : « Pourquoi ai-je mis tant d'années pour résoudre la conjecture de Poincaré ? J'ai appris à détecter les vides. Avec mes collègues nous étudions les mécanismes visant à combler les vides sociaux et économiques. Les vides sont partout. On peut les détecter et cela donne beaucoup de possibilités… Je sais comment diriger l'Univers. Dites-moi alors, à quoi bon courir après un million de dollars ? »
Comme El Hallaj, Perelman proclame donc être la vérité, il est le maître de l’univers, il est Dieu lui-même. Comme Grothendieck, il méprise les institutions, et d’abord celles des mathématiques, il a quitté l’Institut Steklov pour vivre en ermite, il ne publie que parcimonieusement et en dehors des circuits établis.
Si cette singularité passablement hérétique n’émeut toutefois personne, c’est que – outre le fait que nous sommes au XXIème siècle, même si celui-ci est aussi celui du retour des religions – son public est réduit au petit nombre de ceux qui peuvent le comprendre. Il n’est pas subversif, là où Hallaj et Galilée – en portant l’estocade au cœur même de la doxa fondatrice de l’ordre social – pouvaient déstabiliser celui-ci.
Alors, pour peu que le mathématicien, le philosophe ou le mystique – et on ne s’étonnera pas à cet égard que Grothendieck ait délaissé les mathématiques pour se consacrer à la méditation – adopte une ou deux attitudes excentriques, Grothendieck avait par exemple coutume d’attacher son pantalon avec une cordelette plutôt qu’une ceinture, c’est mathématiquement le même objet, la même classe d’équivalence puisque leur fonction est en l’occurrence identique, et le voilà installé dans le rôle. Un rôle qui peut d’ailleurs le soulager en ce qu’il le libère de la servitude chronophage des convenances, alors qu’il a tant à faire par ailleurs. Beaucoup se souviendront à cet égard de Sidi Amor El Fayyache, qui recevait dans le plus simple appareil les femmes venues le solliciter dans sa zaouia, sans que la société tunisienne pourtant si prude ne songe à s’en offusquer. Majnoun quant à lui errait seul dans le désert, se nourrissant de ronces et s’habillant d’un rien, tout à sa poésie, tout à son amour pour Leïla dont même la présence eût nui à son amour pour elle : « Dis-lui de passer son chemin car Leïla m'empêcherait un instant de penser à l'amour de Leïla. », dit-il ainsi à un ami qui lui annonçait sa présence à sa porte. L’idée de Leïla plus importante que Leïla en somme.
Alors si les mathématiques rendent fous dans ce sens, elles ne sont pas – loin s’en faut – les seules. Car «il n'y a pas de génie sans un grain de folie», écrivait à ce sujet Aristote dans la Poétique. Et la longue litanie des cas célèbres, le syndrome d’Asperger dont souffrait Albert Einstein, la schizophrénie de John Nash, les hallucinations de Vincent Van Gogh ou de Goethe et les troubles bipolaires d’Ernest Hemingway ou de Virginia Wolf, semble lui donner raison. La thèse paraît plausible car la « folie » libère le cerveau de l’autocensure à laquelle le respect des convenances, de ce qui est licite et de ce qui ne l’est pas, l’astreint. Elle lui permet donc de penser plus large, sans tabous ni limites, « out of the box » comme on dit aujourd’hui, ce qui est la condition même de la créativité.
Même si énumérer n’est pas démontrer, et que de nombreux cas plaident pour la thèse contraire, comme celui d’Andrew Wiles qui démontra le théorème de Fermat, et qui échappa à la médaille Fields pour cause de limite d’âge – il obtint néanmoins le prix Abel - ou de Laurent Schwartz, il y a là quelque chose de troublant. Mais peu importe que cette assertion soit vraie ou fausse. Si elle l’est, elle vaut pour les mathématiciens comme pour les autres. Pourquoi donc cette faveur faite aux mathématiciens et aux mathématiques par l’opinion commune dans l’échelle de la folie ?
La tour d’ivoire infernale
Sans doute parce que les mathématiques, par essence difficilement intelligibles au commun, le sont devenues encore davantage du fait de la volonté des mathématiciens, heureux de se réfugier dans une tour d’ivoire les isolant du commun des mortels. Ce ne fut pas le fait des plus grands d’entre eux, dont c’est là la place naturelle, puisque la création est par essence solitaire. « Si riches soyons-nous, ce qui nous appauvrit c'est l'impuissance à être seuls », écrivait à cet égard Hölderlin. Mais bien plutôt de la masse des mathématiciens organiques en empruntant la typologie des intellectuels faite par Antonio Gramsci. L’illustration la plus éclatante a été cette folle généralisation de l’abstraction des « mathématiques modernes ». Celle-ci a certes certes été indispensable à l’unification au plus haut niveau des mathématiques, dont l’appareil conceptuel souffrait alors d’un encombrement de couches successives imparfaites et souvent contradictoires qui obérait les avancées qualitatives dont elles étaient grosses. Mais que cette abstraction fût portée jusqu’au collège par des inspecteurs de l’éducation nationale qui n’en maîtrisaient d’ailleurs qu’imparfaitement les concepts, mais à qui leur maîtrise apparente procurait l’illusion narcissique d’une proximité avec les plus grands !
Alors que leur rôle eût été de les diffuser auprès du plus grand nombre, en les simplifiant, faisant à l’instar de Georges Charpak, Pierre-Gilles de Gennes ou Cédric Villani, tout prix Nobel et médaille Fields qu’ils soient, œuvre de vulgarisation au sens le plus noble du terme, en rendant intelligible au plus grand nombre ce qui ne l’est pas a priori, œuvre de pédagogie en somme.
Comme à la religion pour les mœurs, la société avait décidé d’offrir aux mathématiciens, qui s’en sont parfois délectés, un autre rôle que celui de comprendre et d’expliquer le monde : celui de définir la frontière entre le bon et le mauvais, et dans le cas d’espèce, entre le bon et le mauvais élève, entre le bon et le mauvais étudiant et in fine entre le bon et le mauvais futur citoyen. Et las, nombreux sont ceux qui, parfois sadiques, souvent médiocres, toujours inconscients, s’y sont laissé prendre, voyant sonner l’heure de la revanche des mathématiques dans une société jusque là régulée par les lettres. Sans voir qu’au contraire la tyrannie qui se mettait en place apparemment à leur profit finirait par avoir raison de la place des mathématiques elles-mêmes.
J’ai toujours été intrigué pour ma part par cette réaction du plus grand nombre de mes interlocuteurs lorsque j’en venais à leur avouer ma profession : « Moi, je n’ai jamais rien compris aux Maths », répondaient-ils le plus souvent. « Lakoum dinoukoum wa lana dinouna », semblaient-ils ainsi proclamer, consommant instantanément la rupture du dialogue entre eux et moi, sur ce sujet tout au moins. Révélant à quel point le désert mathématique est abyssal dans notre société, car imaginerait-on un instant le dernier des ignorants proclamer sans honte qu’il ne comprendrait rien à l’histoire, à la biologie, ou même à la philosophie dont la prégnance au Lycée est pourtant si anecdotique ? Alors que les mathématiques nous bercent, certes à notre corps défendant le plus souvent, depuis que nous avons ouvert les yeux sur le monde, leur utilité apparaît toute relative à l’écrasante majorité de la population qui s’en passe fort bien. Les mathématiciens pourraient s’en consoler en invoquant Fontenelle, qui écrivait en 1699 : «On appelle d’ordinaire inutiles les choses que l’on ne comprend pas », mais cette consolation suffira-t-elle aux esprits rationnels qu’ils sont ?
Car il n’en a pas toujours été ainsi, loin de là. Pour les babyloniens, les mathématiques servaient surtout à calculer, dans un système fort complexe – sexagésimal – mais néanmoins de position. Les bases du calcul binaire de l’ordinateur étaient déjà là. Plus tard, les indiens et dans leur foulée les arabes reprendront un système qui fera recette, la numération décimale de position, avec l’adjonction du zéro qui est aujourd’hui devenu la moitié du système numérique. Leonardo Fibonacci, contraction de « figlio di Bonacci », dont le père – consul de la République de Gênes à Bougie – y fit venir son fils dont il connaissait l‘inclination pour les mathématiques, apprit ce système magique permettant la systématisation du calcul par le biais d’algorithmes, c’est à dire de la répétition d’une succession d’opérations conduisant à la solution d’un problème. Fibonacci en transmit l’essence dans son Liber Abaci (Livre des Abaques) à une Europe encore prisonnière de chiffres romains qui ne permettaient que de représenter les nombres, et en aucun cas de les calculer. Les mathématiques égyptiennes se préoccupaient quant à elles de la résolution de problèmes pratiques de répartition de nourriture, de salaires, de calcul de matériaux de construction, de problèmes de mesure de surface, de volume. L'essentiel de leurs documents consiste donc en techniques sur des exemples de calculs (multiplication, division et calculs avec des fractions). Pour les Grecs au contraire, la géométrie et l’abstraction sont reines, même si le calcul adoptait le système de numération décimal. La Renaissance reviendra aux sources de la civilisation occidentale que les Grecs représentent.
« Loin d’être l’exercice ingrat ou vain que l’on imagine, les mathématiques pourraient bien être le chemin le plus court pour la vraie vie ». Aujourd’hui que nous sommes projetés dans cette économie dite de la connaissance, dans laquelle l’informatique – c’est à dire le calcul numérique – investit tous les domaines, où le moindre objets est connecté, où des automates décident des actions à mener au vu des signaux qu’ils reçoivent de capteurs, en obéissant à des modèles mathématiques préprogrammés, cette affirmation d’Alain Badiou(6) retrouve toute sa vérité. Au point que l’inculture mathématique du plus grand nombre devient un insupportable frein au progrès. Toutes choses égales par ailleurs, la « numérisation » des populations constitue en ce début du XXIème siècle un enjeu tout aussi essentiel pour le développement industriel que le fut leur alphabétisation au début du XXème siècle en Europe, et au lendemain de l’indépendance en Tunisie. Les compétences mathématiques, celles du raisonnement raisonnement et de l’abstraction que requiert la construction de modèles et leur numérisation, ne peut dans ce contexte rester l’apanage d’une aristocratie coupée de la société. Même si ces compétences ne peuvent bien entendu, comme toutes les autres, être qu’inégalement partagées, il est urgent de les démocratiser, et de les diffuser largement. C’est la nouvelle frontière des mathématiciens et, au delà d’eux, de l’ensemble de notre système éducatif.
Mohamed Jaoua
(1) Conférence donnée au Club « Bochra El Kheïr », Tunis, 3 juin 2016
(2) Mathématicien, fondateur de l'IPEST, de l'Ecole Polytechnique de Tunisie, du LAMSIN-ENIT, co-fondateur d'Esprit et fondateur d'Esprit School of Business
(3) « Un mathématicien aux prises avec le siècle », Odile Jacob, 1997
(4) « Un peu d’internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d’internationalisme y ramène »
(5) Alexandre Grothendick : « Récoltes et semailles », non publié
(6) « Eloge des mathématiques », Flammarion 2015