Ammar Mahjoubi: L’oligarchie des notables
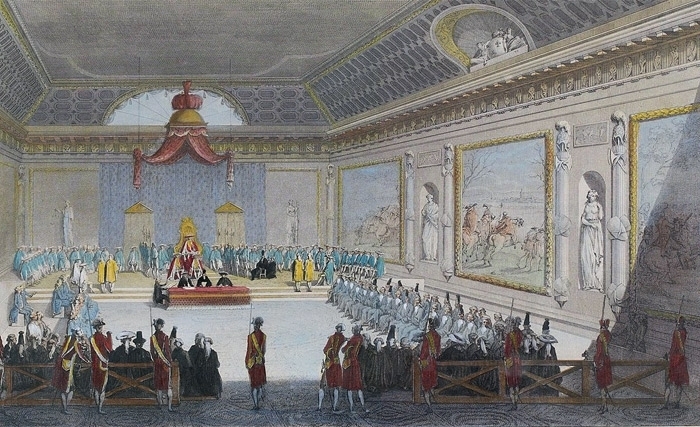
Par Ammar Mahjoubi - En choisissant ce titre pour un long paragraphe de son livre sur Le pain et le cirque, P. Veyne commence par citer Aristote et Max Weber. Le premier considère qu’ «il y a changement de la démocratie en oligarchie, si une classe riche est plus puissante que la multitude, et que cette dernière se désintéresse des affaires de l’Etat.» (Politique, V, 12) et Weber ajoute : «Toute démocratie directe tend à se convertir en gouvernement des notables.» (Economie et société, Vol 1 p 298). Conversion réalisée en Grèce, à l’époque hellénistique. Dans les cités où la vieille catégorie sociale des guerriers, l’aristocratie des cavaliers, exerçait une démocratie directe, une mutation totale avait transformé le corps social. Cette vieille caste avait disparu, et laissé la place à une classe sociale plus étroite et moins «typée». Aussi les historiens de l’époque hellénistique l’ont-ils appelée, souvent, une bourgeoisie. Une classe dirigeante de gens «bien-pensants, modérés», que l’inégalité économique avait placée à la tête de la société. Riche, possédante, elle héritait naturellement du pouvoir qui «va aux capacités matérielles et morales qui se trouvent être ordinairement un privilège de la richesse. C’est là, précisément, ce qu’on appelle un gouvernement de notables.»
.jpg) A thènes (où la citoyenneté avait été élargie, dépassant le cercle étroit des possédants) certes est par rapport à la majorité des cités grecques un cas particulier, car il se pourrait que ces cités aient été toujours oligarchiques. Mais les raisons qui expliquent que les notables athéniens aient pris le pouvoir, à l’époque hellénistique, dans cette démocratie directe où le pouvoir était exercé depuis longtemps par le peuple, expliquent aussi pourquoi ils le détenaient, dans la majorité des cités: «Toute démocratie directe est pesante, et les inégalités étant cumulatives, la classe riche tendait naturellement à être classe dirigeante.»
A thènes (où la citoyenneté avait été élargie, dépassant le cercle étroit des possédants) certes est par rapport à la majorité des cités grecques un cas particulier, car il se pourrait que ces cités aient été toujours oligarchiques. Mais les raisons qui expliquent que les notables athéniens aient pris le pouvoir, à l’époque hellénistique, dans cette démocratie directe où le pouvoir était exercé depuis longtemps par le peuple, expliquent aussi pourquoi ils le détenaient, dans la majorité des cités: «Toute démocratie directe est pesante, et les inégalités étant cumulatives, la classe riche tendait naturellement à être classe dirigeante.»
D’une cité hellénistique à l’autre, les institutions étaient bien entendu différentes: elles étaient plus ou moins censitaires. Mais la façade restait démocratique, même si le fonctionnement des institutions l’était moins, et si le conseil, la « synarchiai», prenait le pas sur l’Assemblée. Comme au temps de Démosthène et d’Alexandre de Macédoine, la politique, toujours faite par des orateurs, restait ouverte au mérite. Veyne cite, parmi les hommes politiques importants à cette époque, deux exemples: celui d’Euthydème, de Mylasa en Carie, qui, héritier d’une belle fortune, devint, grâce à son talent, un personnage important dans sa patrie et un homme réputé «dans toute l’Asie» ; et celui d’Hybréas, qui était pauvre et avait exercé des offices mineurs, mais dont la réputation ne cessa de grandir à Mylasa au Ier siècle avant le Christ, et qui, après la mort d’Euthydème, «devint le vrai maître de la cité». Auparavant, il s’était frotté aux avocats et avait gagné de l’argent. Certes, son talent l’avait beaucoup servi, mais «sans argent, on n’a pas le loisir ni le rang social qui conviennent pour faire de la politique.»
Si, à cette époque hellénistique, la carrière politique demeure ouverte au mérite, encore faut-il avoir aussi du loisir et de la culture, et faut-il surtout assumer des évergésies. L’évergétisme, qui fait qu’on ne peut devenir magistrat sans payer, élevant ainsi un mur d’argent. Veyne cite Louis Robert : «Le régime de la cité grecque subsiste, avec les modifications dans la pratique politique qu’entraîne de plus en plus le système de l’évergésie des bienfaiteurs, qui assument charges et magistratures et accumulent les honneurs.» (Annuaire du collège de France, 1971, p. 541). Le mérite n’est donc efficace que si on a hérité quelque aisance, ou si on l’a acquise. Ainsi la démocratie était tombée aux mains des notables.
D’après Aristote, la diversité des régimes est due à la diversité de la matière sociale qui les constitue (Politique, IV, 3). Or l’inégalité sociale, dans une démocratie directe, a des effets beaucoup plus profonds que dans une démocratie représentative, où la participation du corps civique à la politique est allégée, au point de ne prendre que quelques minutes aux citoyens, le jour des élections. Si bien que la plèbe des cités grecques avait non seulement laissé les seuls notables gouverner, mais sa lassitude politique aidant, elle n’avait cessé d’affaiblir sa participation. «Les pauvres, même sans participer aux honneurs, ne demandent pas mieux que de se tenir tranquilles, à conditions qu’on ne leur fasse pas violence et qu’on ne les prive d’aucun de leurs biens. Chacun trouve plus agréable de cultiver sa terre que de s’occuper de politique et d’être magistrat» (Aristote, Politique, IV,13 ; VI,4). Alors que le devoir du citoyen, dans une démocratie de la Grèce antique, était de s’adonner à la politique, de lui consacrer le plus clair de son temps, de s’en occuper et s’en préoccuper autant que, de nos jours, le ferait un militant actif dans un parti politique, la défection avait atteint des proportions intolérables. Il était devenu même difficile de réunir, à Athènes, le nombre suffisant de citoyens : les neuf dixièmes étaient absents et il aurait aussi fallu refouler vers la Pnyx, où se réunissait l’Ecclésia (l’assemblée du peuple), les oisifs attardés au marché.
Deux raisons sont avancées par Veyne à cette désaffection : le manque d’intérêt des citoyens et leur manque de loisir. On ne pouvait donc continuer à exiger, par esprit civique, une participation gratuite, et refuser l’indemnisation était devenu synonyme d’une réservation aux riches de toute l’activité politique. Périclès décida alors d’instituer l’indemnité, d’abord pour les jurés, ce qui, pour Platon, «rendit les Athéniens paresseux, lâches, bavards et cupides» (Gorgias, 515D). Une autre indemnité ne tarda pas à être accordée, au début du IVe siècle avant le Christ, à tous ceux qui assistaient aux séances de l’Assemblée du peuple : était-ce pour encourager la participation ou, plutôt, pour porter secours aux pauvres ? Comme le laisse penser Aristophane dans les Guêpes, où il affirme que l’indemnité des jurés était la ressource principale des milliers de pauvres. Quoique devenue nécessaire, cette mesure ne manqua pas de soulever à son tour de vives polémiques.
Veyne cite encore Platon (Gorgias, 520D,520E,521), qui admet les salaires servis aux artistes, aux architectes et aux médecins, mais s’élève contre l’indemnité consentie aux citoyens, tout comme contre l’enseignement salarié des sophistes. Mais à ces refus, pour des motifs élevés, se mêlaient d’autres, qui l’étaient beaucoup moins ; ceux des riches, car ils devaient, d’une part, supporter sous forme d’impôts le poids de cette indemnité, et celle-ci permettait, d’autre part, à l’ensemble des citoyens de se mêler des affaires publiques, et d’en partager la gestion avec ceux qui avaient les moyens, et donc le droit, de gouverner la cité. On peut donc conclure que toute démocratie directe était menacée par la conjonction de deux facteurs : le désir des oligarques, qui voulaient se réserver le pouvoir, et la démotivation des citoyens, car la constitution d’Athènes, adoptée lors de la révolution de Clisthène, exigeait de la masse des citoyens un degré de participation qui n’était pas durable. Sans compter le découragement des démocrates motivés, sans cesse confrontés, dans cette assemblée nombreuse et hétéroclite, à des décisions contraires à leurs convictions. Un retour à l’oligarchie censitaire ne devait éveiller en eux que peu de regrets. Vers la fin du IVe siècle avant le Christ, Athènes adopta un régime démocratique modérément censitaire.
Remplacer, par contre, le suffrage universel par un suffrage censitaire est tout à fait impossible dans toutes les démocraties actuelles. On peut certes le supprimer, le truquer ou lui enlever toute signification, mais on ne peut plus le réserver ouvertement aux riches, d’autant qu’il est accompli par les citoyens sans aucune peine, ne leur coûtant que quelques minutes, le jour des élections. Mais c’est la différence entre la citoyenneté grecque et la citoyenneté actuelle, dans les démocraties occidentales, qui est la plus importante. L’universalisme de celle-ci, absent dans les cités grecques, est dû à des raisons historiques et tire son origine des régimes monarchiques, et non pas, assure Veyne, de l’universalisme chrétien, comme on le suppose parfois, à tort.
Sachant que l’idéologie de la umma islamique, son universalisme politique auquel se cramponnent encore certains illuminés, n’a rien d’équivalent, politiquement, dans le monde chrétien. Les citoyens des démocraties occidentales actuelles ont tout simplement pris la suite des sujets du roi, car tout homme qui naissait dans le royaume était le sujet de son souverain. Le citoyen grec, par contre, faisait partie d’un groupe constitué et organisé, qui était libre du choix de ses membres. Platon dans les lois, comme dans plusieurs autres textes, indique que la cité grecque débute par un tri initial, par un parti-pris sélectif. On choisit, parmi les habitants d’une agglomération ceux qui seront des citoyens, qui composeront la cité au sens politique et juridique du terme. On laisse évidemment de côté les esclaves, on ne retient pas, non plus, les métèques, qui sont des étrangers domiciliés et on exclut également les pauvres, dépourvus d’un patrimoine à une seule exception, celle d’Athènes, qui avait élargi la citoyenneté aux démunis. Fermé, héréditaire, le corps civique grec était donc une institution et non une donnée ; et il était impensable que des métèques, même s’ils étaient établis dans la cité depuis plusieurs générations, fussent dotés de la citoyenneté.
Veyne se demande ainsi, en rapport avec cette conception antique de la citoyenneté, si le racisme yankee, comme celui des adeptes de l’apartheid, en Afrique du Sud, « ne viennent pas de l’origine coloniale de ces nations : le groupe civique, aux Etats Unis comme en Afrique du Sud, est un groupe d’émigrés qui se sont choisis à l’origine. On pourrait ajouter le racisme israélien qui, bien qu’avec des motivations religieuses supplémentaires, et celles d’une ethnicité inventée, est aussi le racisme des groupes successifs d’émigrés, et résulte de l’origine coloniale de l’État d’Israël.
De cette différence entre deux conceptions de la citoyenneté découle, au plan moral, une conséquence importante : puisque dans la Grèce antique, la citoyenneté existait par convention, et non pas de façon naturelle, elle était susceptible de variations, de s’élargir ou de se restreindre. Le retour à l’oligarchie donc était toujours possible. Faute d’universalisme, d’extension de la citoyenneté à tous les habitants d’une agglomération, et faute aussi de participation des citoyens, dans une démocratie directe, l’inégalité sociale avait pu transformer les cités hellénistiques en républiques des notables. Mais l’autoritarisme, la contrainte ne pouvaient perdurer indéfiniment et tout régime, pour subsister, devait chercher les moyens de se légitimer. Tocqueville, cité par Veyne, affirme que «Le principe de la souveraineté du peuple réside au fond de tous les gouvernements et se cache sous les institutions les moins libres» (Souvenirs, éd. 1942, p. 220)
Même si les gouvernés, dans le régime des notables, n’étaient que des citoyens passifs, il fallait que les gouvernants puissent gagner leur confiance, qu’ils sachent se modérer, malgré la tendance des oligarchies à abuser et à réprimer, les pratiques politiques les plus simples étant de piller les fonds publics. A cet égard, et pour conclure, citons, après Veyne, Aristote : «Les lois et les autres institutions doivent être ordonnées de telle façon que le service de l’Etat ne puisse jamais être une source de profit. La masse du peuple n’est pas mécontente d’être exclue de l’exercice du pouvoir, ce qui l’irrite, c’est de penser que les magistrats mettent le trésor public au pillage, et alors deux choses excitent à la fois sa mauvaise humeur : son exclusion des honneurs et son exclusion des profits. La seule manière de faire coexister l’aristocratie et la démocratie ne peut consister que dans l’interdiction de s’enrichir par l’exercice d’une fonction publique. Grâce à cette interdiction, il sera possible de satisfaire à la fois les notables et les gens du peuple : d’une part accessibilité de tous aux emplois publics, ce qui sera démocratique, de l’autre, présence des notables au sein du gouvernement, ce qui sera aristocratique. On y parviendra s’il est impossible de retirer un profit des fonctions publiques. Les pauvres ne voudront plus les exercer parce qu’ils n’auront aucun profit à en attendre et préféreront s’occuper de leurs affaires privées, et les gens riches seront aptes à les remplir, parce qu’ils n’ont nullement besoin des biens publics en sus des leurs. » (Politique, V, 8(1308B30)
Ammar Mahjoub
.jpg)