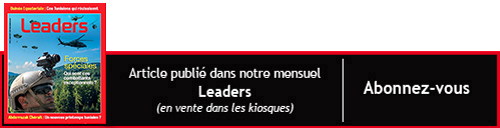Lettrés et marchands: dans l’histoire des villes musulmanes

.jpg) Il est un fait bien connu que les sociétés musulmanes ont été marquées au cours de leur histoire par la coexistence entre des populations sédentaires (rurales et citadines) et des populations nomades. Si les milieux ruraux à structures tribales solides étaient dominés par une aristocratie de bédouins éleveurs (notamment les grands nomades chameliers), pas toujours en conflit avec l’Etat (et même fréquemment en association d’intérêt avec lui) certes, mais capables de lui tenir la dragée haute, voire de mettre en péril son existence, qu’en était-il des milieux citadins alors même que la civilisation musulmane fut massivement et brillamment une civilisation des villes ? Quels rapports ces milieux entretenaient-ils avec l’Etat qui, au cours des siècles, prit la forme du despotisme ? Un pouvoir d’une telle nature, évidemment hostile à toute forme d’autonomie des groupes sociaux, y compris les plus paisibles, pouvait-il relâcher sa surveillance tatillonne alors même que la ville musulmane était le lieu par excellence où s’exprimaient avec force les valeurs religieuses, où s’épanouissait la civilisation islamique et où résidaient les deux personnages emblématiques de l’ouléma et du marchand ?
Il est un fait bien connu que les sociétés musulmanes ont été marquées au cours de leur histoire par la coexistence entre des populations sédentaires (rurales et citadines) et des populations nomades. Si les milieux ruraux à structures tribales solides étaient dominés par une aristocratie de bédouins éleveurs (notamment les grands nomades chameliers), pas toujours en conflit avec l’Etat (et même fréquemment en association d’intérêt avec lui) certes, mais capables de lui tenir la dragée haute, voire de mettre en péril son existence, qu’en était-il des milieux citadins alors même que la civilisation musulmane fut massivement et brillamment une civilisation des villes ? Quels rapports ces milieux entretenaient-ils avec l’Etat qui, au cours des siècles, prit la forme du despotisme ? Un pouvoir d’une telle nature, évidemment hostile à toute forme d’autonomie des groupes sociaux, y compris les plus paisibles, pouvait-il relâcher sa surveillance tatillonne alors même que la ville musulmane était le lieu par excellence où s’exprimaient avec force les valeurs religieuses, où s’épanouissait la civilisation islamique et où résidaient les deux personnages emblématiques de l’ouléma et du marchand ?

La proximité géographique avec le pouvoir et ses représentants, la prospérité des villes, voire leur opulence, un certain traitement de faveur au bénéfice des notables, tout cela a donné naissance à une idée reçue tenace – y compris chez les spécialistes - selon laquelle les élites citadines étaient associées à l’exercice du pouvoir politique en ville et même, crurent certains, au niveau central. En réalité, l’Etat, fort de son rôle de protecteur, était omnipotent. En dépit des apparences, c’est donc l’aristocratie bédouine qui, au cours des âges, fut associée par le pouvoir au maintien de l’ordre sur les pistes qui traversaient les vastes étendues semi-désertiques (comme le fait d’escorter les caravanes contre rétribution bien sûr) ainsi qu’à la perception de certains impôts que l’administration du Prince donnait en affermage. L’équilibre politico-économique réel était donc celui qui existait entre «les maîtres des villes et les maîtres des routes» (selon l’expression de l’historien marocain Abdallah Laroui), c’est-à-dire l’Etat et les plus puissantes des tribus nomades.

Omniprésent, l’Etat, non seulement contrôlait les institutions urbaines (cadis, imams, cheikh el médina à Tunis ou cheikh al balad au Moyen-Orient, syndics des métiers, notaires, et d’autres encore) mais avait rapidement réussi à intervenir directement dans leurs affaires. Cette omniprésence – qui distinguait fondamentalement la gestion des villes musulmanes des villes européennes fortes de leurs libertés communales acquises dès le Moyen Âge – avait abouti fatalement à un assujettissement des élites urbaines et principalement les oulémas (à tout le moins dans le monde sunnite) et les marchands. Le milieu des lettrés comprenait essentiellement les enseignants, les magistrats et les notaires auxquels il faut ajouter les secrétaires des chancelleries formés à la même école que les premiers. En haut de la hiérarchie sociale urbaine se trouvaient les titulaires des dignités de la magistrature religieuse qui relevaient directement du souverain : cadis et muftis organisés comme dans le cas de la Tunisie des beys husseïnites de façon élaborée et hiérarchisée. Défenseurs de l’ordre établi, ces personnages respectés étaient néanmoins conscients de leur responsabilité morale et certains d’entre eux se distinguaient par leur véhémence réprobatrice à l’égard de l’Emir ou de ses subordonnés, au nom de l’islam et de la justice. Si au cours de l’histoire, beaucoup poussèrent jusqu’au bout – au risque de subir les foudres du prince - leur contestation d’un pouvoir qu’ils jugeaient inique, la majorité des oulémas se sentaient cependant liés par l’engagement donné lors du serment d’allégeance donné au souverain et, d’une manière générale, ils préféraient contribuer à la stabilité et à la survie de l’ordre politique– d’ailleurs généralement favorable à leurs intérêts – plutôt que de réveiller les vieux démons de la discorde.

Ceux d’entre les oulémas qui se consacraient à l’enseignement jouissaient eux aussi d’un grand prestige pour leur rôle dans la diffusion des sciences religieuses, du droit et de la langue arabe. L’absence jusqu’au XIXe siècle d’une institution universitaire structurée leur assurait une relative indépendance à l’égard du pouvoir. Ils tiraient leurs ressources en exerçant parallèlement un métier dans le commerce ou comme notaires. De sorte que la proximité entre la Mosquée (où était dispensé le savoir) et les souks était aussi une proximité économique, sociale et culturelle, d’autant plus que beaucoup d’artisans ne manquaient pas d’assister aux cours. L’activité intellectuelle, qui fut intense en certaines périodes de l’histoire des villes musulmanes, était cependant étroitement surveillée par le pouvoir. De sorte que si l’érudition citadine a pu donner naissance très tôt à la pensée critique, celle-ci fit malheureusement long feu, empêchés que furent ses fondateurs de faire école. L’exemple emblématique étant celui du célèbre Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198), mais nous pourrions en citer bien d’autres. Dans ces conditions, la libre réflexion fut progressivement refoulée au profit d’un travail intellectuel enserré dans le cadre étroit des corpus établis. L’enseignement dispensé dans de vénérables institutions comme la Zitouna de Tunis, la Qarawiyine de Fès et Al Azhar au Caire fut immanquablement frappé d’une sclérose durable entretenue par une pédagogie qui privilégiait la transmission orale, la mémorisation, la répétition et le respect pétrifié des auteurs anciens. Il aura fallu attendre le XIXe siècle, les projets de réforme de certains princes et vizirs, conscients du retard accumulé, et l’introduction de l’imprimerie pour que les choses commencent à bouger.

Mais qu’en était-il de l’autre milieu social typiquement citadin, c’est-à-dire celui des marchands ? Forts de l’image valorisante que conférait la civilisation musulmane à leur métier, ceux-ci (qui étaient souvent aussi en même temps des fabricants de produits comme la chéchia ou les tissages en soie dans les souks de Tunis) contribuèrent longtemps à la prospérité des villes. Pour les plus puissants, leur périmètre d’intervention sur terre et sur mer était étendu, en particulier, dans le bassin oriental de la Méditerranée et l’océan Indien. Ils jouèrent, en même temps, un rôle primordial dans l’islamisation de plusieurs contrées de l’Extrême-Orient et de l’Afrique subsaharienne. Ces tujjâr-s audacieux, immortalisés par le personnage de Sindbad le marin, réussissaient à édifier des fortunes considérables. Mais à la différence de leurs homologues européens – constamment protégés par leurs Etats – la réussite professionnelle et la puissance financière des marchands des villes musulmanes les rendaient vulnérables car leur réussite suscitait souvent la convoitise du prince. En pays de despotisme oriental, le riche était forcément l’obligé du pouvoir politique qui, pour toutes sortes de prétextes, prélevait un «tribut» sous forme d’acceptation de cadeaux somptueux ou, plus prosaïquement, d’argent en espèces. Tous ces efforts ne les mettant d’ailleurs guère à l’abri d’une confiscation pure et simple des richesses accumulées grâce au commerce. Ces confiscations étaient d’autant plus fréquentes que l’Etat, comme partout et toujours, était impécunieux et que les marchands les plus riches étaient souvent aussi des fermiers d’impôts. Cette fragilité, en quelque sorte structurelle, des fortunes marchandes, était aggravée par le fait que le souverain lui-même ou ses ministres se lançaient dans les affaires. Ce phénomène se traduisait fatalement par une concurrence déloyale et dévastatrice. A toutes les époques, toute activité de quelque envergure obligeait le marchand à une compromission avec les détenteurs du pouvoir, à une soumission à ses exigences ou à un abandon pur et simple de son activité. A l’époque abbasside, les auxiliaires du fisc, chargés de vérifier la valeur des espèces versées par les contribuables, étaient,simultanément, des hommes d’affaires ou des fermiers d’impôts.

En 1483, le cadi de Tripoli du Levant était aussi marchand de coton et dans la Tunisie des années 1820, des dignitaires politiques étaient engagés dans des opérations commerciales. De la sorte, à aucun moment de l’histoire des villes musulmanes, les marchands ne purent se constituer en groupe puissant susceptible de contenir les appétits du prince et de son entourage. Au XVe siècle, au temps des sultanats ayyoubide puis mamelouk d’Egypte et de Syrie, les Kârimi, un important groupe de marchands spécialisés dans le commerce des denrées précieuses et les opérations financières de grande envergure, n’échappèrent pas à la règle. Pour se maintenir, ils furent en effet contraints d’entrer au service du sultan Barsbay (1422-1437) parce que celui-ci était devenu, selon l’expression de l’historien Sobhi Labib, «le grossiste par excellence de l’Egypte». Ce prince alla même plus loin en établissant un monopole de fait sur des produits particulièrement recherchés comme le poivre qu’il achetait pour son propre compte et interdit aux marchands de faire des transactions sur cette denrée avant qu’il eût terminé ses propres affaires! Bien plus tard, mais toujours dans le même esprit, sous le règne de Hammouda Pacha Bey de Tunis (1782-1814), l’économie fut mise en coupe réglée par son puissant ministre Youssouf Saheb Ettabaâ, qui exerça un quasi-monopole sur les exportations.

Souvent, l’Etat beylical accaparait le marché des céréales et de l’huile en recourant à la vente forcée à un prix modique pour les revendre aux négociants européens à un prix beaucoup plus élevé. Les prédations de l’Etat allèrent même jusqu’à ruiner l’économie du pays comme dans la première moitié du XIXe siècle, lorsque face à des difficultés croissantes de trésorerie, le gouvernement du bey accaparant le commerce d’exportation de l’huile, recourut à la vente par anticipation et à un prix inférieur au cours normal. Des années de suite, la récolte vint à manquer et les négociants étrangers exigèrent d’être remboursés au prix qui en cette période de crise avait augmenté de manière drastique. A la ruine des producteurs s’ajoutèrent le surendettement de l’Etat et la faillite d’un nombre élevé de familles fortunées forcées de contribuer au renflouement des finances beylicales.

Sans bourgeoisie économiquement structurée et autonome, les villes musulmanes étaient aussi des villes sans banques. La rapacité d’un pouvoir omniprésent rendait en effet illusoire toute garantie en matière d’opérations bancaires. Dynamiques et laborieuses, souvent prospères, voire opulentes (Bagdad puis Istanbul furent à l’apogée des Abbassides et des Ottomans les plus grandes du monde), savantes aussi, les villes musulmanes furent constamment des villes à élites captives. Dans ce caractère particulier réside une des raisons fondamentales des difficultés auxquelles nos pays ne cessent aujourd’hui encore d’être confrontés face aux exigences de la modernité et du progrès. Partout dans le monde, le milieu citadin a été, dans l’histoire, le seul espace susceptible de donner naissance à une relation constructive entre le pouvoir politique et la société. Dans la civilisation musulmane, qui fut par ailleurs si brillante, la ville n’a malheureusement pas pu remplir ce rôle majeur parce qu’elle n’a cessé d’être coincée entre la tyrannie de l’Etat et la corruption de ses agents, d’une part et, d’autre part,le goût des rivalités intertribales et des archaïsmes propres à un monde bédouin enclin à l’anarchie.

Mohamed-El Aziz Ben Achour
“Pour en savoir plus, voir de l’auteur: L’Excès d’Orient, la notion de pouvoir dans le monde arabe, éditions. Erick Bonnier, Paris, 2015“