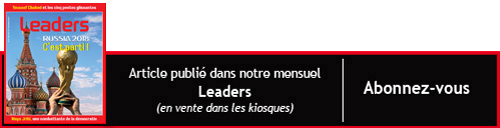Claude Rizzo : Souvenirs d’un Tuniso-Franco-Maltais de Bab el-Khadra (Vidéo)

 Je ferme les yeux et retrouve des images qui portent leurs soixante ans et quelques rides semblables à celles qui aujourd’hui sillonnent mon visage. Des images où se confondent les vérités de l’Histoire et les rêves d’une jeunesse dont je porte le deuil et la richesse à la fois.
Je ferme les yeux et retrouve des images qui portent leurs soixante ans et quelques rides semblables à celles qui aujourd’hui sillonnent mon visage. Des images où se confondent les vérités de l’Histoire et les rêves d’une jeunesse dont je porte le deuil et la richesse à la fois.
Je vois un quartier populaire, bruyant, coloré, chaleureux. J’aperçois des femmes sous leur safsari, des paysans conduisant leur araba au marché, des vendeurs des rues, des calèches qui disputent les clients aux bébés taxis. Je croise un couple d’Italiens, toujours bien mis suivant les traditions de leur communauté, à laisser croire qu’ils vont à la messe, même quand ce n’est pas dimanche. Derrière eux arrive une famille maltaise. Le père dans son bleu de travail, la mère en tenue traditionnelle : faldetta et foulard sombre, les enfants vêtus à la diable, le pantalon de l’aîné pour le petit et l’aîné habillé avec les restes du père: la mode n’a pas encore franchi le seuil des écuries maltaises. Raphaël Boucobza apparaît à son tour dans le décor, sa kipa sur le côté, son espèce de grande robe noire traînant sur les trottoirs poussiéreux. Qui ne connaît pas Raphaël Boucobza sur la place de Bab el-Khadra? C’est chez lui que l’on trouve les meilleurs keftegi du quartier, et peut-être même de Tunis. Quelques pas, et j’arrive devant le café maure, celui de M. Amar Boualeg, un ami de notre famille depuis toujours.
Extrait du Maltais de Bal el-Khadra, paru aux Editions Michel Lafon et édité en format poche aux Editions Melis.
M. Boualeg était assis à la terrasse du café en compagnie d’un autre Tunisien. Ce dernier venait de temps à autre dans le quartier. Il portait ce jour-là la tenue traditionnelle des grands dignitaires turcs: un sarouel décoré de broderies à l’aiguille, la chéchia haut de forme garnie d’un gros pompon noir, des babouches de prince incrustées de pierreries. On disait de lui qu’il appartenait à la dynastie husseinite, qu’il siégeait au palais du Bardo dans le gouvernement du Bey, avec le titre de «Sahib at Taba».
M. Boualeg était un homme considéré par tout le monde dans le quartier. Il avait fait la guerre comme adjudant des troupes «colonialistes». Il avait même libéré la métropole, où les gens l’embrassaient comme si c’était le jour de l’an, où il avait gagné des décorations pour son courage. Des médailles et des rubans que M. Amar Boualeg portait sur sa veste le jour du Quatorze Juillet, quand le résident général l’invitait pour lui offrir à boire avant le feu d’artifice. Et Gaëtan savait que ce monsieur lui serrait personnellement la main.
- Omokmetit, dit le gérant du café maure à son voisin.
- Meskin, répondit l’autre.
- Ça fait combien de temps que ta mère elle est allée retrouver le Bon Dieu?
- Sept ans, monsieur Boualeg, répondit Gaëtan.
Je suis chez moi, je suis à Bab el-Khadra, le quartier où je suis né, comme mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père avant moi. Ce n’est sans doute pas le quartier le plus chic de Tunis. Mais c’est le mien, celui que j’aime, auquel j’appartiens corps et âme, là où je grandirai, où j’aurai un jour ma calèche, qui me permettra de gagner ma vie comme tous les hommes de ma famille. Et c’est au cimetière de Bab el-Khadra, auprès de ma mère et de tous les miens, que je dormirai jusqu’au Jugement dernier.
Je connais peu de choses du monde qui m’entoure. Le seul exploit dont je peux me flatter, mon voyage de Christophe Colomb en quelque sorte, est d’avoir pris le bus pour Medjez el-Bab à l’occasion du mariage de l’une de mes tantes, Marie Spaïla, pour ceux qui l’aurait croisée, celle dont le père «faisait boucherie chevaline» au marché central.
Mais qu’importe le reste du monde, mon univers est ici, sur cette place, véritable Tour de Babel, où les cloches du Sacré-Cœur répondent au muezzin de notre mosquée, où nous nous retrouvons au bain maure, où les fêtes nous donnent l’occasion de nous rappeler que nous sommes tous fils d’Abraham (ou d’Ibrahim suivant le Livre de chacun.) «Aïd mabrouk !», «Joyeux Noël!», et quelques «youyou!» en l’honneur de la bar mitzvah du dernier des Choukroun.
Je rentre à l’école où la France m’attend avec ses certitudes et ses vérités absolues. C’est là que j’apprends que le cosmopolitisme, qui m’apparaissait alors comme une richesse, ne représente qu’un métissage nuisible à la cohésion d’une nation. Je comprends alors que toute différence doit être ressentie comme une agression latente contre notre belle patrie. Et pour bien nous le prouver, voici que l’on nous offre de nouveaux ancêtres: de grands gaillards, blonds aux yeux bleus comme ce n’est pas permis, aussi beaux que le Christ de notre église, qui lui aussi devait descendre d’une tribu gauloise. Cependant, à Bab el-Khadra, tout le monde est un peu bronzé, même les Européens. Seul Marmoud Hamaki échappe à la règle commune. Mais lui, meskin, il est albinos.
M. Dupuy, notre maître d’école, est un brave homme, pétri de qualités et bon pédagogue de surcroît. Il apparaît comme le prototype de l’instituteur de la République convaincu de l’importance de sa mission. Et celle-ci lui commande de s’en prendre à notre jargon, si riche, si coloré pourtant, où se mêlent avec bonheur les langues et les patois appartenant aux communautés qui composent le peuple de Bab el-Khadra.
M. Dupuy nous répète que la France a fait de nous des Français et que nous devons être fiers de cet immense privilège. Nous étions à présent citoyens d’une grande nation, généreuse et respectée, qui s’est vu confier une tâche à sa mesure, celle de porter sa civilisation sur tous les continents, méritant ainsi la reconnaissance et l’affection des peuples de son empire.
Comment ne pas aimer la France après de tels discours? Alors je me suis mis à l’aimer, autant que j’aime la Tunisie et les ruelles de mon quartier. Ce soir, dans le barouf propre à notre place, l’une des plus bruyantes de Tunis, là où nos deux cafés se font concurrence à coups de décibels, l’un offrant la mélancolie lancinante du malouf, l’autre lui répondant par des chanteurs à la mode, parmi les youyou fêtant le retour d’un hadj, son pèlerinage à La Mecque accompli, accompagnant le son aigu des castagnettes d’une bousadia, j’entends les cris d’un groupe d’adolescents sortant de la rue de la Verdure: «Iaia Bourguiba! Iaia Ben Youssef!» Des noms que j’entends pour la première fois. Je connais pourtant tous les joueurs de l’Espérance, dont je suis un farouche supporter. Je pourrais citer leur nom et leur prénom, sans risque de me tromper. Mais ces deux hommes sont pour moi des inconnus, je dois l’avouer. Des cris qui annonçaient la fin d’un monde: celui d’un cosmopolitisme que se partageaient Tunisiens, Siciliens, Maltais, Juifs autochtones ou Juifs livournais, mais aussi quelques Grecs et une famille de Russes blancs. L’utopie d’une société mixte et fraternelle trouverait bientôt sa place dans les poubelles de l’Histoire. Le repli identitaire était en marche. Deux camps dressaient désormais leurs murailles. La première était tenue par ceux qui aspiraient à l’indépendance. L’autre cachait les défenseurs du colonialisme. Et ce fut à l’abri de cette dernière que l’on m’avait réservé un strapontin.
Je ne fus même pas étonné quand l’incident se produisit. Je remontais ma rue et me trouvais à quatre pas de la maison qui m’a vu naître. Le grand escogriffe, dont je connaissais pourtant la famille, m’a donné une gifle en me traitant de sale Français sous prétexte que je ne portais pas la chéchia réglementaire. Plus tard, bien plus tard, je remontais une rue qui n’était pas la mienne et me trouvais à quatre pas d’une maison où rien ne me rappelait ma jeunesse. Le grand échalas, que je ne connaissais ni d’Êve ni d’Adam, m’a donné une gifle sous l’autre joue en me traitant de sale Arbi sous prétexte que je traînais un peu de sable du djebel sous mes babouches. Je leur en ai voulu avant de leur accorder à chacun une part de la vérité. Moitié Français, moitié Arbi : tel est mon destin, celui que m’ont imposé ma naissance et les méandres de l’Histoire, même si je sais à présent que je ne dormirai pas, en attendant le Jugement dernier, dans un cercueil posé près de celui où repose ma mère, au cimetière de Bab el-Khadra.
Claude Rizzo