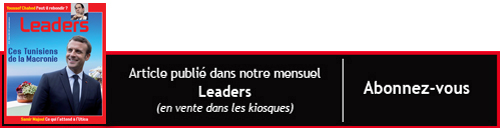A l’aube de l’histoire de la Tunisie: De la fondation de Carthage à son ancrage africain

Lorsque prit fin la période humide du Néolithique, vers le milieu du IIIe millénaire, l’Afrique du Nord s’est trouvée dans une situation quasi insulaire; isolée et séparée par un désert hostile, elle ne communiquait plus avec l’ensemble du continent africain que par l’étroit couloir tripolitain, en bordure de la côte méditerranéenne. La rupture de l’ancienne unité continentale a été cependant compensée par des rapports nouveaux, inaugurés à cette époque aux deux ailes au Maghreb; avec le Sud de la péninsule ibérique à l’Ouest et, à l’Est, avec le Sud de l’Italie, la Sicile, la Sardaigne et Malte. Les relations maritimes remplaçaient les anciennes liaisons continentales et l’obsidienne, présente dans les strates de la protohistoire, témoigne de la fréquence des liens entre les côtes du Maghreb et les îles volcaniques.
Dès la fin du IIe millénaire avait aussi commencé la fréquentation des côtes du Maghreb par les navigateurs phéniciens. Au nord-est du pays et éloignée aujourd’hui du rivage par l’alluvionnement de la Medjerda, Utique était, semble-t-il, à cette époque, leur seule escale attestée par les textes anciens. Pline l’Ancien y mentionnait un temple d’Apollon et assignait la date de 1101 à sa fondation. Plus fiables sans doute apparaissent les sources textuelles qui documentent la fondation de Carthage et rapportent les circonstances de sa création à la fin du IXe siècle avant l’ère chrétienne. Nombreuses, convergentes et cohérentes, ces sources de l’historiographie grecque remontent à Timée de Taormine qui, au début du IIIe siècle av. J.-C., était en relation avec les Puniques établis en Sicile. Il avait affirmé que Carthage fut fondée trente-huit ans avant la première Olympiade, soit en 814/813 av. J.-C.; date confirmée par le témoignage de Ménandre d’Ephèse, historien grec de la première moitié du IIe siècle avant le Christ, qui avait utilisé des annales phéniciennes mentionnant, avec les listes royales, les événements les plus remarquables. Ses notices, recueillies à la fin du Ier siècle par Flavius Josèphe, situent la fondation au cours de la septième année du règne du roi de Tyr Pygmalion; ce qui correspond, compte tenu de l’imprécision des conversions à partir d’ères différentes, aux dates de 824, 819 ou encore 814, l’année qui est avancée par Timée. La datation est accompagnée, bien entendu, d’un mythe de fondation rapporté d’une façon convergente par Timée et Mélandre, qui racontent le meurtre du mari d’Elyssa par son frère Pygmalion et la fuite de la sœur avec un certain nombre de fidèles, son escale à Chypre et ses pérégrinations qui lui auraient valu le surnom de Deido (Didon). Surnom immortalisé par Virgile dans son Eneide et par la légende tissée par le poète latin. Virgile avait doté Carthage, comme sa grande rivale Rome, d’une origine à la mesure de sa puissance, en rapportant sa fondation à la destruction de Troie et au cycle d’Enée, échappant à la ruine de la cité légendaire.
Nantis de ces données textuelles, les archéologues ont déployé des efforts soutenus, depuis le XIXe siècle, pour tenter de les accorder avec la réalité du terrain. Mais jusqu’à présent, près d’un siècle sépare encore la date de 814 de celle des sépultures puniques les plus archaïques. Plus récemment cependant, des sondages très profonds poussés jusqu’aux strates les plus anciennes de l’habitat ont mis au jour des vestiges typiques de céramique grecque, dont la chronologie se rapproche de cette date traditionnelle.
Puniques et Grecs en Occident et leurs luttes incessantes en Sicile
Depuis la fin du VIIe siècle avant le Christ, le bassin occidental de la Méditerranée était devenu très fréquenté. Phéniciens et Puniques d’une part, Grecs de l’autre s’y disputaient la maîtrise de la navigation et du commerce maritime. Les installations helléniques, plus récentes que les colonies phéniciennes et carthaginoises, s’étaient établies à Massalia (Marseille), au débouché de la vallée du Rhône, en Campanie au Sud de l’Italie, à l’Est de la Sicile, à Cyrène (Benghazi) en Libye et plus tard encore, sur les côtes de Catalogne et d’Andalousie; tandis que les Phénico-Puniques contrôlaient le Sud de l’Espagne, les îles Baléares, la Corse, la Sardaigne, la Sicile occidentale ainsi que les côtes septentrionale et orientale du Maghreb, depuis Lixus (Larache) au Maroc jusqu’en Tripolitaine à Leptis Magna. Au large de la côte africaine, Gozzo et Lampedusa étaient aussi occupées par Carthage à partir du IVe siècle et à Pantelleria, les Puniques contrôlaient tout au moins le port et les fortifications de l’acropole.
La Sardaigne, au Nord, était la pièce maîtresse de l’emprise carthaginoise sur les îles et les côtes du bassin occidental de la Méditerranée; et pendant près de quatre siècles – du VIe siècle jusqu’à 238 av. J.-C. – l’île fut, sans partage, un territoire punique. Mais tout à fait différente était la situation en Sicile, qui devint le champ clos des luttes acharnées et incessantes entre Puniques et Grecs du Ve jusqu’au milieu du IIIe siècle. En 480 av. J.-C., les Carthaginois, longtemps confinés à l’Ouest de l’île, avaient espéré qu’une victoire décisive allait leur assurer la possession totale du territoire sicilien. Cette mainmise exclusive leur aurait permis non seulement de disposer de terroirs d’une fertilité exceptionnelle, mais aurait surtout rendu possible l’occupation d’une position clef entre les deux bassins de la Méditerranée, afin d’y contrôler les routes maritimes les plus importantes du monde antique.
L’occasion de cette confrontation majeure fut cependant offerte par les Grecs, lorsque le tyran des deux cités de Gela et de Syracuse fit cause commune avec celui d’Agrigente et s’empara d’Himère, où régnait un allié des Carthaginois. Hamilcar, de la famille des Magonides, rassembla alors une flotte importante et leva des troupes dans la plupart des possessions carthaginoises. Mais cette armada subit devant Himère, en raison essentiellement des naufrages, une défaite qui confina au désastre. Carthage, tirant la leçon de cet échec, comprit alors la nécessité de disposer d’un territoire important, d’un ancrage africain solide dans son arrière-pays, au centre de son empire maritime.
En Sicile cependant, le Ve siècle fut encore riche en péripéties. En 409 un Hannibal, petit-fils du vaincu d’Himère, réussit même à reprendre cette cité et en 405, Himilcon s’empara aussi d’Agrigente et de Gela. Le tyran de Syracuse, Denys l’Ancien, fut alors contraint de reconnaître à Carthage, par traité, la possession de la Sicile occidentale. Mais cet avantage carthaginois et cette stabilisation furent de courte durée, car ignorant le traité, les guerres punico-grecques continuèrent dans l’île jusqu’au milieu du IIIe siècle, jusqu’à l’intervention de Rome.
L’ancrage africain
Devenu indispensable après la défaite d’Himère, cet ancrage nécessitait une consolidation importante des possessions carthaginoises à l’Est du Maghreb. Mais la fondation de la métropole punique, même si elle remontait à la date haute du IXe siècle avant le Christ, avait été précédée par celle d’Utique au débouché de la Medjerda; et sur la côte sahélienne, comme encore plus au Sud sur le rivage de la Libye, deux autres cités, Hadrumète (Sousse) et Leptis Magna (Lebda), avaient été fondées elles aussi, comme Carthage, par des Tyriens, probablement vers la fin du VIIe siècle. Comme semble l’indiquer le matériel archéologique daté de haute époque et mis au jour par les fouilles, il n’existait pas alors de rapports étroits entre la métropole punique et ces deux cités phéniciennes, jalouses de leur indépendance.
Toujours est-il que comme le laisse entendre un rhéteur grec, Dion Chrysostome, dans une allusion à un certain Hannon, qui «avait transformé les Carthaginois de Tyriens qu’ils étaient en Libyens», (Discours, XXV), cette «africanisation» des descendants des navigateurs phéniciens indique d’abord la constitution par Carthage, par avancées successives, d’un hinterland où il faudrait toutefois distinguer les territoires administrés directement de ceux que la métropole punique avait seulement soumis à son influence. Mais l’allusion du rhéteur est susceptible aussi de diverses interprétations.
Au préalable, il faut observer que loin d’être vides, le pays autour de la presqu’île de Carthage, comme l’ensemble des territoires qui allaient être administrés ou dominés par la métropole punique, étaient habités par une ethnie dotée d’une autorité reconnue. C’est ce que montrent, malgré leur caractère légendaire, les récits de la fondation de Carthage; aussi bien celui de Timée de Taormine que celui de Justin (VI, 1). En abordant le rivage, les marins tyriens étaient fort probablement entrés en relation avec une autorité politique, qui apparaît nettement dans l’histoire de la peau de bœuf découpée en fines lanières; comme elle apparaît également dans un autre récit, celui d’une demande de mariage adressée à Elyssa par Hiarbas, le «roi» des Maxitani. Les historiens ont rapproché ce nom de celui du pagus Muxsi, cette circonscription territoriale de la province romaine, qui est l’héritière d’une circonscription administrative du territoire punique. Il est indéniable donc que l’histoire de la peau de bœuf implique l’acceptation, par Elyssa, d’une exigence formulée par une autorité indigène et elle serait même susceptible de masquer le paiement d’un tribut. Mais nos connaissances, malheureusement, s’arrêtent là en ce qui concerne les habitants «libyens» du territoire carthaginois. Tout ce qu’on pourrait ajouter se limite à cette culture «libyphénicienne», terme employé par Pline l’Ancien pour qualifier, semble-t-il, la symbiose qui s’est réalisée –comme le laissent penser plusieurs siècles de cohabitation– entre les genres de vie, les traditions des autochtones et l’apport sémitique des Phéniciens. Car ce que les historiens appellent la civilisation punique, avec ses modes de vie, son artisanat, ses croyances et ses pratiques religieuses c’est, sans conteste, la rencontre culturelle entre ces deux ethnies, l’une sémitique et orientale des Phéniciens et l’autre libyque et traditionnelle des indigènes, ancêtres des «Berbères».
Dans la région du Byzacium (le Sahel actuel), notamment, région qui constituait peut- être l’une des circonscriptions territoriales puniques, les habitants bénéficiaient d’une spécificité culturelle reconnue par les auteurs latins. La famille d’Hannibal, les Barcides, y possédait des propriétés; et c’est là que le général punique débarqua, à Leptis Minor (Lemta) de façon plus précise, rappelé d’Italie en 203 av. J.C par le Sénat de Carthage après la bataille des Campi Magni. Les troupes carthaginoises et celles de leur allié Syphax, y avaient subi une grave défaite, avec la capture du roi numide par l’armée romaine. Or on a déjà mentionné que Tite Live (XXI, 22,3) donnait aux habitants de cette région du Byzacium le nom de Libyphéniciens et il les définissait comme les descendants d’un métissage entre Carthaginois et autochtones libyens. Plus tard, on a vu que Pline l’Ancien (N.H.,V, 24) leur donnait le même nom et depuis, l’archéologie a confirmé amplement cette affirmation d’un métissage culturel. On a relevé, en effet, parmi les rites funéraires typiquement libyques pratiqués dans les nécropoles du Sahel, comme aussi parfois dans celles du Cap Bon, à Kerkouane, l’application d’une ocre rouge, qui rappelle la couleur du sang, et qui se serait fixée sur les os après la décomposition des chairs. On y a noté aussi la pratique d’un autre rite funéraire libyque, celui de l’enterrement des morts en position latérale, dite en «décubitus latéral fléchi», obtenue sans doute par un ligotage préalable du cadavre, lui donnant une position fœtale qui rappelle l’origine de la vie dans l’utérus et augure un renouveau vital ; ce qui permet de penser à des croyances en une «survie» outre-tombe des défunts.
Mais ce que la phrase de Dion Chrysostome implique surtout, c’est que les territoires de l’hinterland africain soumis à la domination de Carthage étaient devenus sans doute suffisamment étendus. Ils incluaient d’abord les anciens Emporia phéniciens, cette région des «marchés» jalonnée par des comptoirs et des colonies, depuis le Sahel tunisien jusqu’à l’Ouest de la côte libyenne, entre la petite et la grande Syrte, c’est-à-dire entre le golfe de Gabès et la côte occidentale de la Libye. Pour les anciens marins phéniciens, ces installations avaient, à haute époque, constitué des escales indispensables sur le chemin du retour vers l’Orient. Au sud du Sahel, la domination de Carthage ne s’arrêtait pas au pays qui portera plus tard le nom de Tripolitaine, en raison de ses trois cités majeures : Leptis Magna (Lebda), Oea (Tripoli) et Sabratha. Elle s’étendait bien au-delà.
On sait en effet qu’avant le milieu du IVe siècle, les Puniques étendirent la zone d’influence de leur cité jusqu’aux Arae Philaenorum, les «autels des Philènes», au fond de la grande Syrte. Ainsi désignée par les sources, cette limite avait donné matière à l’une de ces légendes «étiologiques» fréquentes dans les textes anciens –à l’instar de celle de la fondation de Carthage faisant intervenir le découpage d’une peau de bœuf pour «expliquer» le nom de la colline de Byrsa, car cette appellation signifiait en grec le cuir et la peau apprêtée. La légende prétendait donc que les deux cités, punique et grecque, de Carthage et de Cyrène décidèrent de mettre un terme aux guerres incessantes qui les opposaient, en fixant à leurs territoires respectifs une frontière unanimement reconnue. Cette limite, auraient-ils convenu, serait au point de rencontre de leurs champions qui, un certain jour, partiraient en même temps et en sens opposé, les uns de Carthage et les autres de Cyrène. Les deux champions de Carthage, deux frères nommés Philènes, parcoururent dit-on une distance beaucoup plus grande, mais furent accusés d’avoir anticipé leur départ. On leur offrit cependant le choix entre deux propositions: soit de permettre aux Cyrénéens de s’avancer aux mêmes conditions, soit d’accepter d’être enterrés vivants à l’endroit même où ils étaient parvenus. Les frères Philènes acceptèrent de se sacrifier et Carthage, reconnaissante, leur aurait consacré cet autel, là où fut fixée la frontière entre le territoire, grec, de Cyrène et celui, punique, de Carthage.
Comme bien d’autres légendes «explicatives», celles qui fixent une frontière qui clôt un conflit territorial au point de rencontre de champions, se retrouvent ailleurs dans les récits de l’Antiquité. Et si on est d’accord pour situer au fond du désert libyen de la grande Syrte cette limite vouée, à travers les siècles, à une fixité étonnante, on hésite encore à la localiser avec précision. Vraisemblablement, au lieu-dit Gsar et-Trab, un peu au Sud de ras el-Alia. Là s’arrêta la zone d’influence de Carthage, et jamais elle ne s’étendit plus à l’Est. Là fut fixée aussi, plus tard, la limite orientale de la province romaine, la Provincia Africa Proconsularis, limite qui constitua désormais la ligne de partage entre le domaine linguistique du latin, à l’Ouest, et celui du grec à l’Est. Encore plus tard, les autels des Philènes devinrent la limite entre l’empire romain d’Occident et l’empire d’Orient.
La zone d’influence de Carthage s’étendit aussi, bien entendu, aux cités échelonnées sur le littoral septentrional du Maghreb, en bordure des royaumes indigènes. Ces comptoirs et ces colonies fondés par les Phéniciens se suivent, depuis Hippo Regius (Annaba) et Rusicade (Skikda) jusqu’à Lixus (Larache) sur l’Atlantique, avec notamment les sites dont le nom débute par le radical sémitique rus, équivalent de l’arabe ras – comme Rusazus, Rusuccurru, Rusguniae… – qui dénote l’antique présence des navigateurs orientaux. Tous ces sites n’ont pas, ou pas encore livré des traces avérées de cette occupation qui, a contrario, a été décelée à Iol-Caesarea (Cherchel) et Gunugu (Gouraya) en particulier. A Tipasa, les poteries grecques recueillies dans des sépultures permettent de dater l’arrivée des Phéniciens de la fin du VIe siècle. Située à une soixantaine de kilomètres à l’Ouest d’Icosium (Alger), cette cité a livré un matériel archéologique abondant, qui se situe entre le IVe et le IIe siècle. Mais ces établissements, plutôt qu’avec Carthage, devaient avoir surtout des relations constantes avec les installations puniques de l’Espagne méridionale.
Les territoires directement administrés par Carthage
Délimiter les territoires administrés directement par la métropole punique n’est pas aisé, car les textes anciens ne sont malheureusement pas d’un grand secours. Strabon (XVII, 3, 15) indique cependant que les Carthaginois «avaient fini par s’annexer tous les pays qui ne comportaient pas de vie nomade» et qu’ils «possédaient trois cents villes» en Afrique, à l’époque de la troisième guerre punique. En recoupant ces données imprécises avec d’autres indications textuelles, on en a déduit que le territoire carthaginois, exploité économiquement et administré de façon directe ou indirecte, à la fin du IVe siècle avant le Christ, comportait tout d’abord un peu plus de la moitié Nord de la Tunisie actuelle, depuis l’ouest de Tabarka et de la Kroumirie au Nord-Ouest jusqu’à la région de Sfax au Sud-Est. C’est dire qu’il s’agit des régions les plus fertiles du pays, avec d’une part l’arboriculture des riches terroirs de la basse vallée de la Medjerda et du Cap Bon et, de l’autre, la céréaliculture des terres qui s’étendent de la vallée de l’Oued Miliane au Nord-Est jusqu’au bassin moyen de la Medjerda et à Simitthu (Chemtou) au Sud-Ouest. S’y ajoute, à partir du golfe d’Hammamet, la région agricole du Sahel actuel, depuis l’arrière-pays d’Hadrumetum (Sousse) jusqu’à celui de Taparura (Sfax), en bordure des étendues steppiques du Sud. C’est là que se trouvaient, sans doute en chiffre rond, les «trois cents villes» du texte de Strabon.
Au milieu du IIIe siècle, selon Diodore de Sicile (IV, 18, 3 et XXIV, 10, 2), les Carthaginois s’étaient aussi emparés, au Sud-Ouest de leur territoire, de la ville d’Hécatompylos (la cité aux cent portes), qui a été identifiée avec l’actuelle Tebessa. Cette avancée vers l’Ouest avait aussi concerné, très probablement, Cirta (Constantine), au Nord-Ouest de Tebessa, en passant par Macomades, dont le nom latinisé est une déformation du toponyme punique Maqôm Hadasht (), c’est-à-dire une «cité nouvelle» carthaginoise ; dans tout ce Nord-Est algérien, en effet, l’empreinte linguistique et culturelle de Carthage perdura longtemps, bien après la destruction de la métropole punique. Mais la possession de ces villes ne signifie pas nécessairement que Carthage contrôlait directement ce pays des Numides massyles, à l’Est de Cirta.
Grâce, d’une part, à une inscription punique gravée sur une borne qui limitait une circonscription administrative carthaginoise et grâce aussi, d’autre part, à deux inscriptions latines découvertes l’une à Makthar et l’autre à Utique, on a pu proposer que le territoire carthaginois administré directement était subdivisé en cinq circonscriptions qui subsisteront à l’époque romaine et qu’on appellera alors en latin pagi : le pagus Muxsi, au Nord de la vallée de la Medjerda, le pagus Gunzuzi dans l’arrière-pays du golfe d’Hammamet, le pagus Thuscae autour des deux cités de Zama et de Mactaris, le Byzacium enfin, dont la façade maritime s’arrondit entre Ruspina (Monastir) et Taparura (Sfax). La péninsule du Cap Bon – le Beau Promontoire, comme on l’appelait alors – constituait sans doute une sixième circonscription administrative, la plus fertile et la plus proche de Carthage, celle des riches propriétés de l’aristocratie foncière.
Ammar Mahjoubi